Les Scientifiques en rébellion font de plus en plus parler d’eux à propos de la situation environnementale. Mais les membres de ce mouvement ne se contentent pas d’informer le public. Ils cherchent à imposer des mesures politiques, au point d’abuser de leur titre de scientifiques.
Dans une démocratie, tout citoyen a le droit de protester et, éventuellement, de se rebeller, si on lui retire les moyens de faire entendre sa cause. En France, bénéficiant de ce droit, des scientifiques se sont organisés en mouvement de protestation, sous l’appellation de Scientifiques en rébellion, pour protester contre le gouvernement français qui, selon eux, n’en ferait pas assez au regard de la situation environnementale.
Ce mouvement est né d’une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, en février 2020, dans laquelle de nombreux scientifiques reprochaient au gouvernement français de ne pas reconnaître « qu’une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement une impasse ».
Ils précisaient que les « objectifs de croissance économique [que le gouvernement] défend sont en contradiction totale avec le changement radical de modèle économique et productif qu’il est indispensable d’engager sans délai ».
Ils présentaient même comme une « vérité » l’affirmation selon laquelle « notre mode de vie actuel et la croissance économique ne sont pas compatibles avec la limitation du dérèglement climatique à des niveaux acceptables ». Partant de cette position tranchée, ils en appelaient « à participer aux actions de désobéissance civile menées par les mouvements écologistes ».
Autrement dit, ce mouvement, actif depuis plus de trois ans, ne se contente pas d’informer sur la situation environnementale, ce qui serait tout à fait louable, de la part de scientifiques. Il établit des liens, présentés comme indiscutables, entre cette situation et la politique économique du gouvernement. Puis, à travers son appel à la désobéissance civile, il tente de contraindre le gouvernement pour qu’il adopte ses recommandations.
Les actions qu’il a entreprises depuis cette tribune ne relèvent en effet pas de la simple interpellation, tout à fait légitime pour un mouvement de protestation ; elles consistent à perturber le fonctionnement d’activités légales, voire à les empêcher, et à détériorer des biens publics ou privés. Ces actions au nom de la science peuvent surprendre, car il est établi depuis longtemps que l’activité scientifique est descriptive et non prescriptive, c’est-à-dire qu’elle consiste à étudier le monde, et non à dire comment agir. Un scientifique est ainsi tout à fait légitime quand il informe les citoyens, mais il n’a aucune autorité pour décider du fonctionnement de la cité. Tout ce qui relève de l’action appartient à la politique qui garde son autonomie vis-à-vis du discours scientifique. Aussi peut-on se demander si, par leur rhétorique et leurs actions, le mouvement des Scientifiques en rébellion n’outrepasserait pas le droit légitime de protestation.
La confusion des genres
Déjà, le titre de ce mouvement soulève des questions.
Faire profession de scientifique signifie que l’on est spécialisé dans un domaine particulier du savoir. Un biologiste, un chimiste ou un physicien ont ainsi une certaine autorité pour parler, respectivement, de biologie, de chimie et de physique. En revanche, ils n’ont pas d’autorité particulière pour parler d’économie, d’affaire sociale ou de politique territoriale. Or, les membres du mouvement des scientifiques en rébellion ne se rebellent pas contre des discours en rapport avec leur domaine d’expertise, parce qu’ils les jugeraient faux ou trompeurs, comme pourraient le faire, par exemple, des biologistes à l’encontre de la diffusion de discours créationnistes. Ils protestent contre des orientations économiques et des décisions politiques à propos desquelles ils n’ont aucune compétence particulière.
En général, les scientifiques ne commettent pas cette grave confusion des genres. Par exemple, les biologistes ne viennent pas donner des leçons aux cosmologistes, et réciproquement. Pourquoi donc, en ce qui concerne la politique environnementale, ces scientifiques viennent-ils donner des leçons aux politiques ?
À nos yeux, il y a principalement trois raisons.
- Ils ne se rendent pas compte qu’ils portent des jugements de valeur.
- Ils ne réalisent pas que l’objection fondamentale à la poursuite de la croissance qu’ils pensent avoir trouvé est pour le moins contestable.
- Ils s’illusionnent lorsqu’ils pensent que l’analyse de la situation environnementale désignerait d’elle-même un nécessaire changement de politique.
Comme nous allons le montrer, leur erreur est donc un triple aveuglement sur la nature et la portée de leurs raisonnements.
Pour bien comprendre la première illusion, rappelons que le rôle des scientifiques n’est pas de juger, mais de décrire, d’expliquer et de prédire de manière neutre.
Or, dans le texte qui définit la « Raison d’être » de leur mouvement, les scientifiques en rébellion écrivent que notre « modèle de société fondé sur la croissance économique infinie a failli ». L’affirmation est étrange. Notre modèle de société a entraîné à la fois des évolutions des conditions de vie des populations humaines et des transformations des écosystèmes. Libre à chacun de juger bonnes ou mauvaises ces évolutions et transformations. Mais ces jugements ne relèvent pas d’une analyse scientifique.
Ces scientifiques pourraient défendre l’idée qu’il y a comme une sorte d’objectivité derrière cette qualification de faillite au regard de la situation environnementale. C’est d’ailleurs probablement pour appuyer cette éventuelle justification que, juste après, ils écrivent que le « déni des limites planétaires a conduit à un effondrement généralisé des écosystèmes ». Mais, là non plus, cette affirmation ne correspond en rien à une description objective. De fait, pour en rester à notre pays, la France n’est pas devenue un désert stérile. Certes, certains écosystèmes se sont transformés au cours du temps. Mais présenter ces transformations comme des effondrements ne correspond pas à une description. N’oublions pas en effet qu’il n’y a aucune raison d’affirmer que la transformation d’une forêt, par exemple, en une savane est mauvaise en soi. Elle peut être mauvaise par rapport à telle chose et bonne par rapport à telle autre. Pourquoi donc écrire que nous assistons à un effondrement des écosystèmes ?
Ensuite, même la référence au changement climatique, qui menacerait « directement l’avenir de nos sociétés, voire de l’humanité et de l’ensemble du vivant », ne permet pas d’affirmer que notre modèle de société a failli. Au cours des dernières décennies, ou même des derniers siècles, notre modèle de société a eu des conséquences sur plein d’aspects de la planète et de la vie de ses habitants. En particulier, par l’utilisation des énergies fossiles, il a entraîné un réchauffement climatique, mais a aussi permis aux humains d’améliorer considérablement les conditions matérielles de leur existence. Est-ce bien ou mal ? Il est possible d’en discuter. Même le fait que cette utilisation fasse courir des risques à l’humanité ne signifie pas que cette dernière a failli. Encore une fois, les jugements que l’on portera sur ce recours aux énergies fossiles ne relèvent donc pas de la description scientifique.
La deuxième illusion de ces scientifiques concerne l’objection à la croissance.
Elle est présentée dès leur tribune, lorsqu’ils écrivent « qu’une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement une impasse » et qu’il faudrait donc y mettre un terme « sans délai ». Pourtant, il est impropre de parler de croissance infinie, surtout pour des scientifiques un minimum versés dans les considérations mathématiques, dans la mesure où il n’existe pas de processus infini sur Terre. La croissance peut, au mieux, être indéfinie. Cette rectification terminologique n’est pas secondaire, car elle introduit implicitement la notion d’échelle temporelle dans l’appréhension de la notion de croissance. Elle permet ainsi de comprendre que, même si la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, du moins tant que l’extraction des ressources reste confinée aux limites de la Terre, elle n’a pas nécessairement à s’arrêter maintenant. Le désir de continuer la croissance dans un monde fini est d’ailleurs loin d’être absurde, quand on se rappelle qu’elle a quand même permis au cours des deux derniers siècles une amélioration des conditions matérielles de l’existence. Elle pourrait donc permettre des avancées similaires dans les décennies à venir. Cette perspective est bien sûr sujette à discussion, mais aucun biologiste, physicien ou chimiste ne peut l’infirmer à partir de ses compétences disciplinaires.
Enfin, la troisième illusion se manifeste quand ces scientifiques laissent entendre que la situation environnementale indiquerait, comme ils l’écrivent dans la tribune, « qu’il est indispensable d’engager sans délai » un « changement radical de modèle économique et productif ».
Or, il est difficile de comprendre comment des analyses scientifiques pourraient signaler qu’un changement de société est indispensable et nécessaire. D’abord, parce que, dans ces analyses, rien ne montre que le changement sera meilleur que le statu quo. Certes, les scientifiques en rébellion multiplient les références à des catastrophes actuelles et futures. Pourtant, même si ce constat est valide, il n’implique pas qu’un changement radical de société est nécessaire, ne serait-ce parce que, à ce jour, les scientifiques en rébellion n’ont pas montré que la nouvelle société qu’ils préconisent est préférable à celle qu’ils rejettent.
Ils se contentent de mettre en cause la croissance économique, la combustion des ressources fossiles, l’extraction des ressources, l’industrialisation, l’artificialisation des sols, l’usage des pesticides, le recours à de nombreux additifs, etc. Personne ne nie que ces activités puissent avoir des conséquences négatives sur les populations humaines. En même temps, elles ont permis une amélioration phénoménale de leurs conditions de vie au cours de ces deux derniers siècles. S’en passer pourrait donc avoir des conséquences plus mortifères que de les perpétuer. Ce n’est bien sûr qu’une hypothèse. Mais pour avancer qu’un changement de société est nécessaire, il faudrait au moins montrer que cette hypothèse est problématique. Ce que les scientifiques en rébellion ne font pas. Ce n’est d’ailleurs pas très surprenant, car on ne voit pas trop en quoi les ressources de la biologie, de la chimie ou de la physique seraient vraiment utiles pour faire cette démonstration.
Ensuite, il y a une autre raison encore plus fondamentale pour laquelle des analyses scientifiques ne peuvent pas indiquer qu’un changement de société est indispensable et nécessaire. C’est tout simplement parce qu’un choix de société ne procède pas d’une analyse scientifique. Même si notre société nous entraînait droit dans le mur, un changement ne serait jamais indispensable et nécessaire. Il serait simplement une option vers laquelle nous pourrions, en tant que société, essayer de nous tourner ou pas. Les humains ne sont-ils pas libres de choisir leur futur, aussi funeste soit-il ? D’ailleurs, c’est ce que l’on fait régulièrement dans notre vie quotidienne. Par exemple, il est avéré que l’alcool nuit à notre santé, que manger trop sucré aussi, que la voiture est dangereuse, que certaines activités sportives (parachute, escalade, saut à l’élastique, etc.) comportent des risques, etc. Est-ce pour autant qu’il est indispensable et nécessaire d’interdire l’alcool, les aliments sucrés, les voitures et les activités à risque ? Bien sûr que non, pour la simple raison que – malgré leurs défauts – ces ingrédients, objets et activités apportent aussi des satisfactions. Puis la décision de les réduire, de les contrôler ou d’y mettre un terme ne peut en aucun cas procéder d’une analyse scientifique. Elle relève d’un choix personnel ou collectif. Aucun scientifique ne peut donc laisser entendre qu’un changement de société est indispensable et nécessaire. Il y a ici une confusion des registres. Le plus grave est que les scientifiques en rébellion veulent imposer ce changement, en outrepassant le jeu normal de la démocratie.
Le rejet de la démocratie
Si le mouvement des scientifiques en rébellion avait pour objectif d’informer les citoyens sur la situation environnementale, il serait tout à fait recommandable.
Mais il cherche aussi à imposer ses vues politiques. Dans le texte « Raison d’être », il en appelle ainsi à « instaurer un rapport de force », à une « confrontation avec certains acteurs qui ont intérêt au statu quo » et à perturber certaines activités à travers des « blocages, occupations, affichages sauvages, perturbations d’événements ».
Ces scientifiques sont d’ailleurs déjà passés à l’acte. Il est clair que ces actions vont au-delà de la simple expression d’une opinion. Elles perturbent des activités et saccagent des biens dans le but, comme ils le disent eux-mêmes, d’instaurer un rapport de force, avec l’espoir de faire plier le gouvernement. Or depuis quand, en démocratie, un groupe de personnes peut-il légitimement imposer ses idées à la société sans se soumettre au vote ? Que ces personnes soient des scientifiques ne change rien à la situation. De fait, imaginons que demain les alcoologues (médecins spécialistes de l’alcool) s’installent sur les routes pour bloquer la circulation ou s’enchaînent en divers endroits pour empêcher le bon déroulement d’événements, tant que le gouvernement n’interdit pas l’alcool. La plupart des citoyens seraient, à juste titre, probablement outrés par leur comportement. Même si ces alcoologues ont raison de souligner que l’alcool cause des milliers de morts par an, dirait-on, ce n’est pas à eux de décider s’il faut ou non interdire l’alcool. Cette prohibition doit relever d’une décision politique. Or le comportement des scientifiques en rébellion est exactement le même que celui de ces alcoologues imaginaires.
Il est donc temps que les scientifiques en rébellion arrêtent de se réclamer de la science dans leur prise de position politique et cessent d’adopter une attitude antidémocratique. À titre individuel, ils ont bien sûr le droit de protester contre les décisions du gouvernement et de défendre leurs idées politiques. Mais leur statut de scientifiques ne donne aucune autorité particulière à ces idées et ne leur donne à eux aucun passe-droit pour les voir appliquées. S’ils veulent s’engager en politique, ils n’ont d’autre choix que d’aller, en simples citoyens, devant les électeurs pour les convaincre, comme tout un chacun. À défaut, il faudra les considérer comme des imposteurs, qui abusent de leur statut de scientifiques pour imposer leur vision politique.




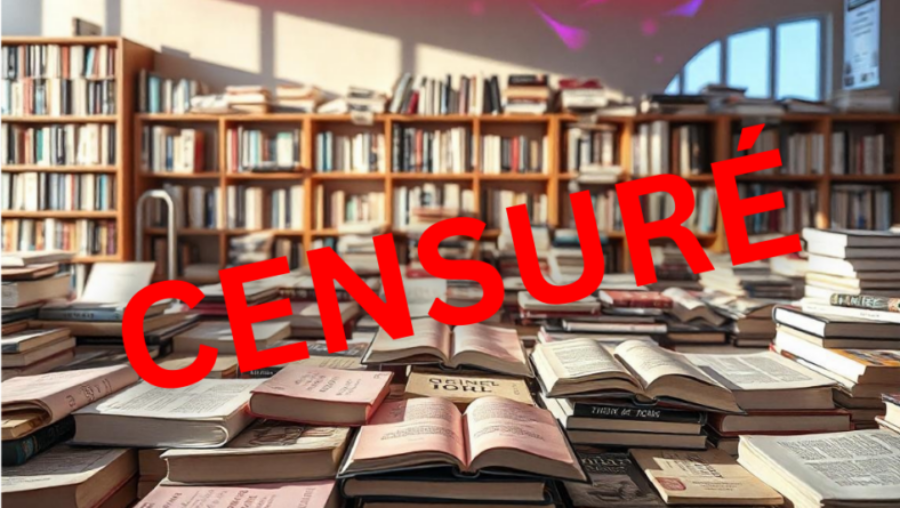
Excellent article. La science dit ce qui est, ainsi que ce qui peut se produire à l’avenir (modèles, prévisions). La science ne dit pas si c’est bien ou mal (ce n’est pas de la science c’est de la morale). La science ne dit pas ce qu’il faut interdire ou imposer à tous (ce n’est pas de la science c’est de la politique). Vouloir imposer un point de vue « au nom de la science » est une imposture.
Le parallèle avec des alcoologues qui bloqueraient les routes pour contraindre le gouvernement à “agir” est très intéressant. Même les pires des pires répressifs des membres d’assoces de “prétention routière” n’oseraient pas aller aussi loin.
Autre chose : le “monde fini”. Je ne pense pas qu’il le soit, notamment en matière énergétique. Qu’on songe aux tourments de nos ancêtres, jadis, quand on s’éclairait à l’huile de baleine, qui craignaient que l’humanité replonge dans le noir lorsque la dernière d’entre elles aura été tué.
Puis on a trouvé le gaz, le pétrole, l’uranium. Avec à chaque fois, des gains considérables.
Au lieu de s’apitoyer sur ce monde capitaliste qui leur déplaît, car tel est leur substrat idéologique, ils devraient s’atteler à la recherche de nouveautés technologiques.
Ce refus devant l’obstacle ne les grandit pas. Je crois que le monde se passera d’eux, pendant que les Tesla, NVidia, Total et autres Amazon défricheront l’avenir.
Et soulignons que même en passant à l’âge de bronze, l’Homme n’était pas à court de pierres ou de cailloux…
Même sur le plan scientifique ces étroniformes gauchards expriment leurs médiocrité et leur haine, à peine cachée, du capitalisme et de la croissance économique (ou pour être plus précise d’une certaine croissance économique). Ce qui importe pour ces imposteurs, c’est cette conclusion de la fameuse responsabilité de l’homme (RCA) gravée dans leur cortex cérébral. Une conclusion qui a tjs précédé voire gommé tout le reste de la prétendue démarche scientifique. Du coup, incapables de nous convaincre, ils en appelle ad nauseam aux forces “législative” (véritable arme de destruction massive), fiscale et coercitive.
Petit désaccord tout de même, selon mes maigres lectures sur le sujet, il serait moins question d’un réchauffement lié à l’exploitation des énergies fossiles que de l’activité solaire.
Je ne résiste pas à la tentation de vous partager cet extrait tiré de “Droit, législation et liberté” de Hayek sur le constructivisme social dont il est question ici :
“L’Homme est tout autant un animal-obéissant-à-des-règles qu’un animal-recherchant-des objectifs. Et il est efficace, non pas parce qu’il sait pourquoi il doit obéir aux règles qu’il observe en fait, ni même parce qu’il est capable d’énoncer toutes ces règles en paroles, mais parce que sa pensée et son agir sont régis par des règles qui par un processus de sélection, se sont établies dans la société où il vit, et qui sont ainsi le produit de l’expérience de générations.”
Phénomène plus général..
de nombreux scientifiques veulent du pouvoir politique.