Les profits exceptionnels réalisés par les banques, en particulier américaines, posent de réelles questions. La voie commode de la taxation leur apporte de fausses réponses.
Une économie sous influence
Le vocabulaire employé est un signe parlant de l’inquiétude que suscite outre-Atlantique la concentration du pouvoir financier aux mains d’un nombre très restreint de très gros établissements.
Les huit premiers d’entre eux sont couramment qualifiés par les médias de « seigneurs de Wall Street » mais aussi de « géants de la finance », de « mastodontes » et dans tous les cas de « banques systémiques »[1] capables en cas de faillite d’une seule d’entre elles de déclencher un cataclysme économique comme celui de 2008.
JP Morgan, qui occupe la première place du classement, et dont les profits se sont élevés à 87 milliards de dollars en 2022, ne détient-elle pas la somme colossale de 3200 milliards de dollars d’actifs, soit un chiffre nettement supérieur au PIB de la France ?
Wells Fargo, qui occupe le troisième rang, s’est distinguée en mettant en œuvre des méthodes de cow-boy imaginées par ses dirigeants : en août 2017, ils ont dû reconnaitre avoir vendu des assurances auto à des centaines de milliers de clients sans qu’ils l’aient demandé puisqu’ils en avaient déjà une par ailleurs. Cette banque s’est aussi illustrée entre 2011 et 2016 en ouvrant à ses usagers et sans leur autorisation plus de deux millions de comptes fictifs, mais dont les frais facturés étaient bien réels.
Les financiers ne sont donc guère en odeur de sainteté aux États-Unis où, comme au début du XXe siècle, l’opinion publique se méfie ouvertement du « big money ».
L’ampleur des profits réalisés actuellement par la bande des 8 dans un contexte d’inflation non maitrisée, et de difficultés croissantes pour la majorité de la population a réactivé cette hostilité.
Elle interroge suffisamment pour que la commission bancaire du Sénat des États-Unis se saisisse du sujet.
Le 6 décembre elle auditionnera la fine fleur des « seigneurs de Wall Street » sommés de rendre des comptes au moment où la situation financière des américains se dégrade.
L’offensive du Sénat américain
Selon le président de ce comité, les méga-banques « détiennent trop de pouvoir dans l’économie » :
« Elles continuent à engranger des profits record et à récompenser les entreprises qui augmentent les prix sur le dos des américains ».
En ligne de mire se profile, comme dans l’Union européenne, la mise en place d’une taxation exceptionnelle sur les surprofits bancaires. Mus par une sorte de réflexe pavlovien, la réaction des responsables politiques des deux côtés de l’Atlantique est de fait toujours la même face à ce type de situation : TAXER.
Mais c’est confondre les effets avec les causes.
Pour apporter une réponse pertinente, il faut remonter aux racines du problème et commencer par identifier la source de ces revenus stratosphériques. En l’occurrence, plutôt que d’agiter le chiffon rouge des « surprofits », mieux vaudrait parler de profits d’aubaine alimentés par une double opportunité :
- Au printemps, la faillite de la banque californienne Silicon Valley Bank a suscité le reflux des déposants vers les plus gros établissements jugés plus sûrs.
- Depuis janvier 2022, la forte et rapide hausse des taux directeurs (passés en peu de temps de 0,25 à 5,5 %) a bénéficié aux banques qui ont fait grimper jusqu’à 7 % le taux des emprunts immobiliers, alors qu’elles ne rémunèrent leurs dépôts qu’à 0,45 % en moyenne.
Si elles ont été en mesure de tirer pleinement parti de cette conjonction d’évènements, c’est du fait de la position dominante qu’elles occupent dans le gigantesque réseau des activités de production et d’échange, une position qui les met en situation d’exercer une forme très efficace de prédation.
Cela s’inscrit dans le cadre d’un capitalisme de connivence entretenant des liens consanguins et malsains avec le politique qui, par le laxisme de sa régulation, a laissé prospérer cet état de fait. Ce qui est ici en cause est une concentration excessive du pouvoir financier aux mains de quelques-uns, c’est un manque de concurrence et une emprise trop forte de la finance sur l’économie.
Ce qui est aussi en jeu, c’est une série de défaillances de l’État incapable d’assurer ses missions de base que sont la protection des consommateurs et la lutte contre les abus de position dominante.
En taxant, on s’attaque maladroitement aux conséquences et non aux causes du processus qui a donné naissance au paysage financier actuel.
Réactiver la concurrence
Pour le reconfigurer, la réponse n’est pas plus d’impôts mais davantage de concurrence.
Apple s’est déjà engouffré dans la brèche en mettant en place un compte d’épargne rémunéré à 4,15%, soit près de dix fois plus que ceux des mastodontes. En six mois son initiative a séduit 10 millions de clients.
Pour aller plus résolument dans ce sens, réactiver la législation anti-trust est une meilleure piste que la taxation. Depuis le vote du Sherman act (1890) puis du Clayton act (1913), l’arsenal existe, mais dans le cas des banques il a été mis en sommeil sous la pression insistante des lobbies de la finance.
Il faut revenir à l’esprit de déréglementation qui a prévalu sous l’administration Reagan et permis de démanteler les oligopoles qui prévalaient dans les secteurs du transport aérien ou des télécommunications. On a ici le cas emblématique d’ATT, dont le quasi-monopole a explosé en 1984 sous les assauts conjugués de l’antitrust, des régulateurs de la Commission fédérale des communications et de la justice. Son démantèlement, un des événements les plus spectaculaires de l’histoire industrielle du XXe siècle, a donné le coup d’envoi de la libéralisation mondiale des services de télécommunications.
AT&T, alias Ma’Bell (« la mère du téléphone ») a dû éclater en huit entités distinctes avec sept opérateurs locaux, les « Baby Bells », totalement indépendants, et un opérateur longue distance, AT&T. La disparition de la contrainte qu’exerçait ATT sur l’ensemble des réseaux a certainement favorisé l’essor d’internet et la révolution numérique.
Lutter contre l’obésité bancaire
Dans le même ordre d’idée, il s’agit aujourd’hui de mettre fin à ce qui incite les banques à toujours grossir en rendant plus difficiles les fusions et la prise de contrôle de nouveaux établissements.
C’est le sens de la proposition de loi bipartisane Brown/Scott visant à empêcher les méga-banques de multiplier les acquisitions, et à sanctionner davantage les dirigeants de banques mises en faillite.
En revanche, il faut agir pour sauvegarder la vitalité du tissu très dense de banques locales, qui est un atout majeur de l’économie des États-Unis. S’y est implanté au fil du temps un écosystème performant composé de milliers d’établissements de petite et moyenne dimension accompagnant efficacement les évolutions technologiques.
En 2018, les contraintes de la loi Dodd-Frank taillée pour les plus grosses banques ont été desserrées pour celles qui ont moins de 250 milliards de dollars d’actifs à leur bilan, ce qui va dans le bon sens. Il faut aussi continuer à alléger les obligations réglementaires qui freinent la création de nouvelles banques locales de manière à faciliter l’accès des petits entrepreneurs aux capitaux.
Séparation vs diversification
On peut enfin s’interroger sur la voie qui a été suivie depuis la crise financière de 2008.
Pour éviter qu’une telle catastrophe se reproduise, deux pistes d’analyse se sont affrontées.
Le modèle de la séparation a été un temps envisagé en s’inspirant de ce qui avait été mis en place lors de la grande dépression des années 1930. Voté en 1933 le Glass Steagall Act séparait strictement les banques d’affaires et les banques de dépôt.
Peu à peu édulcorées, ses dispositions ont été abrogées en 1999 sous l’administration Clinton. Lorsque l’idée d’une séparation a refait surface, nombre de banquiers ont fait valoir que les interdépendances entre les activités de crédit et les activités de marché étaient désormais si étroites qu’il était devenu techniquement impossible de réaliser la séparation. En tout état de cause, elle aurait selon eux des effets négatifs que l’on a du mal à mesurer, mais qui seraient très importants. Au nom de cet argument de l’imbrication et de la complexité, et sous la pression du très puissant lobby bancaire, on s’est dès lors engagé dans une autre voie.
Le modèle de la très grosse banque a prévalu, en considérant que la protection des activités bancaires contre la volatilité des opérations de la finance de marché peut être obtenue par la constitution d’énormes banques dans lesquelles l’influence des activités de marché serait d’autant plus limitée que les banques devraient respecter des ratios prudentiels renforcés. On peut toutefois douter qu’en cas de sérieux décrochages sur les marchés financiers, les banques, même très grosses, pourront s’en sortir en faisant seulement payer leurs actionnaires.
Ainsi que le suggère un économiste comme Pierre-Noël Giraud, on peut estimer qu’il serait salutaire de revenir à une réflexion approfondie sur la première option : il ne s’agirait pas de recopier le Glass Steagall Act, mais de dégager des solutions modernes et de mettre en œuvre des modalités adaptées de séparation. Cela permettrait d’atténuer l’emprise des méga banques sur l’ensemble de l’économie occidentale et de limiter les profits que leur position dominante les met en capacité d’accumuler.
Laisser jouer la destruction créatrice
En tout état de cause, on peut aussi se demander si la finance décentralisée qui prend aujourd’hui son essor, en même temps que s’affinent, s’enrichissent et se diffusent les technologies de la blockchain, ne viendra pas à bout des mastodontes en les rendant obsolètes.
Dans les années 1970, IBM dominait l’informatique mondiale et semblait invincible. Personne n’imaginait que le nain Microsoft allait détrôner « Big Blue » et rebattre entièrement les cartes.
Sous l’influence globalement bienfaisante de la destruction créatrice, le tissu économique et financier est en perpétuel renouvellement, à condition que les pouvoirs publics le laissent respirer.
[1] Huit banques systémiques sont basées aux EU : JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, State Street et Wells Fargo.


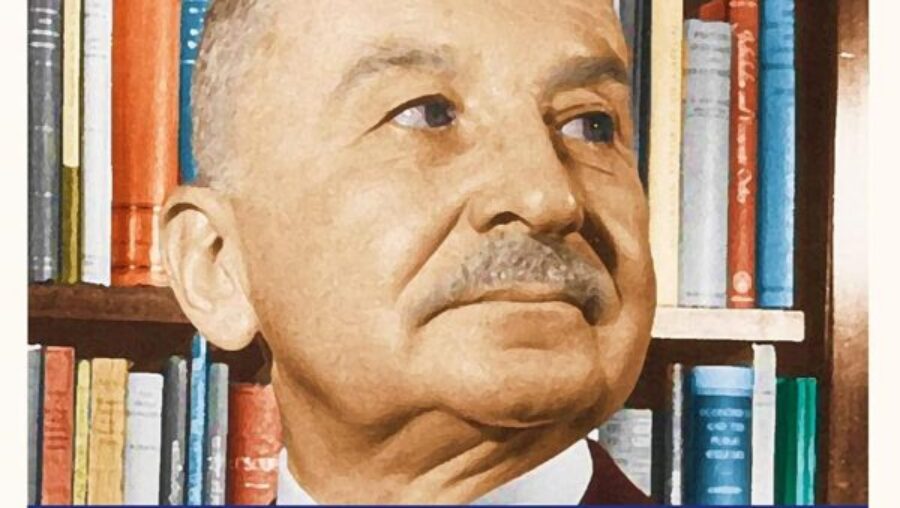

Toutes les taxes appliquées aux banques, celles-ci vont les répercuter immédiatement sur leurs clients. La banque est une machine hyper efficace.