C’était la « cata ». Bien que située sur le circuit RIS d’injection de sécurité, une brèche proche du raccordement de ce dernier au circuit primaire principal (CPP) était la « brèche primaire » tant redoutée, l’accident de référence (ADR) préfigurant la Perte du Réfrigérant Primaire (APRP). L’arrêt d’urgence du réacteur s’imposait qui provoqua la chute instantanée des barres de contrôle ramenant à zéro l’activité de ce dernier.
Mais les ennuis ne faisaient que commencer avec la mise en œuvre dans les pires conditions qui soient d’un refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) condamné à une efficacité sans faille, dont l’intangible pérennité devait se chiffrer en semaines, comme en témoigne la courbe suivante de décroissance de la puissance thermique résiduelle d’un réacteur.
Ces pires conditions venaient du fait que la quantité d’eau contenue dans le CPP devait être à tout prix conservée, si possible « borée », qu’en conséquence la fuite s’écoulant de la brèche devait être compensée le temps qu’il faudrait par une injection de sécurité dont le système RIS a précisément partout la charge en réacteurs nucléaires PWR. Or, l’indisponibilité au moins partielle du RIS ne pouvait que laisser envisager le recours à la procédure accidentelle H4 (H pour hors dimensionnement) prévue en situation de perte totale à terme des moyens de pompage et/ou d’échange de chaleur en cas d’APRP ; typiquement en l’absence de possibilité de secours mutuel des fonctions injection de sécurité basse pression (ISBP) et aspersion de l’enceinte (EAS). Dans ce dernier cas, s’impose même la procédure accidentelle U3 (U pour ultime) prévoyant de faire appel aux moyens mobiles de secours des systèmes ISBP et EAS.
Pressés et stressés par l’urgence, opérateurs et membres des équipes de crise se perdaient en conjectures quant à l’évaluation d’un débit de fuite déterminant le mode d’action de la fonction RIS à solliciter en premier et donc le lignage (disposition des vannes imposant un cheminement précis à la circulation du ou des fluides) des circuits à réaliser.
On suit sur le schéma de principe ci-après – relatif aux paliers 900 MW à 3 boucles primaires – l’explication fonctionnelle et accidentelle de ce à quoi durent faire face opérateurs et équipes de crise sur la tranche accidentée de Penly 1 appartenant au palier 1300 MW à 4 boucles primaires. La brèche en question se produisit sur la ligne ISBP raccordée à la branche « froide » (BF) d’une de ces dernières (partie inférieure de la zone repérée en jaune sur le schéma).
Les différentes options d’exploitation
Les trois options d’exploitation suivantes s’offraient donc aux opérateurs :
Si la dépressurisation du CPP était faible ou nulle, ils devaient recourir à une injection haute pression, au moyen des pompes de charge assurant le contrôle volumétrique et chimique de l’eau primaire en marche normale (à droite du schéma) afin de compenser la fuite et d’introduire une solution concentrée en acide borique ;
Si la dépressurisation était forte, ils avaient l’obligation de solliciter tout ou partie des 3 accumulateurs de 26 m3 (en haut à gauche du schéma), chacun capable de projeter à 45 bars un débit d’eau boriquée équivalent à 50 % du débit nécessaire au noyage du cœur ;
Dans cette même circonstance, les pompes d’injection basse pression ISBP (en bas à droite du schéma) devaient ensuite prendre le relais des accumulateurs et débiter à environ 8 bars, par la ligne gravement endommagée, l’eau puisée (comme les pompes de charge) dans le réservoir piscine réacteur.
En bas à gauche du schéma ci-dessus, on n’aura pas manqué de noter la présence de puisards destinés à recueillir la fuite d’eau primaire, l’eau des accumulateurs, celle du réservoir de la piscine réacteur et le cas échéant celle de l’aspersion enceinte, puisards dans lesquels les pompes ISBP n’ont d’autre choix que puiser l’eau, après le vidage complet dudit réservoir.
Si les pompes d’injection ISBP et les pompes d’aspersion de l’enceinte du système EAS figurant dans le schéma ci-dessus peuvent se secourir mutuellement dans le cadre de la procédure H4-U3 déjà mentionnée, ce secours RIS-EAS ne pouvait hélas rigoureusement rien pour des opérateurs de Paluel 1 cherchant désespérément un possible point d’injection de substitution au point d’injection structurellement dédié, si3ège de la brèche le rendant largement inopérant.
Inutile de préciser que les Plan d’Urgence Interne (PUI) et Plan Particulier d’Intervention (PPI) n’avaient pas attendu une aussi inquiétante aggravation de la situation pour se déployer ; le premier étant de l’entière responsabilité de l’exploitant, c’est-à-dire du directeur de la centrale, le contenu et la mise en œuvre du second – un plan de sécurité civile – incombant au Préfet de département.
Toute action humaine visant à bricoler un point d’injection de fortune sur le CPP étant prohibée, l’organisation de crise ne pouvait que se résigner à prévoir à terme le rejet concerté d’effluents radioactifs gazeux communiquant à la population les doses dont ce qui suit donne un petit aperçu, par ordre croissant de gravité.
Pour donner une idée de l’échelle de ces valeurs, on précise que les Français reçoivent en moyenne une dose naturelle et artificielle de 2,6 mSv par an et que 1 E-6 mSv signifie un millionième de mSv.
Température du cœur < 700 °C, pas de rupture de gaines combustible, CPP propre, aspersion en service :
Doses reçues à 1 km, diffusion aérologique normale et vent de 5 à 10 m/s : corps entier 1 E-6 mSv ; thyroide 2 E-6 mSv
Doses reçues à 5 km, diffusion aérologique normale et vent de 5 à 10 m/s : corps entier 5 E-8 mSv ; thyroide 1 E-7 mSv
700 °C < Température du cœur < 1100 °C, avec ruptures de gaines combustible, aspersion en service : Doses reçues à 1 km, diffusion aérologique normale et vent de 5 à 10 m/s : corps entier 1 E-3 mSv ; thyroide 4,5 E-2 mSv Doses reçues à 5 km, diffusion aérologique normale et vent de 5 à 10 m/s : corps entier 4 E-4 mSv ; thyroide 2,5 E-3 mSv Température du cœur > 1100 °C, avec fusion quasi-totale du cœur, aspersion en sercice :
À 1 km, diffusion aérologique normale et vent 5 à 10 m/s : corps entier 1,1 mSv ; thyroide 25 mSv
À 5 km, diffusion aérologique normale et vent 5 à 10 m/s : corps entier 6 E-2 mSv ; thyroide 1,4 mSv
On ne parle pas de la pire des hypothèses assez improbable en France du rejet des gaz, iodes et aérosols radioactifs à travers un filtre à sable (selon la procédure accidentelle S3-U5), après fusion quasi-totale du cœur, aspersion hors service.
Le gouvernement n’apporte aucune valeur au renforcement de la sureté nucléaire
Pour s’extraire de ce mauvais cauchemar, les Français doivent résolument tourner le dos à une fiction aussi dramatique que peu vraisemblable et regarder avec confiance la solidité de la prévention des risques héritée d’un système ayant largement fait ses preuves et n’ayant de leçon d’assurance qualité à recevoir de personne ; pas même d’une ASN supra gouvernementale et supra présidentielle.
Car, n’en déplaise aux émules de Marignac, les évènements récents ont une fois de plus montré que le pouvoir policier de cette « autorité » n’apporte aucune valeur ajoutée au renforcement de la sûreté nucléaire française, ni en termes d’alerte précoce, ni en termes de résolution des problèmes techniques et industriels. Au contraire, dans l’emphase médiatique qui leur est propre, les nouveaux gendarmes aiment à ajouter de la prescription à la prescription s’imposant naturellement aux vrais professionnels, de l’injonction inutile à l’injonction inutile et de la réglementation superfétatoire à la réglementation superfétatoire. Bernard Doroszczuk aurait-il le front de prétendre que, dans la circonstance présente, la DSIN aurait failli à ses responsabilités et aurait gravement souffert d’une incompétence que le statut de 2006 aurait épargné à son auguste héritière ? Même question à un IRSN auquel on rappelle que les chiffres cités ci-dessus viennent du ô combien méritoire IPSN de naguère.
Non, cher président, vous savez mieux que quiconque que l’ASN n’a rien inventé et surtout qu’elle pourra encore longtemps compter sur une défense en profondeur à toute épreuve et vieille de près de 30 ans, sur sa maintenance prédictive en particulier.
On peut toujours se tromper, mais il est infiniment peu probable que les Français soient un jour confrontés au syndrome ci-dessus mis en scène. Toutefois, dans un pays depuis si longtemps aux mains de la médiocratie une telle sécurité ne peut, hélas, que se payer durablement au prix exorbitant de la rareté et de la cherté énergétiques.





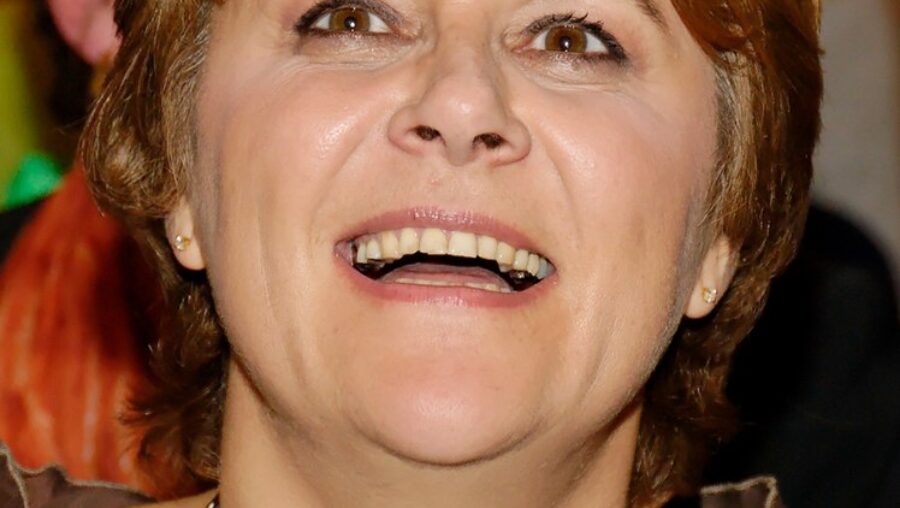


Le principe de précaution qui est dans la constitution revient à “Ne pas naitre devant le risque de mourir”.
Ce pays a signé son arrêt de mort
Grande tristesse de voir la France dirigée par des faibles sous la pression d’idéologues qui la détruise.
Quelle vision à long terme ont tous ces élus qui se laissent manipuler par des groupuscules qui imposent leurs règles irréalistes . Corruption ???
Corruption et réélection.