Par Gérard-Michel Thermeau.
 Deux pères jésuites, Sebastiao Rodrigues (Andrew Garfield) et Francisco Garupe (Adam Driver) débarquent clandestinement sur les côtes du Japon dans la région de Nagasaki à la recherche de leur ancien maître, le père Ferreira (Liam Neeson). Selon la rumeur, le jésuite aurait apostasié, épousé une japonaise et vivrait désormais en bouddhiste. Ils sont aussitôt accueillis et cachés dans des communautés paysannes qui les accueillent avec ferveur. C’est le début d’un calvaire qui va conduire l’un à la mort et l’autre au reniement. Telle est la trame de Silence, le dernier film de Martin Scorsese, adapté d’un roman de Shusaku Endo (1966).
Deux pères jésuites, Sebastiao Rodrigues (Andrew Garfield) et Francisco Garupe (Adam Driver) débarquent clandestinement sur les côtes du Japon dans la région de Nagasaki à la recherche de leur ancien maître, le père Ferreira (Liam Neeson). Selon la rumeur, le jésuite aurait apostasié, épousé une japonaise et vivrait désormais en bouddhiste. Ils sont aussitôt accueillis et cachés dans des communautés paysannes qui les accueillent avec ferveur. C’est le début d’un calvaire qui va conduire l’un à la mort et l’autre au reniement. Telle est la trame de Silence, le dernier film de Martin Scorsese, adapté d’un roman de Shusaku Endo (1966).
Les significations du silence
Le Silence c’est d’abord le silence de Dieu. Les persécutions se multiplient contre les fidèles de moins en moins en nombreux sous le regard impuissant des pères jésuites.
Les scènes de torture se succèdent où l’on voit souffrir et hurler les paysans kirishtan condamnés à la crucifixion, aux noyades ou aux décapitations. Même si les jésuites pensent inévitablement aux chrétiens des origines persécutés par les Romains, au temps des catacombes, le découragement les saisit devant l’absurdité apparente de ce déchaînement de violence.
Le Silence c’est aussi le silence de la clandestinité dans laquelle vivent les chrétiens. Terrés dans une cabane de charbonniers, les deux pères jésuites doivent éviter à tout prix de faire le moindre bruit pour ne pas attirer l’attention.
Le Silence c’est enfin le travail sur la bande son. La musique, qui paraît longtemps absente, se mêle imperceptiblement aux éléments naturels. Le vent n’est pas ici le souffle de Dieu mais celui d’une nature qui écrase des jésuites désorientés dans un pays qu’ils ne connaissent pas.
L’ombre tutélaire de Kurosawa paraît planer sur un film où le brouillard, les fumées et la mer se mêlent dans d’impressionnants paysages plus japonais que nature puisque tournés à Taïwan. Grâce au talent de son directeur de la photographie Scorsese, cinéaste urbain par excellence, réussit à nous plonger dans un autre univers.
Loin de l’agitation spectaculaire et parfois factice de certains de ses films récents, Scorsese trace toujours le même sillon. Qu’il peigne les bas-fonds ou les salons new-yorkais, qu’il mette en scène des maffiosi ou des affairistes, il reste fidèle à ses préoccupations profondes.
À l’image de son protagoniste qui a en apparence renié sa foi le catholicisme de Scorsese imprègne tout son cinéma, même le plus éloigné en apparence des questions spirituelles.
L’Imitation de Jésus-Christ
Les jésuites sont amenés à marcher dans les pas du Christ. Rodrigues ne confond-il pas son visage dans l’eau d’une rivière avec celui de Jésus ? Le père Garupe, raide et intransigeant, sera vite brisé et mourra rapidement. Rodrigues, faible et indécis, connaîtra un itinéraire plus tortueux. Il est suivi pas à pas par Kichijiro (Yosuke Kubozuka), apostat à répétition, qui ne cesse de le trahir et de lui réclamer l’absolution. En proie au doute dans ce jardin des oliviers où gémissent les paysans torturés, Rodrigues finira par piétiner sa foi et marcher sur l’image du Christ. Là le silence se fait.
Mais il entend dès lors la voix de Dieu. En trahissant extérieurement sa foi n’est-il pas resté fidèle à la vérité profonde du christianisme ?
Seuls les bouffeurs de curés laïcards toujours prompts à évoquer l’ombre de l’inquisition pourront voir dans ce film une apologie chrétienne manichéenne. La répression s’incarne d’ailleurs dans un aimable vieillard fatigué dont les sourires et la voix geignarde s’accordent mal avec son surnom d’inquisiteur (Issei Ogata). Sans jamais torturer son prisonnier, l’habile gouverneur va peu à peu le conduire à refaire le chemin qu’a déjà parcouru Ferreira avant lui.
Des points de vue antagonistes
Scorsese fait ainsi entendre le point de vue du pouvoir japonais soucieux d’éviter les ingérences des puissances européennes. Car la condamnation du christianisme est avant tout politique. Cette condamnation politique s’accompagne comme toujours de justifications culturelles douteuses. Le Japon serait un marais où le christianisme ne saurait s’enraciner, la notion d’un Dieu transcendant serait incompréhensible pour les Japonais pour lesquels le soleil se lève chaque jour. On peut ne pas adhérer à ce relativisme culturel.
Le pouvoir peut briser les corps et couper les racines, mais qu’en est-il des âmes ?
Kichijiro, l’apostat perpétuel, finira par mourir, fidèle à cette foi qu’il a tant bafouée. Enfermé dans le silence après son apostasie, Rodrigues en apparence devenu renégat vit une existence dépourvue de consistance. Japonisé de surface, il conservera néanmoins jusqu’au bout le crucifix minuscule que lui avait confié un paysan chrétien. Tel Citizen Kane, il emportera avec lui son secret dans la tombe.
Martin Scorsese a su tirer profit même de la fragilité et des limites de ces deux jeunes acteurs (Garfield, Drive) face au jeu de remarquables acteurs japonais pour réaliser un film qu’il portait en lui depuis vingt ans.
- Silence. Film américain de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tanadobu Asano, Issei Ogata, Yosuke Kubozuka (2h41).
Article publié initialement le 13 février 2017.

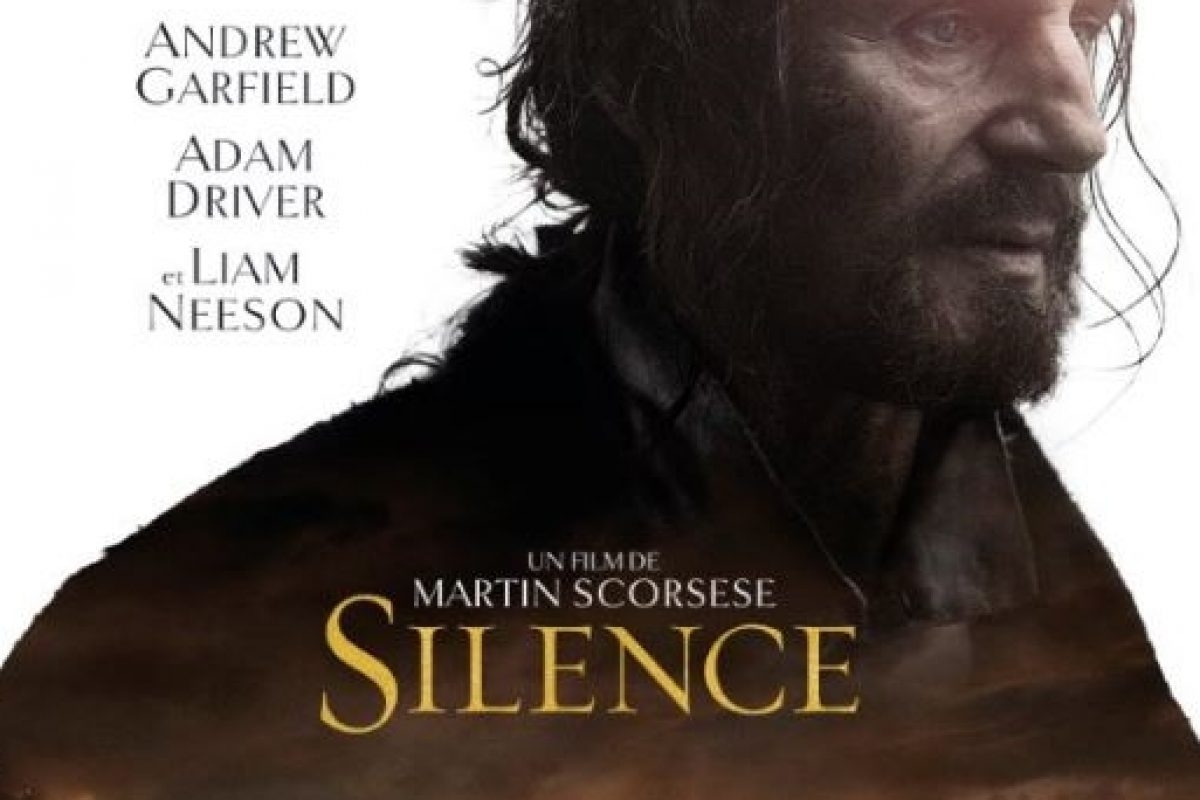

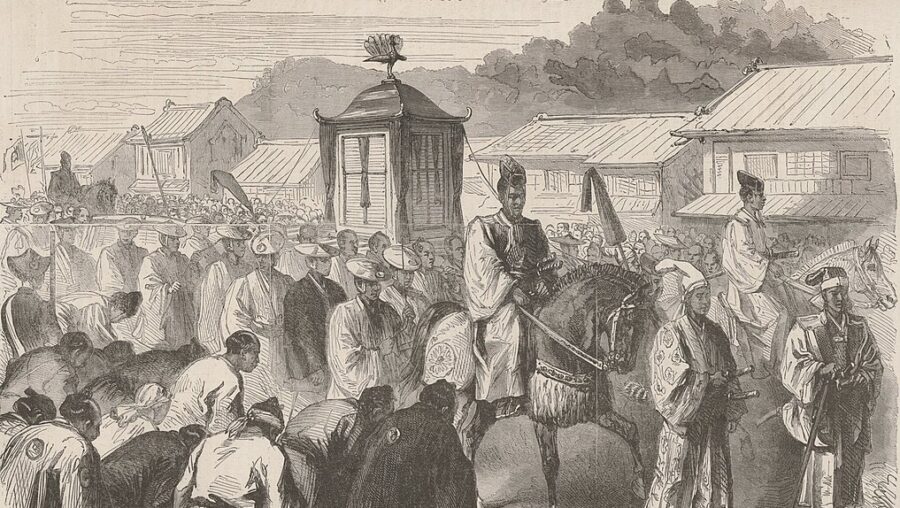

c’est un beau film.. on doit beaucoup aux jesuites sur la signification des ideogrammes chinois..