L’ESA souhaite plus d’argent. Développons plutôt une industrie spatiale et des partenariats comme aux USA. Et si on s’inspirait du modèle capitaliste américain, plutôt que d’attendre tout de l’État ?
La dépense publique pour l’espace, un geste sans possibilité de résultat
Dans un article daté du 13 septembre La Tribune rapporte que le directeur de l’ESA (Agence Spatiale Européenne), Joseph Aschbacher, veut obtenir des états membres1 une augmentation de 30 % de son budget qui passerait ainsi de 14,38 à 18,7 milliards d’euros.
C’est beaucoup mais cela met en évidence trois faiblesses de l’Agence :
- Elle travaille dans un esprit « public » et doit quémander chaque année aux États membres des participations pour des risques qu’elle assume seule, sans les entreprises privées, ses fournisseurs.
- Elle court (avec une lenteur de tortue !) après l’application d’innovations qu’elle a laissé d’autres (aux États-Unis) oser tenter et parfois réussir.
- Dans son environnement, le milieu industriel, certes compétent, n’est pas de nature à susciter le changement, ou n’a pas les moyens de le faire.
Une situation américaine différente
Aux États-Unis l’évolution a été différente et les divergences avec l’Europe sont aujourd’hui criantes. Très tôt, avec le Launch Purchase Act de 1998, la NASA a été obligée par la loi à utiliser des lanceurs privés dès que possible. Cela a favorisé l’essor de sociétés privées telles que SpaceX, soumises à la concurrence, incitées à se développer indépendamment de l’État, même si elles restaient payées par lui. Très vite ces entreprises qui disposaient de leur propre argent, ont pris des initiatives, tenté des innovations. Certaines ont bien réussi, d’autres moins.
Cet encouragement à la liberté et à la prospérité a suscité ce qu’on appelle le New Space, tout un monde d’entreprises, de toutes tailles, de Bigelow (les habitats gonflables) à SpaceX (Elon Musk) ou Blue Origin (Jeff Bezos), ou même à Stemrad (société israélo-américaine ayant conçu un gilet anti-radiations), qui ont leur projet propre, qui tentent de le réaliser et ne demandent rien à personne (autres qu’aux investisseurs privés qui veulent bien les soutenir). De temps en temps elles reçoivent un contrat de la NASA si cette dernière est intéressée. C’est tout autre chose que les entreprises, aussi bien aux États-Unis mais surtout en Europe, qui ne travaillent sur un projet spatial que sur commande (Boeing, Lockheed-Martin, Arianespace, par exemple). Autrement dit SpaceX n’a pas attendu que la NASA se lance dans le réutilisable pour le tenter.
En Europe, les entreprises qui travaillent pour le spatial sont bien sages et attendent les commandes (même si elles maintiennent la recherche à un haut niveau, en prévision de ce qui pourrait venir). Comme par ailleurs, l’ESA comme toute administration, freine des quatre fers devant le fantasque ou le non conforme à la ligne qu’on a toujours suivie, les mutations sont rares et lentes, les changements de paradigme impossibles. Pendant longtemps l’ESA, comme la NASA se sont moquées du réutilisable et maintenant l’ESA court derrière. Pour la NASA c’est un peu différent parce qu’elle se trouve dans un environnement New Space qui lui permet de bénéficier des innovations des autres (ce qui ne l’a quand même pas empêchée de se fourvoyer puis de s’enfoncer dans l’impasse Artemis, cet énorme machin dispendieux et inutilisable).
L’ESA a maintenant un programme Prometheus de moteur réutilisable et Themis de premier étage réutilisable mais c’est un peu tard car du fait de sa maitrise du réutilisable, dont elle est l’inventeur, SpaceX rafle tous les lancements et l’ESA ne peut compter que sur ceux qui sont imposés à ses clients pour des raisons politiques (en gros pourquoi choisir un lancement à 200 millions quand on peut en faire un à 100 millions2 ?).
De ce fait l’ESA se rabat sur des pis-aller. Le nouveau lanceur Vega ne peut que lancer de petites charges. Il en faut mais c’est jouer dans la cour de maternelle. Son lanceur moyen, Ariane 6 est une amélioration de l’Ariane 5 mais sans innovation majeure et notamment sans cette possibilité de réutilisation. Il ne volera qu’en 2023 et sera déjà démodé.
Du côté des vols habités, le dédain pour ce type de missions, de ce qu’on peut appeler l’establishment scientifique, a conduit à un retard considérable de l’Europe, impensable dans l’environnement New Space américain qui rêve d’astronautes sur Mars ou sur la Lune, ou de tourisme spatial. C’est le même esprit hautain et arrogant qui considère l’argent privé comme impur tant qu’il n’a pas été transmuté par un système fiscal et qui ne peut envisager de partenariat avec les manants du secteur privé qui doivent rester aux ordres.
Ce n’est pas comme cela que l’on progresse. Ce n’est pas comme cela qu’on maximise les fruits de la culture de l’intelligence humaine. Une entité seule, l’administration, peuplée de fonctionnaires ayant une carrière à gravir, qui n’ont pas l’esprit d’entreprise c’est-à-dire le goût du risque par nécessité d’être meilleur que la concurrence, et qui doivent seulement plaire à des supérieurs hiérarchiques ou politiques qui ont déjà réussi, ne peuvent se risquer dans une aventure qui pourrait être dommageable à leur administration (ou aux politiques qui les contrôlent et les sanctionnent) et donc à eux-mêmes.
Le spatial européen se trouve fortement handicapé par ce contexte et ce d’autant qu’il n’y a pas en Europe de grands entrepreneurs comme Elon Musk ou Jeff Bezos pour pousser, bousculer, inciter l’ESA. Nous ne pouvons compter que sur le hasard de l’arrivée au sommet de la pyramide de fonctionnaires un peu plus courageux que les autres ou tout simplement plus lucides sur la situation catastrophique où leur administration (en l’occurrence l’ESA) se trouve, comme Joseph Aschbacher, pour tenter de redresser la barre ou sortir de l’ornière.
Mais de toute façon, sans capitalisme privé et sans envie de la part des grands capitalistes européens (Bernard Arnault ou François Pineault ne s’intéressent pas à l’espace), le ciel restera le terrain de jeux des Américains. Il ne sert à rien de dépenser plus d’argent si c’est pour le jeter d’en haut d’une tour, dans le désert.
- L’ESA, European Space Agency est financée par ses 22 États membres (et quelques États coopérants), le principal contributeur étant l’Allemagne 23 % puis la France 18 % et l’Italie 16 %. Au cours du temps l’Allemagne a progressé en distançant aujourd’hui beaucoup la France, mais celle-ci continue à dominer la partie lancements avec Arianespace bien que cette prépondérance diminue également en raison de la concurrence de SpaceX ↩
- Les chiffres varient un peu selon les clients et les lancements mais cela donne un ordre d’idée. ↩


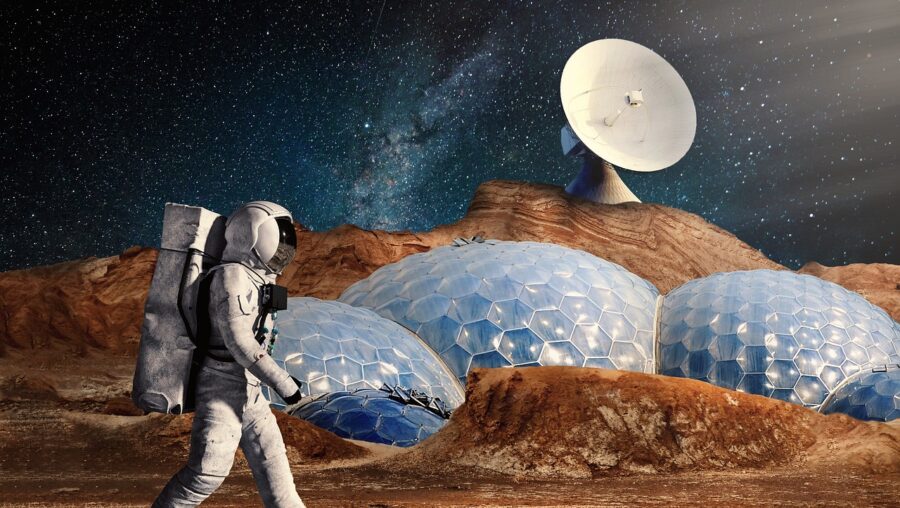


Approche intéressante, mais on ne va pas en char à voile dans l’espace. Il me semble qu’il serait plus pertinent d’envisager le problème en terme de service rendu. L’espace pour quel “usage” car les énergies mises en jeu sont considérables et les “moyens de lancement” doivent être optimisés pour une mission donnée. (lanceurs à plusieurs étages, simple, récupérable suivant l’éloignement). Si schématiquement, on peut classer ces opérations en observations scientifiques (météo, recherches), militaires (tout le monde aura compris que c’est de l’observation étatique) et commerciales (transmission de données : TV, internet etc..), qui paye ? et avec quel retour sur investissement ? Il ne faut pas oublier, que les propulseurs relèvent aussi de la recherche, sauf dans certains programmes “stabilisés”, les expériences avec la navette nous démontrent la complexité du transport spatial . Notre expérience perceptible au quotidien se réduit à l’usage du “GPS” et de la télé (TNT seulement) par satellite dont on bénéficie sans abonnement. Alors serions prêt a payer le véritable service rendu ? Si l’exemple américain semble pertinent quel risque de voir de plus en plus de groupes plus puissants financièrement que les états eux-mêmes ? Que penser des GAFAM ?
Les GAFAM sont pour moi une organisation aussi démocratique que les états. Le vote c’est l’achat. Sauf monopole, les consommateurs sont libres comme les électeurs le sont.
Si le dirigeant d’une des GAFAM veut dépenser son argent pour lancer des fusées, libre à lui; c’est son argent.
Le retour sur investissement peut-être lointain mais il y a d’autres investissements de ce type, par exemple le tunnel sous la Manche.
Merci de votre réponse, vous aurez remarqué que je me pose des questions sur la taille des entreprises. Alors jusqu’où va la liberté ? Par exemple que penser des remarques des astronomes qui “ronchonnent” contre les constellations starlink , rendant plus difficile leurs observations ? Que se passe-t-il quand des sociétés arrivent en situation de monopole avec une puissance financière plus importante que tout état ? Dans le domaine de l’espace qui est encore très jeune, une concurrence aura du mal à s’établir, le moyens devront être immenses et chaque domaine de vols a ses particularités. En fonction du commanditaire des vols, quelles seront les retombées ? Bien sur, il est évident qu’il y aura plus de valeur ajouté dans cette recherche que l’assistanat, c’est aussi une évidence qu’une gestion étatique sera toujours moins performante. Comme toujours, le problème des déchets est traité en dernier, mais on y arrivera. Et dernière question : en attendant une vraie concurrence faut-il réguler ? Je n’ai que des questions, n’ayant pas de boule de cristal et cherchant à comprendre.
Jusqu’où peut aller la liberté? Vaste question à laquelle il est difficile de répondre si ce n’est en redisant “jusque là où commence celle des autres”. Mais la limite reste, malgré tout, très floue.
Je suis opposé aux constellations car leur nuisance, notamment dans le domaine de l’astronomie, dépasse certainement le devoir de respect de l’autre imposé par la vie en commun sur une même planète. Dans ce cas les états réunis devraient pouvoir intervenir puisqu’il s’agit d’un sujet d’intérêt général qui ne peut être résolu au niveau des personnes privées, ni même d’un seul état.
Pour lutter contre les monopoles, un certain protectionnisme étatique en faveur de jeunes pousses peut être une solution temporaire en attendant qu’elles grandissent suffisamment pour résister aux prédateurs.
Le danger dans ces deux situations est bien sûr que l’état/le loup introduit dans la bergerie, ne se contente de manger les animaux malades. Comme dans beaucoup de situations il faudrait que les citoyens soient vigilants et interviennent pour modérer les ardeurs de l’état. Le meilleur moyen est me semble-t-il de réduire toujours au maximum les prélèvements fiscaux. L’excès fiscal constitue le plus grand danger. En effet il prive les hommes de liberté encore plus que la règlementation car il empêche l’initiative et l’innovation donc l’affaiblissement naturel des monopoles.
Le sujet est très délicat mais on peut dire que dans tous les cas, il vaut mieux plus de liberté que moins.
L’Etat s’apprête à “investir” 9 Mds. sur 3 ans dans le spatial (AFP ce matin). Une réduction de 9 Mds. sur 3 ans de la dépense publique ne serait-elle pas préférable ?
Tout dépend de l’intérêt que vous portez à l’espace. Il y a beaucoup de dépenses que je réduirais volontiers dans le domaine “social”. Je pense que développer un système de lancement modernes est plus porteur de richesses à venir que des allocations chômage ou familles nombreuses (ou autres de ce type).
Comme vous le dites plus haut, si un riche GAFAM souhaite financer des fusées, parfait. C’est cela qui devrait financer la recherche spatiale. Mais que d’autres économies soient encore plus prioritaires dans les dépenses publiques ne suffit pas à justifier de ne pas faire celle-là. N’en déplaise à certains chercheurs, la recherche scientifique financée par le privé est exaltante, celle financée par le public cumule tous les défauts de l’administration avec un mortel ennui.
L’ESA a plusieurs problèmes :
1) il faut savoir que cet institution est composée de fonctionnaires. Elle a 2 rôles. Le 1ier est d’éditer les normes spatiales définies conjointement avec les industriels. Le 2nd est la maîtrise d’oeuvre des programmes. Et pour tout cela, elle consomme 25% du budget des programmes qui sont alloués au spatial. Ce qui est énorme.
2) les États décident en fonction de leur contribution qui et quels industriels font quoi dans un programme spatial. Ainsi, A. Merkel avait imposé que l’Allemagne aurait la maîtrise d’oeuvre du satellite Galileo (GPS européen). Cela a eu pour conséquence de tripler le budget initial et l’ESA a du demander à ASTRIUM et à Thales d’envoyer des ingénieurs chez OHB (industriel allemand choisi par Merkel) pour l’aider à concevoir et fabriquer les satellites par un transfert de technologie (imposé par l’ESA sous la menace de ne plus se voir octroyé des programmes majeurs).
3) l’ESA a décidé de créer en Europe des PME qui seraient en compétition leurs de ses appels d’offres. Seul problème, pour rester compétitif techniquement et en terme de coûts, il faut assurer un marché permanent à ses entreprises. Et elle n’en a pas les moyens. Ainsi, l’expérience industrielle spatiale acquise sur un programme n’est pas reconduite sur le suivant puisque qu’une autre PME sera choisi et, à chaque programme, tout doit être ré-inventé par le nouvel industriel choisi.
4) enfin, impossible de voir en Europe apparaître des E. Musk ou J. Bezos. Ce sont des riches (pas comme les joueurs de football). Donc avant qu’ils ne le deviennent, ils seraient rackétés au nom de la lutte des classes.
Je suis bien d’accord avec vous. L’ESA souffre de toutes les maladies d’une administration internationale. Son efficacité déplorable en est la conséquence.
L’espace est par nature un domaine qui devrait être exploité par le secteur privé: prise de risque très importante car retour sur investissement très incertain. Malheureusement l’Europe n’aime pas les riches et les riches européens n’aiment pas l’espace. L’équation est écrite pour que ce ne soit pas l’Europe qui soit la locomotive dans ce domaine.