Durant des décennies, la droite a été considérée comme une. La montée en puissance du Front national devenu Rassemblement national, dans la seconde partie des années 1980, a modifié cette approche en mettant l’extrême droite en regard de la droite.
Petite(s) histoire(s) des droites
Ce premier paragraphe a largement été inspiré par Les grands textes de la droite et de la gauche ainsi que par Qu’est-ce qu’un méchant réac ?
Les divisions à droite sont anciennes, profondes et récurrentes. Les travaux historiques ont largement insisté sur la pluralité des droites en France, pour reprendre le titre du livre de René Rémond, Les Droites en France. L’historien insistait sur l’existence de trois familles structurant le paysage politique à droite depuis 1815 : les légitimistes (ou traditionalistes), les bonapartistes et les orléanistes. Pour Rémond, la famille nationaliste était considérée comme un avatar du bonapartisme.
Mais dans La Droite révolutionnaire. Les origines françaises du fascisme, 1885-1914, un ouvrage publié en 1978, Zeev Sternhell distinguait une quatrième droite : une droite révolutionnaire préfasciste indépendante de la famille bonapartiste.
En 2017, dans Histoire des droites en France de 1815 à nos jours, l’historien Gilles Richard distingue huit familles : les légitimistes, les orléanistes, les bonapartistes, les républicains libéraux, les nationalistes, les démocrates-chrétiens, les agrariens et les gaullistes.
On s’étonnera de l’absence des conservateurs mis sur la touche par les droites françaises elles-mêmes depuis la fin du XIXe siècle. Pourtant, ils constituent bien une neuvième famille.
Il n’existe pas aujourd’hui à droite de consensus sur la relation qui doit être établie entre nation et construction européenne, nation et mondialisation. Si le point de départ de l’histoire de la gauche est l’égalité, on ne peut réduire la droite à l’opposition à celle-ci. On a souvent vu les droites relever la tête dès l’instant où elles ont pu largement se fédérer autour d’un dirigeant, un chef doté d’un projet susceptible de transcender des clivages existants et d’apporter des réponses aux enjeux brûlants du temps.
Se présenter aux législatives, s’allier avec Zemmour, viser 2027…
Que va faire Marine Le Pen après son troisième échec à la présidentielle ?
Peu avant 20 heures, ce dimanche 24 avril, Marine Le Pen a appris sa défaite au second tour de l’élection présidentielle. Si la déception était palpable au moment de découvrir le résultat, lors de son discours, la candidate s’est toutefois félicitée d’un score historique. Comme le veut la tradition républicaine, celle-ci a reconnu sa défaite, en téléphonant à Emmanuel Macron, comme le révèle BFMTV, le mercredi 27 avril 2022. Après l’avoir félicité pour sa réélection, la candidate du Rassemblement national l’a prévenu que la prochaine élection présidentielle, en 2027, « sera très probablement la bonne pour elle ».
Marine Le Pen a déclaré qu’elle « mènerait la bataille des législatives aux côtés de Jordan Bardella ». À 53 ans, la dirigeante d’extrême droite veut prendre la tête de l’opposition, devant Jean-Luc Mélenchon.
Si les commentateurs s’interrogent sur ce que va faire Marine Le Pen en 2027, la vraie question est de savoir ce que la droite va faire de Marine Le Pen. Si celle-ci a su dédiaboliser son mouvement et lui donner un élan jusque-là inconnu, elle se heurte encore au fameux plafond de verre. Or, si Marine Le Pen a su se créer un prénom, le poids du patronyme pèse encore trop lourd, et le programme social-nationaliste du Rassemblement national (que l’on peut résumer en quatre mots : populisme, localisme, nationalisme, souverainisme) empêche une union des droites en développant un programme libéral.
2027 : l’instant Marion ?
La prochaine élection présidentielle sera-t-elle le temps de la recomposition autour de Marion Maréchal ? La Constitution interdira à Emmanuel Macron de se représenter. Si Marine Le Pen n’aura que 58 ans, il est difficile d’imaginer une quatrième candidature, ce qui sera également le cas de Jean-Luc Mélenchon, sans compter son âge.
Bref, dans cinq ans, l’absence du trio arrivé en tête en 2022 pourrait favoriser à droite une candidature unique autour de Marion Maréchal. Encore faut-il que celle-ci développe un programme libéral autour de trois axes calqués sur notre devise national :
- Liberté : respect de la propriété privée, libertés individuelles et publiques.
- Égalité (en droit) : méritocratie.
- Fraternité : solidarité nationale.
La nation doit être remise au cœur de la société française, notamment en ce qui concerne ses relations avec l’Union européenne.
L’État doit se recentrer sur les fonctions régaliennes (justice, police, santé publique, défense nationale) afin de diminuer la fiscalité tout en permettant le remboursement de la dette publique.
Les régions françaises doivent retrouver leurs limites territoriales d’avant la catastrophique réforme Hollande avec une autonomie renforcée.
Les initiatives entrepreneuriales doivent être favorisées avec une stabilisation de la fiscalité et une diminution des charges salariales.
L’équilibre libéral ainsi atteint serait une chance pour les Français, unis autour d’un chef charismatique.
Article publié initialement le 3 mai 2022.



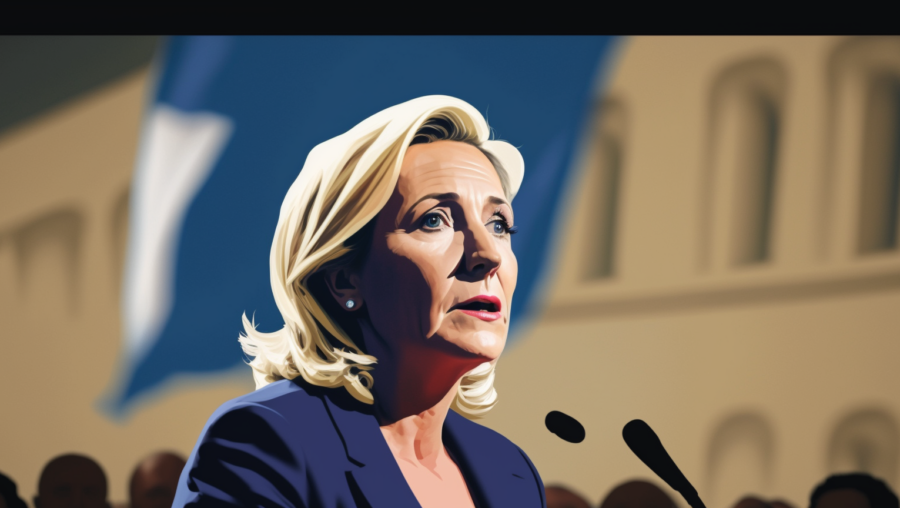

Je suis entièrement d’accord avec l’analyse de fond et sa conclusion conservatrice et libérale, le programme socialisant de MLP était un repoussoir pour beaucoup et n’offrait pas assez d’esprit de synthèse même si personnellement j’ai voté pour elle, faute de mieux et par esprit bêtement d’efficacité je l’avoue, la vie n’étant qu’une somme de compromis sans compromissions.
Repoussoir, le programme libéral-très conservateur de Marion Maréchal l’est bien plus que celui de sa tante.
Ses chances de succès ? A peu près celles de Zemmour, sur la même ligne qu’elle.
L’électeur qui en a vu d’autres se souviendra que la ligne du patriarche, qui lui aussi s’est rapproché de Zemmour, était pile celle-ci.
Ce sont les gros morceaux de social que Marine Le Pen a intégré dans son programme qui l’ont propulsée. Normal, elle a récupéré le vote ouvrier et apparenté, délaissé par la gauche caviar, langouste et quinoa.
Je suis oiseau, voyez mes ailes ; je suis souris, vivent les rats !
Sur un malentendu, ça peut le faire.
La bonne blague du plafond de verre :elle a d’abord servi à expliquer pourquoi le FN ne dépassait pas les 20 %, puis au fil des élections : les 25%,30%,35%,40%. Le plafond de verre est une vue de l’esprit, au mieux un plafond mobile…
Et le verre, c’est tellement fragile.
Pas d’accord avec l’ascension de Marion… ni de ceux qui l’ont soutenue. Ils ont voulu faire une OPA sur des électeurs. Or, par essence l’électeur n’appartient à aucun parti, même s’il ne vote pas comme on veut… la bourrique. Quant on voit les dégâts que ça fait, des électeurs gauchistes se sentant obligés de voter Macron. On voit bien là les limites d’une certaine Gauche, comme celles d’une certaine Droite… celle de Marion et au delà, car en réalité c’est vrai, elle pourrait ratisser très large. Mais voilà, son électorat ne lui appartient pas, pas plus que l’électorat “droitard” n’appartenait à Sarkozy, pas plus que l’électorat “gaucho” n’appartenait à Hollande… et pas plus que l’électorat “gaucho” n’appartient pas à Mélechon, un peu vieux certes, mais avec du temps devant lui pour s’en apercevoir !
Si droite = libéral, il n’y a plus de droite en France.
Le RN de marine est proche du parti NAZI, soit du socialisme nationaliste, le pire de tous les socialismes…
Zemmour aurait peut être été un peu plus au centre, mais dans les discours c’est toujours l’état qui fait, l’état qui contrôle l’économie: pas du libéralisme!
Peceresse: Se dit de droite mais l’est pas plus que Macron. Tous des gauchistes dégénérés dans la lignée de leurs prédécesseurs, mais en pire . C’est de la politique à la petite semaine pour esquiver les problèmes immédiats sans aucune vue d’avenir.
Un pays de droite c’est quand l’état s’occupe correctement du régalien et laisse le reste fonctionner tout seul sans intervenir. On en est très loin.
L’idée qu’un socialisme pourrait être pire qu’un autre, et donc l’autre moins pire que le premier, est contre-productive. Elle a conduit à la disparition de la droite. Comment la droite peut-elle renaître ? Certainement pas en désignant un ou des chefs charismatiques, mais en construisant un programme qui tienne debout tout seul, et qui puisse grâce à cette logique opposer une indifférence sereine aux coups socialistes et écologistes. La question du meilleur champion ou de la meilleure championne d’un tel programme, s’il apparaissait, est parfaitement prématurée.
Un pays de droite c’est quand l’état s’occupe correctement du régalien et laisse le reste fonctionner tout seul sans intervenir.
Ben non. Ça, c’est quand un pays est libéral.
La droite n’a pas besoin de boulet social puisqu’une moitié a déjà rejoint le pouvoir le plus socialiste que la France ait connu : le macronisme !
L’autre moitié a gobé toutes les mesures liberticides débiles et scandaleuses mises en place pendant le crise sanitaire et s’apprête à voter les suivantes si besoin.
Qui a fait des chèques à tout va et continue d’en faire ?
Qui a supprimé la taxe d’habitation pour une bonne partie des Français, qui sera en grande partie compensée par la taxe foncière des salauds de propriétaires ?
Qui a gouverné dans l’opacité la plus totale à l’aide de conseils scientifiques ou de défense ?
Qui n’y a rien trouvé à redire ?
Quelle candidate voulait enfermer les non vaccinés ?
Les réponses sont dans les questions. Ce n’est pas Marine Le Pen qui est responsable de la faillite morale et intellectuelle du parti LR !
Heureusement que le gouvernement actuel ne fait aucune proposition liée à ce programme “horrible” de “social nationalisme”… Oh wait… 🙂
Social-nationaliste… Quel dommage ! Echouer si près du point Godwin.
Très drôle !
Laurent Sailly a oublié d’évoquer les heures les plus sombres de notre histoire…
Pourtant les pétainistes ne sont pas forcément ceux que l’on croit.
Ce n’est pas non plus Marine Le Pen qui a décidé de réduire la part de l’électricité nucléaire pour plaire à nos amis Allemands.
“Un pays de droite c’est quand l’état s’occupe correctement du régalien et laisse le reste fonctionner tout seul sans intervenir” bien dit ! Et que chacun reste à sa place dans la société ! Si les pauvres sont pauvres et les riches sont riches c’est qu’ils l’ont bien mérité, ce n’est pas le problème d’un vrai Etat Libéral, qui doit se limiter au régalien.
Mince, on me dit dans l’oreillette que les pauvres votent… alors retour au vote censitaire pour éviter la montée de ce parti na.zi
(ps:2è degré.. on sait jamais…)
Vous auriez eu plus de succès au premier degré.
Si le socialisme faisait disparaitre la pauvreté ça se saurait!. Factuellement en pratique il en crée. C’est du nivellement par le bas sur le long terme.
D’autre part, Il n’est pas interdit au libéraux de faire du social, ils ont juste la liberté (et le devoir) d’aider les vrais pauvres, ceux qui méritent une aide et peuvent le faire beaucoup plus efficacement que l’état.
Rarement vu un article aussi hors-sol.
Les droites n’ont jamais été unies et ne peuvent pas l’être ; trop de différences idéologiques. Qu’y a-t-il de commun entre le RN et le libéralisme sans-frontiériste de LR par exemple ?
Le clivage droite/gauche est de toute façon en train de devenir obsolète.
Marion Maréchal est totalement démonétisée. Faisant preuve d’un manque de flair étonnant, elle a rejoint le Titanic Zemmour au pire moment et sans que personne ne comprenne pourquoi, y compris dans son entourage. D’autre part, son positionnement identitaire est clivant et elle est incapable de rassembler.
Si elle se présentait elle-même (et non pas sous la couverture de quelqu’un), je pense que ça changerait pas mal la donne… Car en débat et communication, elle déchire.
L état doit se recentrer sur les fonctions régaliennes ( justice ,police, santé publique, défense nationale).
La justice ne doit pas dépendre de l état, la santé publique non-plus.
Quand à la police et la défense nationale à la limite si elles sont sous le contrôle du parlement .
En Suisse un groupe de citoyens a obtenu le droit à un référendum pour l achat des avions Américains cela est déjà pas mal à mon avis.
Il y a de la houille dans le potage. Justice et santé publique… régalien or not régalien ?
Pour moi il n ya pas de houille dans le potage la justice doit être indépendante du pouvoir de l’état et confié à des juristes professionnels
De même pour la Santé doit être privée
Donc pour moi ils ne font pas parti du régalien
la justice fait partie intégrante du régalien au même titre que la sécurité intérieure et extérieure ainsi que la diplomatie
même aux USA la justice est bien insérée dans le système judiciaire fédéral bien que des élections locales existent pour les juges et les procureurs généraux
l indépendance comme la transparence relève de la pure utopie …… 😅😅😅
Le socialisme est populaire quand ça va mal, il cesse de l’être quand le chaos arrive. La droite s’est crue obligée de suivre les tendances écolo et étatiques de la gauche, or, sur ces registres, Macron et Marine sont mieux disant. En arborant un étendard atlantiste et libéral, elle n’aurait certes pas eu plus de succès immédiat, mais elle se serait placée idéalement au moment du chaos évoqué. Enfin, le suivisme poutinien ou la tiédeur ukrainienne des uns et des autres laissait une belle place en cas de déroute de Poutine, à cet égard, Zemmour et par suite Marion n’ont peut-être pas misé sur le bon cheval.
Atlantiste et libéral sont deux termes contradictoires. Les USA n’ont pas été capables de préserver les côtés libéraux de leur propre pays, et ils n’ont pas envie de les soutenir chez leurs alliés.