Les décisions de politique économique sont difficiles à évaluer. Ceux qui les proposent n’en montrent généralement qu’une face, celle qui correspond à l’objectif principal de la mesure. Or le point clé en économie est que toute décision à des effets multiples au-delà de celui recherché, et souvent antagonistes.
En premier lieu, un choix économique peut affecter le volume de production (donc de richesse) et la répartition de cette richesse. Les premiers correspondent à la “taille du gâteau”, les seconds à l’allocation des “parts du gâteau”. Évaluer si une mesure donnée constitue une “bonne mesure” économique, doit toujours viser à analyser les conséquences de cette mesure sur ces deux champs.
Les choix économiques
Or, la plupart du temps, les répercussions n’ont pas la même temporalité sur ces deux axes. Les décisions de partage peuvent être effectives très rapidement. Les politiques de soutiens publics mises en œuvre lors de la crise sanitaire illustrent bien ce point. Le “quoi qu’il en coûte” a permis de protéger les ménages et les entreprises (plus grande part du gâteau pour ces agents privés) en faisant porter le coût à l’État (part plus petite via l’endettement). Ces politiques de partage ont une deuxième caractéristique, c’est qu’elles sont à somme nulle. Une politique de partage, est donc toujours une redistribution avec des gagnants et des perdants (État/agents privés dans l’exemple précédent).
Un autre exemple est celui du chèque inflation pour les ménages modestes suite à la hausse des prix. À prix de l’essence plus élevé et taux de taxation inchangé, un tel chèque revient économiquement à augmenter le poids des taxes pour les classes plus aisées. Du côté de la “taille du gâteau” maintenant, la constatation de l’impact des mesures sur la création de richesse demande en général un temps long. L’objectif est en effet d’augmenter la productivité par l’innovation technologique, la connaissance et les progrès d’organisation. Par exemple, voir les impacts d’une réforme de l’Éducation nationale sur la qualité de formation et in fine sur l’employabilité et la croissance est l’affaire d’une génération. La mise en œuvre d’un environnement favorable à la relocalisation industrielle n’apportera d’effets significatifs que sur cinq à dix ans.
Créer et partager la richesse
On pourrait croire qu’il est plus important de créer de la richesse que de la partager. En réalité, les deux sont importants.
D’une part, les deux effets ne sont pas indépendants, par exemple une société trop inégalitaire peut limiter la création de richesse à long terme (sous consommation) et à l’inverse trop égalitaire peut limiter l’investissement (moindre incitation au risque).
D’autre part, la prise en compte du court terme est une condition du maintien de la cohésion sociale (aide aux ménages impactés) et de conservation du tissu productif (soutien de entreprises).
Enfin, toute décision a des effets de second tour, des conséquences qui n’apparaissent qu’après ajustement du comportement des agents à la mesure et susceptibles d’aller à l’encontre de l’objectif initial (l’endettement de l’État, du quoi qu’il en coûte sera remboursé un jour par les ménages et pèsera sur leur consommation) ou présente des effets négatifs sur un autre champ que celui visé (la protection des ménages contre l’inflation énergétique est socialement juste mais s’oppose à un autre objectif, celui d’augmenter le prix relatif de l’énergie carbonée dans le cadre de la lutte contre le réchauffement).
En conclusion, rien n’est simple en économie, aucune action ne peut être évaluée sur le seul champ qu’elle vise initialement, et tout changement a des rétroactions sur l’ensemble du système. Choisir une politique économique c’est donc peser ces perturbations d’équilibre et faire des choix dont aucun n’est parfait mais qui reflètent à la fois une hiérarchie des priorités et une vision des effets dans le temps.
Aussi, devant chaque proposition de politique économique, nous devrions nous poser les questions suivantes :
- Est-elle susceptible d’augmenter la richesse globale dans 5 ou 10 ans ?
- Comment transforme-t-elle le partage des richesses à court terme (gagnants et perdants) ?
- Comment les deux effets interagissent-ils, en s’amplifiant ou s’annulant ?



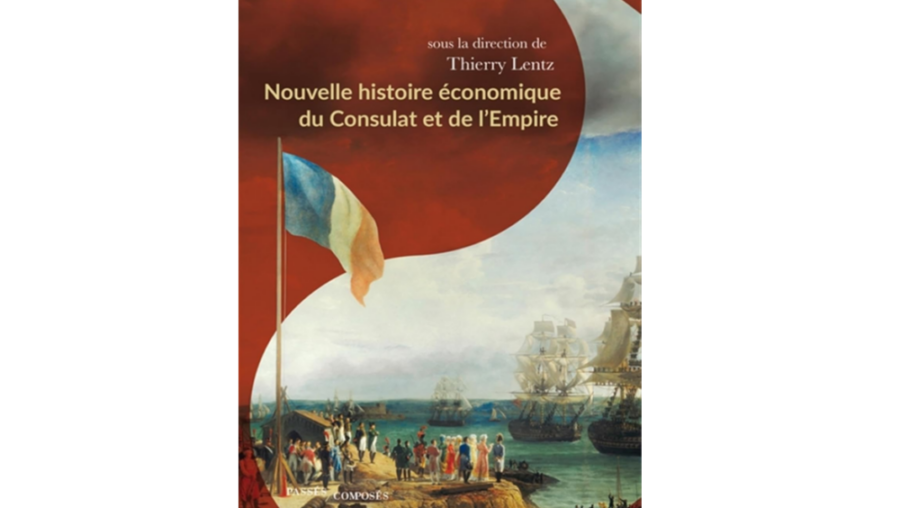
L’auteur ne semble pas maitriser les fondamentaux de l’économie :
– “le partage est un jeu à somme nulle “: non ! il diminue les incitations productives de ceux qui sont imposés (victime) de ce partage, et donc le gateau diminue, le libre arbitre existe.
-une société trop inégalitaire peut limiter la création de richesse à long terme (sous consommation) : vieille antienne marxiste qui présuppose que les différences économiques sont à l’origine de troubles sociétaux, et vieille rengaine keynésienne qui confond la consommation avec la croissance.
etc etc etc …
La mention “à somme nulle” est effectivement elliptique et s’entend “localement “, j’explique dans la suite pourquoi ce n’est pas le cas en réalité.
Les vieilles antiennes méritent parfois une visite de courtoisie (critique certes) en l’occurrence elles sont plutot keynésiennes (propension à consommer). Les papiers faisant le lien avec la croissance sont faciles à trouver.
Si l’impression de monnaie permettait de réellement augmenter la taille du gateau, comment cela se fait-il que les privés ne peuvent pas aider le gouvernement à imprimer la monnaie avec leurs imprimantes?
Bizarre, non?
Donc en fait le partage du gateau n’est en réalité qu’un minable vol de la propriété d’autrui.
Aujourd’hui, on revient sur la promesse monétaire à long terme, mais demain la même équipe reviendra sur la promesse de nationalité ou se taira sur la misère des retraités soumis à une inflation annuelle de 10%, à 10% cela roxe, croyez moi.
Une fois le gateau partagé, c’est l’esclavage qui attend les con.vives.
« Aussi, devant chaque proposition de politique économique, nous devrions nous poser les questions suivantes »
– pourquoi ne sépare pas t’on pas l’Etat de l’économie ?
– de quoi devraient se mêler les hommes du gouvernement ?