Par Frédéric Mas.
Les sciences sociales ont en général un biais positif en faveur de l’administration, qui est pour beaucoup synonyme d’efficacité et de modernité. Ainsi, c’est devenu un lieu commun de décrire la modernisation de l’État, après Max Weber, comme un processus de rationalisation. Unifier le centre de décision et ses différents services d’application en un seul corps régi par des procédures précises et la hiérarchie semble garantir à la fois la production et l’efficacité des décisions prises.
Seulement, ce préjugé en faveur de l’administration comme procès de rationalisation est contesté 1, et la science économique récente lui a même adressé une critique forte en proposant de décentraliser et d’introduire la concurrence institutionnelle dans la gestion des biens publics.
Centralisation et ordre polycentrique
En effet, à travers ses études empiriques sur les biens publics municipaux, l’économiste et prix Nobel Elinor Ostrom a soutenu que l’efficacité de l’administration publique n’était pas liée à son degré de centralisation et de consolidation, mais résulterait d’un processus polycentrique sous-produit, dont les acteurs sont les communes locales. En effet, celles-ci seraient en compétition pour attirer de nouveaux résidents, proposant biens et services publics contre des impôts locaux et des rémunérations.
Ce qui semble du point de vue d’un administrateur rationnel moderne totalement chaotique est en fait un processus organisé d’économies locales qui émerge grâce à la participation conjointe des communautés locales et des citoyens. Les mécanismes décentralisés qui assurent le bon fonctionnement des échanges génèrent ainsi une offre beaucoup plus adaptée aux demandes des citoyens au quotidien. Inversement, la centralisation bureaucratique de l’administration dans la gestion de cet écosystème économique municipal tend à empirer les choses.
Ostrom a observé que cette différence de conception des gouvernances locales par l’administration réapparaissait avec les mêmes résultats une fois appliquée au problème, bien connu en économie « des communs ».
Pas de tragédie des communs
Les ressources communes dans un environnement rural, qu’elles soient forestières, en matière d’irrigation ou de pêche, sont comparables à la gestion des écoles, de la police et des services publics dans l’environnement urbain des collectivités locales : les efforts des experts pour centraliser l’administration des ressources débouchent sur des problèmes de mauvaises allocations liées à l’impossibilité de créer les conditions du calcul économique, à rassembler les informations dispersées au sein de la société et à prévenir l’influence destructrice des groupes d’intérêt au sein de la structure2.
Inversement, en se concentrant sur la manière quotidienne de faire des acteurs de base pour transformer les situations potentiellement conflictuelles en opportunités pour coopérer, les époux Ostrom ont montré que les individus confrontés aux problèmes de ressources communes n’étaient pas victimes de la tragédie des communs : au contraire, pour éviter le conflit, ils réussissaient à transformer l’occasion en opportunités pour créer des normes adaptées en vue d’assurer leur bonne gestion et une coopération pacifique.
En conclusion, nous pouvons reprendre la leçon que Peter Boettke retient des travaux d’Elinor Ostrom dans son livre Living Economics. Les individus sont les mieux placés au niveau local pour connaître les règles et les actions les plus adaptées à leurs intérêts afin d’éviter les conflits et entretenir la coopération sociale qu’une administration lointaine, centralisée et déconnectée des réalités quotidiennes de ses administrés.
- Ostrom, Elinor, Governing the commons : The evolutions of institutions for collective action, New York, Cambridge Univ. Press, 1990.
Un article publié initialement en juillet 2016.

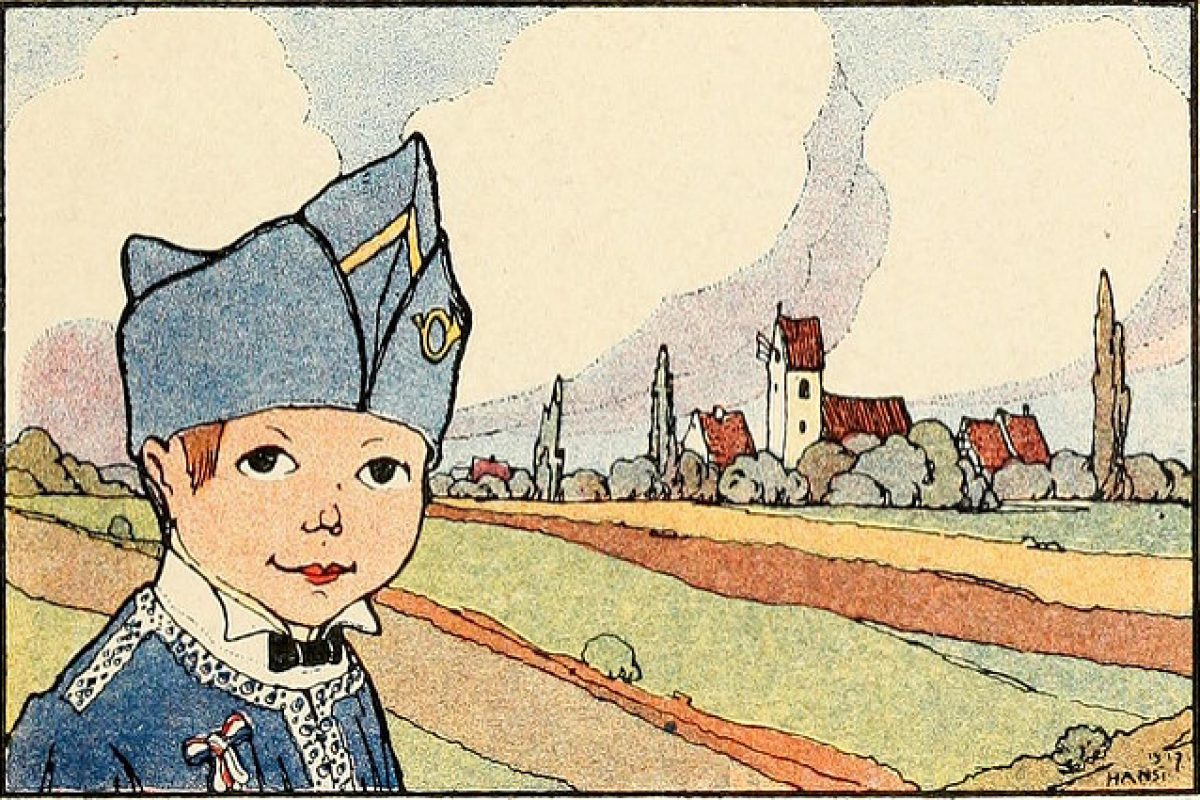



Je reprends la conclusion:
“Les individus sont les mieux placés au niveau local pour connaître les règles et les actions les plus adaptées à leurs intérêts pour éviter les conflits et entretenir la coopération sociale qu’une administration lointaine, centralisée et déconnectée des réalités quotidiennes de ses administrés.”
Cette conclusion comporte une vérité et un non dit. Le risque est que le non dit soit dans la réalité plus fort que la vérité affirmée.
– La vérité c’est que la proximité permet l’efficacité du fait de l’interaction proche. C’est le principe de subsidiarité chérie des libéraux.
– Le non dit c’est qu’il n’existerait QUE des interactions de proximité.
Ainsi la conclusion serait totalement vrai si nous ne vivions uniquement dans des villages ou villes réduites n’ayant pas de relations ou de projets entre eux. Sinon nous dépassons le niveau de complexité “local”.
La problématique qui n’est pas abordée par l’article est donc; comme avoir l’efficacité de l’interaction du proche et la coordination du lointain. Et là nous revenons à notre triste réalité si loin des principes et idéologies car je ne crois pas que l’on ai jamais résolu correctement cette problématique.
Une piste serait que le lointain ait une écoute attentive du proche, et inversement.
Avec une centralisation excessive on empêche de toute manière au proche de gérer de la meilleur façon qui soit ses problèmes (le proche étant mieux à même de connaître ses problèmes et les solutions à y apporter). Donc on tombe dans un certain dirigisme que le proche risque de refuser, donc qui risque de créer des problèmes à l’ensemble (proche et lointain).
On pourrait y voir un lien avec les problèmes que nous avons actuellement en Europe où un pouvoir centralisé impose aux “proches” leur manière de gérer leurs problèmes sans vouloir écouter le proche, mais aussi sans avoir réellement conscience des réalités du proche.
Après le problème est bien sûr complexe, mais l’article reste pertinant.
L’article est pertinent mais il est théorique. C’est aussi le cas de votre piste qui n’est que l’esquisse d’une solution que personnellement je ne connais pas.
Car en effet dans la “vrai” vie il y a des complications, je vais en présenter deux.
Dans l’article on oppose le proche efficace et le lointain centralisateur. Sauf qu’il y a un continuum et le proche d’un certain niveau est le lointain du niveau inférieur.
Ainsi pour reprendre votre exemple de l’Europe.
– La Grande Bretagne (proche) rejette l’Europe centralisatrice.
– Mais l’Écosse (Proche) rejette les décisions de Londres (Centre)
– Et les iles Orcades qui dépendent de l’Écosse ne sont pas sur la même ligne que Édimbourg etc…
On le voit il n’ y a pas juste un centre et un proche mais une structure fractale où le proche peut être le centralisateur de plus petit tout en rejetant la centralisation de plus gros que lui.
Autre problème comment gérer la relation proche/centre dans une structure comme Pekin ~20 millions d’habitants soit 4 fois le Danemark ? En tant que ville Centre de la Chine elle est elle même un monde, peut elle vivre sans une structure centrale ? Si oui quel est le proche pertinent pour gérer les communs ? le quartier ? la rue ? Peut on construire un système de commun (transport ou d’assainissement) ainsi ?
Depuis la nuit des temps les empires s’écroulent de leur contradictions centralisatrices mais tout aussi bien depuis aussi longtemps les hommes tentent de mettre en place des structures politiques énormes et centralisatrices pour résoudre certains problèmes.
Les deux forces centrifuges et centripètes coexistent et je ne sais pas si un jours elles pourront atteindre un équilibre harmonieux et durable.
Tout à fait, un proche peut devenir lointain et inversement. Mais la problématique reste la même.
Comme évoqué dans l’article, un principe de coopération en place d’un principe d’opposition permet de réduire les conflits entre groupes sociaux antagonistes (c’est d’ailleurs le seul moyen). Donc dans notre cas de favoriser l’entente entre le proche et le lointain. En revanche, un trop grand dirigisme va dans le sens d’un principe d’opposition, donc voué à l’échec sur le long terme. Une bonne coopération permettra aussi de mieux résoudre les problèmes dont vous parlez dans la suite de votre commentaire. Via une meilleurs “entre connaissance” des acteurs en jeux, ils devraient être mieux à même de savoir quelle niveau de subsidiarité adopter en fonction du problème.
La théorie se bornera donc à soulever les problèmes qui empêchent ce principe de coopération … et ils sont nombreux. On pourrait citer une trop grande homogénéisation des groupes décisionnaires (ce qui freine l'”entre connaissance” des acteurs impliqués face à un problème donnée, les classes dirigeantes ayant par exemple une faible connaissance des problèmes et de la réalité du peuple et inversement), mais il y en a bien d’autres :
http://www.contrepoints.org/2016/03/08/241993-ce-que-trump-nous-apprend-sur-les-surprises-strategiques
Une fois l’ensemble des problèmes qui ralentissent ce principe de coopération (d’où découlera naturellement une meilleur subsidiarité grâce à une meilleur prise en compte du proche par le lointain), la théorie devrait permettre de réfléchir à la mise en pratique des structures adéquats pour faciliter ce principe de coopération (via une écoute attentive du proche par le lointain et inversement … entre autre).
Là encore le problème de la mise en pratique est complexe, mais dépend de la théorie qui aura su soulever les bons problèmes à la racine. Mais étant donnés les nombreux problèmes qui empêchent une bonne coopération (notamment certaines structures actuelles qui nous poussent vers un principe d’opposition), il y aurait de nombreux points à améliorer dans notre système.
je doute un peu..
il me semble que la bonne gestion des commun résulte d’abord d’un vaste consensus sur ce que signifie bien gérer les dits communs…
la réalité est que le malheur des uns fait le bonheur des autres…
la notion de bien commun..fait écho à celle d’interet général…prenons le climat!!! la biodiversité..
gérer pacifiquement “les nuisances faites aux autres” me semble beaucoup plus pragmatique.
nuisances acceptables..ou inacceptables..
circonstanciel et reposant sur la force et donc en démocratie le nombre..
Excellent article, merci.