Par Karl Eychenne.
La Covid n’en finit pas de remettre à demain tous nos projets. Nous voilà incapables de nous projeter au-delà d’une rentrée, qui s’annonce animée. La parenthèse Covid sera donc bien plus longue que prévue, et bien plus dommageable aussi. Et pourtant, imaginer un futur désirable nous impose d’anticiper demain. Nous voilà donc confrontés à trois types d’épreuves :
- Les économies vont-elles pouvoir rebondir, alors même qu’elles sont encore groggys ?
- Les autorités vont-elles pouvoir réaliser les miracles annoncés ?
- Les marchés vont-ils pouvoir faire encore longtemps comme si de rien n’était ?
Des PIB attendus au tournant
Même si l’impact de la Covid dépasse la simple mesure d’un PIB, cette dernière propose quand même une idée de la déflagration subie : elle est dramatique. Les PIB ont chuté de plus de 10 % depuis le début de l’année (-15 % pour la zone euro), alors qu’ ils auraient dû croître de 0,5 à 1 % selon les pays. Pour mémoire, la crise des subprimes en 2008 n’avait provoqué qu’une baisse de près de – 4 % à – 6 % cumulée sur près d’un an.
Côté demande, ce sont la consommation des ménages et l’investissement des entreprises qui ont été les principaux artisans de cette baisse du PIB, alors que la hausse des dépenses gouvernementales a limité la casse.
Côté offre, la baisse du PIB s’explique essentiellement par l’emploi avec l’effondrement de la quantité d’heures travaillées (chômage partiel ou total) ; d’un autre côté la productivité du travail a résisté mais devrait subir plus tard des effets négatifs du fait de la baisse de l’investissement.
Des PIB ragaillardis dès ce trimestre ?
On nous parle d’un rebond formidable des PIB américain et européen de près de 10 % attendu au troisième trimestre, déjà perçu dans les indicateurs avancés. En effet, la confiance des industriels est déjà revenue sur ses niveaux d’avant crise, malgré une rechute récente en zone euro.
Par contre, la confiance des consommateurs reste engluée sur ses plus bas niveaux, bien plus affectée par l’incertitude sur l’évolution de l’emploi. Globalement la lecture est quand même encourageante, les indicateurs avancés les plus pertinents anticipent bien un rebond important du PIB ce trimestre, toutefois insuffisant pour rattraper le temps perdu : il faudra encore quelques trimestres, voire années pour combler le retard.
Enfin, il faut aussi rappeler que ces mêmes indicateurs n’avaient pas prévu une telle chute au deuxième trimestre, ni eux ni des outils plus fins de type Machine Learning d’ailleurs : et pour cause, ces outils se nourrissent du passé, et le passé Covid n’existait pas encore.
La nouvelle cartographie du réel
Avides de certitudes, nous cherchons à savoir si les PIB sont déjà bien en train de rebondir. Plutôt que d’attendre la publication de fin de trimestre, les nouvelles technologies de l’information permettent un marquage à la culotte de notre quotidien : ainsi, Apple et Google produisent quotidiennement des indicateurs qui tracent nos activités dans tel ou tel domaine.
Ces indicateurs nous proposent alors de découper le réel d’une autre manière que celle proposée par les marqueurs traditionnels, et surtout de le faire presque en temps réel. Si l’on croit ces indicateurs, alors les PIB seraient bien en train de rebondir, mais peut être pas aussi vite qu’escompté.
D’ailleurs, ces indicateurs auraient de fortes affinités avec les fameuses courbes Covid elles aussi publiées quotidiennement : une chute de l’un (indicateur d’activité) serait corrélée à une hausse de l’autre (nombre de décès).
Des politiques toujours plus extravagantes
Dans le monde d’avant, les autorités semblaient faire preuve d’une complaisance éclairée envers le cycle économique et les marchés. Les politiques monétaires flirtaient avec les taux trop bas, mais pas trop.
Les politiques budgétaires surfaient sur des taux d’endettement trop élevés, mais finalement supportables. Mais les coups de boutoir des crises successives dispensent désormais de toute modération. Aujourd’hui, le soutien des politiques est infini, durablement et quantitativement.
Quelques chiffres ? Les taux d’endettement des États s’établissent désormais à plus de 100 % en moyenne, ayant fait un bond de près de 15 % en une année seulement. Pour mémoire, la crise des subprimes provoqua une hausse de l’endettement de près de 30 %, mais sur une période de près de 8 ans.
Du côté des politiques monétaires, on casse tous les codes avec des taux directeurs proches de 0 % et des rachats d’actifs massifs gonflant les bilans à plus de 30 % du PIB. Toutes ces politiques sont extravagantes certes, mais dans un monde sans inflation c’est pas grave, et dans un monde en crise, c’est pour la bonne cause.
La dette c’est chouette
La dette à taux bas ne se refuse pas, nous serions bêtes de nous en priver. Surtout quand celui qui nous prête (Banque Centrale) a le pouvoir de prêter encore et toujours, voire nous dispense de faire défaut (dette éternelle), mieux encore nous assure qu’il s’agit d’un jeu à somme nulle (la Banque Centrale appartient aux États). Ainsi, nous aurions signé pour une extravagance à durée indéterminée.
Aujourd’hui, le scénario le plus probable est que nos États tapent dans la caisse Banque Centrale plutôt que dans celle des agents économiques. Les critiques diront qu’il s’agit d’un tour de passe-passe : on tape sur la génération future plutôt que sur la génération présente. Les autres diront qu’« il vaut mieux une bougie que maudire l’obscurité » (Lao Tseu).
À la recherche de Babar
Quelqu’un a-t-il la solution au problème posé ? Depuis quelques années maintenant, il est dit que nos autorités, d’où qu’elles viennent, auraient quelque peu perdu de leur superbe : « d’un magistrat ignorant, c’est la robe qu’on salue » (La Fontaine).
Résultat, nous sommes à la recherche de celui qui aurait la science infuse, un genre de monsieur Teste qui serait alors démasqué, ou alors carrément le roi Babar « seul monarque éclairé capable de conjuguer les bonnes idées et de faire autorité » (F. Sureau : L’or du temps).
Mais Babar n’existe pas. Ainsi, le seul espoir est que l’on cesse d’avoir « de la cire dans les oreilles » (Kant), et que nos autorités se livrent alors à une forme de casuistique économique (A. Supiot : homo juridicus) afin d’espérer voir émerger la juste action à mener.
Seuls les marchés semblent faire preuve de retenue
Ils nous avaient pourtant habitué à sur-réagir à tout et n’importe quoi. Mais les performances ne mentent pas : les marchés d’actions et d’obligations ne semblent pas avoir une vision aussi nébuleuse de la situation que celle que nous percevons.
Mieux encore, au plus fort de la crise en avril, leurs performances se sont révélées plus mesurées que la chute des indicateurs avancés qui survint alors : on peut vérifier cela d’une manière assez grossière à l’aide de simples graphes, ou de manière plus fine à l’aide d’analyses statistiques (analyse en composantes principales).
Évidemment, les traces de la Covid sont quand même perceptibles : ainsi l’or et l’emprunt d’État américain, actifs refuges par excellence, enregistrent des performances à deux chiffres. Mais les marchés d’actions américain et chinois ne sont pas loin, signe que l’aversion au risque ne rase pas tout sur son passage.
De l’optimisme des marchés
Le problème avec ces niveaux de marchés qui paraissent optimistes c’est que même s’ils ont raison, on ne saura jamais si c’était pour de bonnes raisons. Quelle importance, je sais, puisque les marchés ont toujours raison… Mais poursuivons : on ne saura jamais si ces niveaux optimistes reflétaient alors un discours raisonné ou complètement farfelu.
Les prix étaient-ils à ces niveaux par anticipation ou par hasard ? Le prix est équivoque par construction ; lorsque l’on teste l’hypothèse d’efficience des marchés, on est obligé d’embarquer aussi l’hypothèse du modèle d’évaluation choisi par l’investisseur. Et si vous trouvez que les niveaux actuels sont trop élevés, il y a alors deux possibilités : soit les marchés se trompent de scénario, soit vous vous trompez de modèle (hypothèse jointe de Fama).
Une rentrée sereine, a priori
Curieusement, cette rentrée ne devrait pas changer grand-chose, surtout après le discours de Jerome Powell nous promettant des taux bas jusqu’à preuve du contraire, comme nouveau régime de croisière. Et si l’inflation ou l’emploi nous envoient un jour des messages de surchauffe ?
Il ne faudra plus y prêter attention puisqu’ils ne nous alertent plus pour de bonnes raisons : l’emploi et l’inflation sont désormais des faux positifs, comme ces personnes testées malades mais pas malades. Dans ce monde à taux bas, les marchés d’actions et du crédit pourraient voir l’avenir plus sereinement.
Certes, les bénéfices se sont effondrés, ce qui crée mécaniquement l’illusion que ces marchés sont surévalués : les PER atteignent des niveaux dignes de la bulle tech de 2000. Mais en supposant que ces bénéfices retrouvent une partie de leurs pertes en 2021, et que les taux restent aussi bas, alors les marchés d’actions et du crédit en deviendraient presque attractifs…


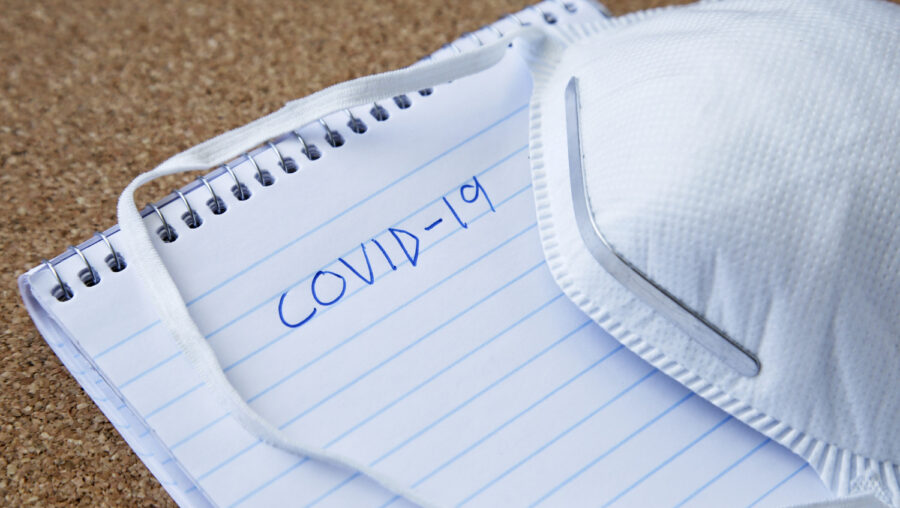


C’est pas la rentrée qui est hors sol. Ce sont les “vacances” qui étaient hors sol.
Une baisse de pib n’a rien de dramatique, on échange moins mais sans doute que l’on échangeait trop avant pour des choses non essentielles. Ne plus aller au cinéma, quelle baisse de niveau de vie ? Zéro.
OK cela signifie qu’il y aura moins d’emplois ou autant mais moins cher payés… Ce n’est pas plus mal que les pays riches se rapprochent des pays pauvres, sans doute qu’ils pourront enfin relocaliser les emplois peu rémunérés pour nos bacs à sable.
Avoir de l’épargne qui ne sert à rien, ce n’est pas top non plus.
Cette épargne peut financer l’économie…mais celle ci est à l’arrêt car tout est fait pour qu’elle y soit.
Et ce n’est pas en imposant des contraintes ubuesques que l’on rétablira la confiance qui est la base.
Une baisse de PIB n’a rien de dramatique, on échange moins mais sans doute que l’on échangeait trop avant pour des choses non essentielles. Ne plus payer d’impôts, quelle baisse de niveau de vie ?
Je ne sais pas pour vous mais partout je vois la mer qui se retire (chômage plus ou moins partiel , licenciements, perte d’activité chez les employeurs, jeunes en phase de stress intense pour trouver une alternance, un job ) et dans 1 à 3 mois, le tsunami, il va y avoir de la casse.
Je ne sais pas quel est l’avenir dans 1 ou 3 mois, mais ce qui m’étonne toujours c’est la capacité des politiques a rester droit dans leur bottes.
Est-ce inné ou cela fait-il partie de l’enseignement à l’ENA ? Est-ce une vertu comme pour un militaire ou une déviance ? Au delà de la communication “rassurante”, j’y vois surtout une conviction que leur “fonction” est plus importante que leur “responsabilité”, qui se transforme rapidement et naturellement en : “leur carrière est la seule chose qui compte”.
Donc au final, il ne faut pas compter sur les politiques pour innover, être pragmatique ou reconnaître leurs erreurs. Pas tant qu’ils considèrent que : “ils sont la Frrrance” et que contrairement aux militaires ils n’ont jamais de compte à rendre.
@Alan c est surtout que la crise qui arrive est pour eux une figure théorique, des tableaux de chiffres , des index, un événement qui n integre aucune de leurs réalités personnelles.
Le gouvernement : ce sont les fauteurs de troubles les responsables !