Par Florent Ly-Machabert.
La première école de Chicago vit le jour dès les années 1930 et fut marquée par le courant institutionnaliste (Millis), les économistes du travail (Nef) et ceux des finances publiques (Wright et Leland), mais également par l’émergence, à la même époque, de la spécialité économétrique (dont un homonyme, Henry Schultz, fut l’un des pionniers) ; Knight et Viner incarnèrent incontestablement les figures de proue de la phase de transition que connut ensuite cette école dans les années 1940 et 1950 vers l’enseignement très approfondi de la théorie néoclassique des prix, dans un esprit d’éclectisme qui ne cessera jamais de souffler sur cette Université. La nouvelle école de Chicago, quant à elle, née à la fin des années 1960, dut beaucoup à la personnalité d’un économiste américain qui allait partager en 1979 avec Arthur Lewis (dont les thèses hétérodoxes lui sont pourtant diamétralement opposées) le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel « pour son travail de pionnier en économie du développement » : Théodore W. Schultz (1902-1998).
Intérêt pour la recherche agricole
Si Lewis fit du développement du secteur secondaire le moteur de l’économie, Schultz, en revanche, insista sur l’essor du secteur primaire, faisant déjà du capital humain – ici la recherche agricole – et ce bien avant Gary Becker, un élément clef de la croissance économique, comme il l’expliqua dans un article magistral publié dès 1959 dans la Social Service Review (Investment in man : An economist’s view. ) critiquant la fonction de production alors plébiscitée (dite de Cobb-Douglas).
Il allait récidiver en 1972 avec Investment in human capital, cette fois contre les thèses développées en 1968 par le Suédois Myrdal deuxième manière1 dans sa contribution très pessimiste quant aux perspectives de développement de l’Asie du Sud-Est (Asian drama : An inquiry into the poverty of nations), défaisant par là le modèle de croissance d’Harrod-Domar, pourtant standard à l’époque, fondé sur l’accumulation d’un capital, certes, mais physique. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre, sous sa plume, que « l’oubli du capital humain biaise l’analyse de la croissance économique », ou bien encore que « l’investissement qui améliore les capacités des gens crée des différences dans la croissance économique et dans la satisfaction vis-à-vis de la consommation2 ».
L’Amérique de Schultz
Naturellement, Schultz ne fut jamais dans la posture. S’il s’opposa aux modèles de son temps, c’est pour donner à voir un paradoxe courant : une surévaluation du prix des terres agricoles et une sous-estimation du capital humain.
L’Amérique de Schultz fut aussi celle de la Guerre froide : face à la menace communiste, face aux réformes agraires chinoises par exemple, sa réflexion allait favoriser l’introduction des variétés à haut rendement (VHR) qui seraient progressivement généralisées par l’ONU et la Banque mondiale dans le cadre de révolutions vertes qui allaient courir du Mexique aux Philippines en passant par l’Indonésie.
Dans la lignée d’I. Fisher, Schultz rediscuterait ainsi audacieusement la notion de capital en distinguant le « détour de production » (qu’Hayek théorisa avec brio pour la branche autrichienne) du « capital comme allocation du temps », préfigurant ici les travaux beaucoup plus populaires de Gary Becker3.
La valeur de la connaissance
Il fut l’un des premiers économistes à donner à la connaissance une valeur économique singulière, qui tombe sous le sens de nos jours. Dans les traces du grand théoricien hétérodoxe de la deuxième école de Vienne, J. Schumpeter et contre la doxa keynésienne de l’époque, il n’eut pas peur d’affirmer qu’il ne saurait y avoir de croissance sans déséquilibre, la libéralisation agricole en Chine au début des années 1980 lui donnant raison.
Enfin, une dizaine d’années avant que Buchanan ne fût nobélisé (1986), Schultz montra que l’enjeu du développement économique à travers le monde répond aux règles d’un véritable marché politique, tant au Nord, où la puissance du lobby agricole conduit à surestimer les produits de la terre, ce qui ne manque pas en général de provoquer de graves crises de surproduction4, qu’au Sud, où la domination des industriels ne permet pas la juste rémunération des agriculteurs, ce qui dégénère le plus souvent en sous-production.
Schultz d’actualité
Aussi une relecture attentive de l’œuvre de Théodore W. Schultz pourrait-elle encore éclairer d’un jour un peu neuf des questions aussi diverses et contemporaines que les crises agricoles dans le monde (par exemple celle du lait pour n’en citer qu’une, bien récurrente hélas en Occident), les politiques éducatives face à la sélection par l’échec dans les études supérieures, ou bien encore la place de l’innovation et de la formation des adultes pour relever les défis d’une économie bien incertaine.
(Article initialement publié le 24 janvier 2018)
- Myrdal, dans les années 1930, était davantage préoccupé par la modernisation du traitement traditionnel (par Wicksell) de la question de l’équilibre monétaire. Sa contribution majeure à l’époque s’intitule d’ailleurs L’équilibre monétaire (1931) ; co-récipiendaire du prix Nobel 1974 avec F. Hayek. ↩
- In « Investment in human capital ». ↩
- Par exemple, A theory of allocation of time (1965). ↩
- Qu’aggravent les dispositifs de planification économique de l’UE de type Politique Agricole Commune (PAC). ↩


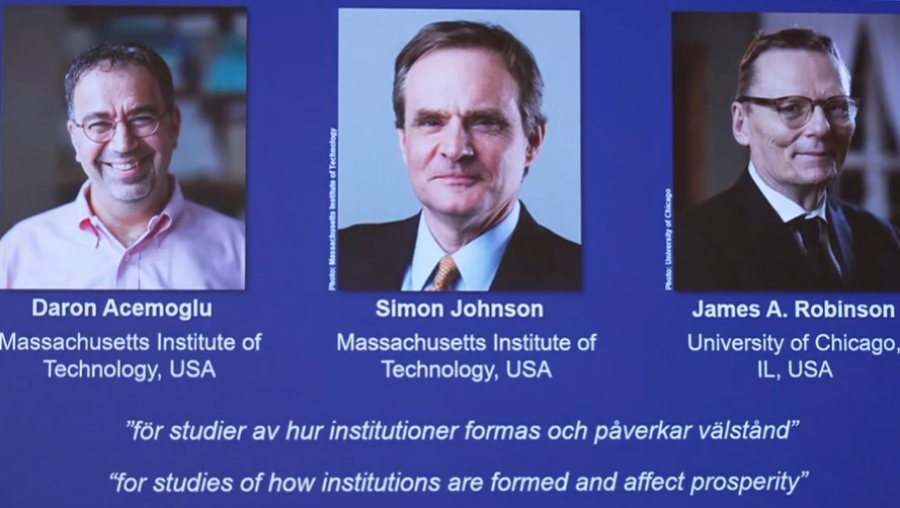
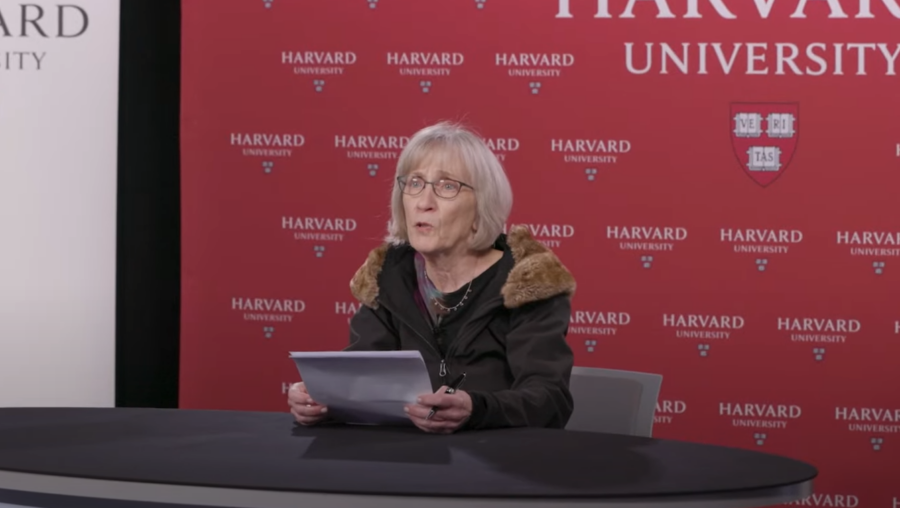
Cette idée du capital humain été deja assez bien développée par J.B Say au 18ème siècle. Il le considère comme un des 3 fonds productifs de valeur et donc de croissance.
Il illustre même son raisonnement par des calculs économiques assez pertinents qui ont pour but d’expliquer a quel point l’investissement dans le capital humain peu être profitable aux nations.
Pour valoriser le capital humain, il convient d’élargir la notion d’apport en industrie, mais cela s’oppose à la prééminence du salariat dans la loi. Tant que le salariat sera le mode d’organisation privilégié des relations sociales, le capital humain ne sera pas reconnu à sa juste valeur.