Par Pierre Bessard, depuis la Suisse.
Le financement obligatoire d’une entreprise de médias représente sans conteste l’un des anachronismes politiques les plus controversés du moment
À l’ère numérique, la technologie a fait définitivement perdre à l’audiovisuel sa qualité de «bien public», qui pouvait encore refléter une réalité lors de la création de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), il y a quatre-vingt-sept ans. En parallèle, les coûts de production, de diffusion et de réception ont drastiquement diminué.
Les marchés sont aujourd’hui en mesure de pourvoir à l’information et au divertissement dans l’ampleur et la qualité souhaitées, que ce soit au niveau régional, national ou international : c’est vrai de la presse écrite (également sur Internet, et qui recourt de plus en plus à des supports audiovisuels), de centaines de chaînes de télévision et de radio auxquelles on peut s’abonner selon des préférences thématiques ou linguistiques, ou encore des émissions qui peuvent être visionnées ou écoutées à la demande (comme il est possible de lire un article de presse en ne payant que pour le texte souhaité).
Financer l’audiovisuel par l’impôt ?
Il n’est dès lors guère surprenant que l’audiovisuel financé par un impôt convainque de moins en moins : d’une part, pour prétendre à l’universalité fiscale, son offre hétéroclite doit dupliquer en grande partie, de façon tout à fait redondante, l’offre privée déjà existante, ce qui pose un problème de substitution et de concurrence déloyale ; d’autre part, l’audiovisuel étatique, malgré ses moyens, ne peut tenir la cadence de l’initiative et de l’innovation privées, qui ont fondamentalement modifié les habitudes de consommation. D’où le vieillissement inexorable de ses audiences.
Faute d’arguments, les défenseurs des privilèges légaux que confère l’impôt à une entreprise particulière, en l’occurrence la SSR, en sont désormais réduits à de simples slogans.
La notion de service public est si dévoyée qu’elle signifie le financement obligatoire de produits non rentables qui ne seraient pas demandés en quantité suffisante.
Le premier de ces slogans est bien sûr celui du «service public». Or les entreprises médiatiques privées ne sont pas moins au service du public qu’une entreprise financée par un impôt, dans la mesure où chaque citoyen peut être un client ou un consommateur potentiel. Les produits offerts sur le marché médiatique sont à la disposition de tous, sans discrimination.
La rentabilité n’est pas une exigence arbitraire
Dans le monde de la propagande politique, en revanche, la notion de service public est si dévoyée qu’elle signifie le financement obligatoire de produits non rentables qui ne seraient pas demandés en quantité suffisante.
On oublie que la rentabilité n’est pas une exigence arbitraire, mais la mesure de l’utilité de ce qui est produit, en vertu des préférences du public. Une entreprise est rentable précisément parce qu’elle sert bien le public. Seules les entreprises médiatiques qui prennent au sérieux les services qu’elles rendent subsistent et prospèrent.
Le deuxième slogan consiste à mettre en avant «la solidarité» entre les régions linguistiques. Certes, obtenir collectivement quelque chose (même inutile) que d’autres financent peut procurer une sensation agréable, mais ce n’est pas une attitude digne de régions qui font partie des plus florissantes du monde.
Les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Tessin affichent même un produit intérieur brut cantonal par habitant plus élevé que la moyenne suisse : l’idée que leurs résidents soient tributaires d’une «solidarité» pour leur consommation médiatique n’est pas sérieuse.
Le beau sentiment de solidarité s’exprime de façon volontaire, par exemple envers les victimes d’une catastrophe naturelle, pour lesquelles on ressent de l’empathie, mais il ne peut pas être utilisé légitimement pour justifier les privilèges d’une entreprise particulière.
Un impôt pour contrôler les médias ?
Un troisième slogan porte sur «la cohésion nationale» qu’assurerait une entreprise médiatique publique multilingue. Cette tentative de justification a posteriori n’est pas plus concluante.
Les prémices de la Suisse contemporaine précèdent de plus d’un siècle la création de l’audiovisuel d’État. Ce qui confère à la Suisse sa stabilité est l’inverse de ce que représente la SSR : les libertés personnelles constitutionnalisées, la concurrence de juridictions de proximité, une économie de marché libérale et une société civile et associative forte et pluraliste.
Ces dimensions vont à l’encontre du principe de médias nationaux financés par un impôt. Rien n’empêche par ailleurs une organisation privée, à but lucratif ou non, de servir de pont entre les régions, comme c’est déjà souvent le cas.
Avec un impôt médiatique progressif allant jusqu’à 35 590 francs par an (97 francs par jour) pour les entreprises (composées accessoirement de personnes physiques), le Conseil fédéral tente de perpétuer par le biais de la démagogie le contrôle politique et bureaucratique des médias.
Ce combat d’arrière-garde n’en reste pas moins problématique. La séparation souhaitable des médias et du pouvoir devrait être vue à notre époque comme l’opportunité de renforcer non seulement la diversité et la qualité de l’offre médiatique, mais aussi l’éthique du libre choix de citoyens responsables.


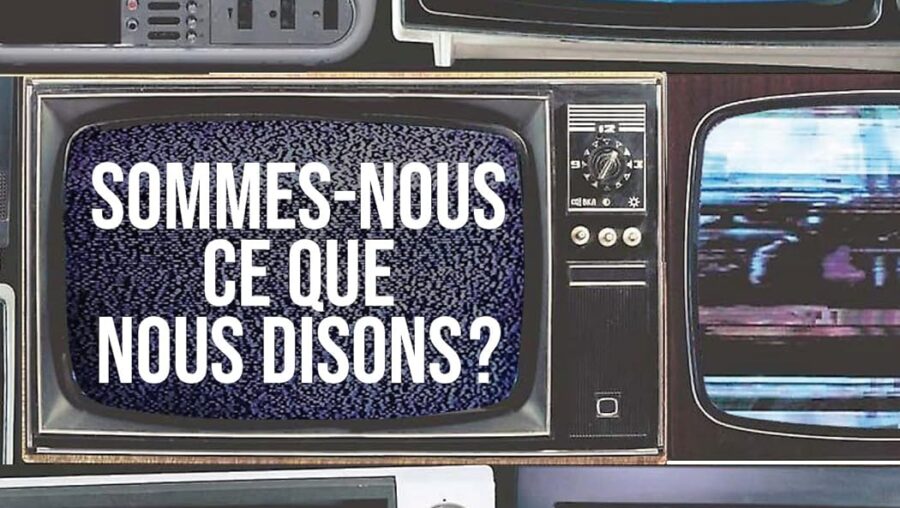
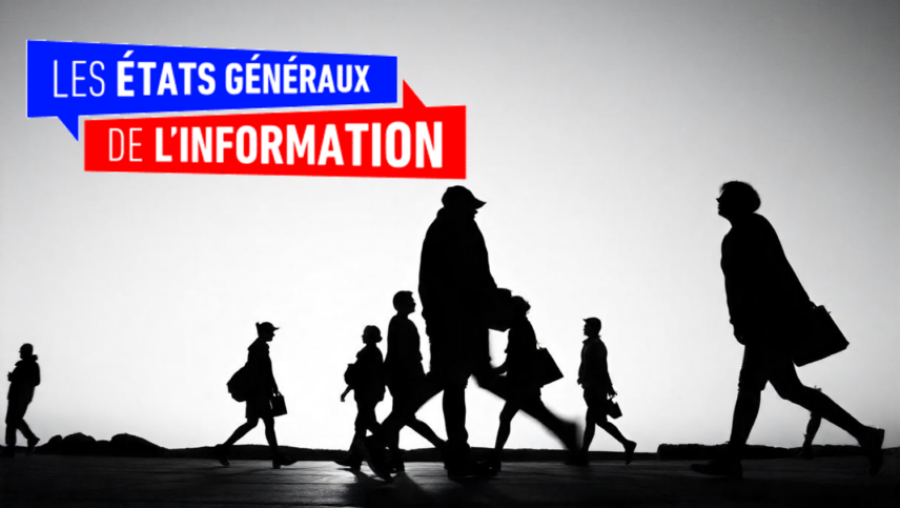

Laisser un commentaire
Créer un compte