Par la rédaction de Contrepoints.

Une étude BVA pour les Apprentis d’Auteuil de novembre 20161 s’intéresse au rapport de la jeunesse à la politique ainsi qu’aux idées et aux formes d’engagement auxquelles ils adhèrent.
Engagement et représentation : la jeunesse hors des cadres traditionnels de la politique
45% des jeunes de 17 à 24 ans se disent engagés d’une manière ou d’une autre. Néanmoins, cet engagement est plutôt limité au sein des partis politiques (9%) ou des syndicats (7%). L’engagement est plus fort au sein des structures éducatives (délégués de classe, conseil d’école, bureau des élèves) avec 22%, encore plus fort en association (sport, culture, environnement) avec 32%. 12% se disent engagés dans une association caritative.
Parallèlement, la jeunesse s’estime insuffisamment représentée en politique (87%), dans l’entreprise (79%) et dans les médias (66%). En revanche, elle se sent logiquement mieux représentée dans le milieu associatif (53%) et dans les conseils d’école (54%).

Ainsi, la représentation de la jeunesse dans les différents milieux cités semble assez proportionnelle à son engagement dans chacun de ces milieux…
La jeunesse se mobilise peu et se sent peu écoutée
Seuls 43% des jeunes interrogés sont certains d’aller voter à la présidentielle de 2017 alors que 8% sont certains de ne pas aller voter. À ce sujet, 60% d’entre eux pensent que l’élection présidentielle parle de sujets qui les préoccupent mais seulement 34% de la jeunesse pense que le personnel politique tient compte de son avis. Plusieurs raisons sont avancées : 76% pensent que les politiques sont trop éloignés du quotidien des jeunes. 37% y voient un problème intergénérationnel. 29% pensent que les jeunes n’ont pas assez d’espace d’expression et 14% que les jeunes ne cherchent pas particulièrement à donner leur avis. Ce chiffre est relativement faible compte tenu du faible engagement politique et syndical de la jeunesse…
Il faut dire que la classe politique ne maîtrise pas forcément les codes de cette jeunesse. Elle reconnait comme porte-parole :
- les blogueurs, youtubeurs et influents de la twittosphère à 34%
- les syndicats étudiants à 29%
- les associations qui œuvrent pour les jeunes à 25%
- les mouvements citoyens du type Nuit Debout à 22%
- les mouvements de jeunesse des partis politiques à seulement 21%
- les parents à 17%
- les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire du type Scouts ou AFEV à 17%
- les people engagés à 10%
- le personnel politique à 8% seulement.
Quels fautifs ?
Est-ce que les jeunes ne se sentent pas écoutés et représentés en politique parce qu’ils ne s’engagent que très peu de façon directe (en votant ou en adhérant à des partis) ? Ou bien est-ce qu’ils ne s’engagent que très peu parce qu’ils ne sont pas écoutés ou représentés ?
Difficile de trancher. Toujours est-il qu’il est connu que l’électoralisme est un élément important de la stratégie des candidats. Une élection est, pour le meilleur et (surtout ?) pour le pire, un marché d’offre et de demande. En politique, le vendeur est candidat et si la manifestation d’une demande ne lui parvient pas, il n’a aucune raison d’adapter ses produits…
- Enquête réalisée en ligne par l’Institut BVA du 7 au 15 novembre 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 jeunes de 17 à 24 ans. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables de sexe, âge, situation professionnelle et région. ↩


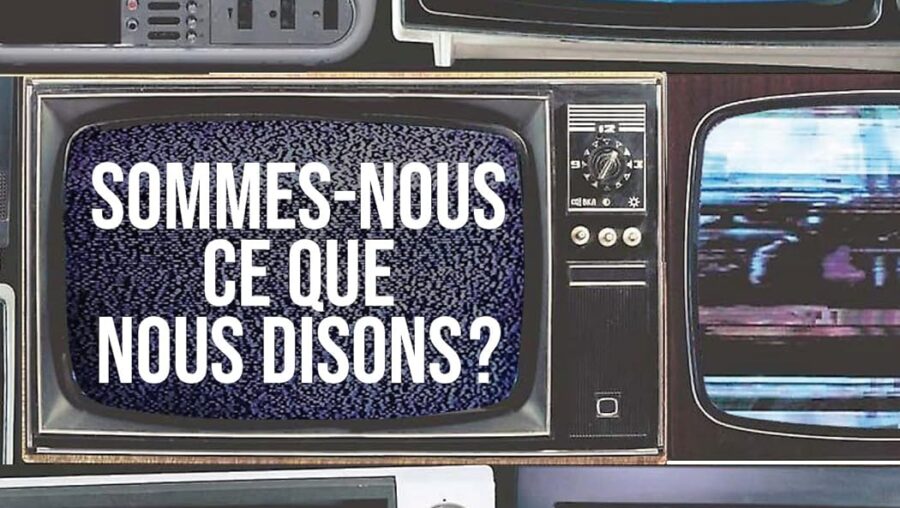


La tendance d’un désintéressement pour la politique ne se manifeste pas uniquement chez les jeunes mais dans toutes les categories d’age (cf : les chiffres de l’abstention). Les raisons sont donc à mon avis à chercher ailleurs que dans un manque de représentativité des jeunes. Piste de réflexion : l’estompement des clivages politiques fait que cela ne sert plus à grand chose de voter… puisqu’ils font la même politique