Par Jonathan Frickert.

Ça y est, l’année électorale est lancée, avec la myriade de propositions qui l’accompagnent naturellement. Si beaucoup ont compris, notamment à droite, l’impérieuse nécessité d’abroger des normes plutôt que d’en produire de nouvelles, force est de constater que l’idée que l’État peut tout reste une idée profondément tenace dans les esprits. Quitte à renforcer un peu plus l’inflation législative.
C’est alors que, dans un été de révision de l’examen d’entrée en école d’avocat que je passe en cette fin d’année, je découvris un petit livre, d’environ 300 pages au nom évocateur : La Main invisible et le Droit. Rien de tel pour me détendre après une intense journée de révision.
Publié il y a déjà prés de 24 ans aux éditions « Les Belles Lettres » dans la collection « Laissez-Faire » dirigée par l’économiste libéral François Guillaumat, cet essai est d’une lecture ô combien nécessaire aujourd’hui, qu’il s’agisse des juristes ou des non-juristes, qui apprécieront la pédagogie propre à l’auteur.
Entre juristes patronaux et juristes étatistes, l’auteur propose ici de remettre au cœur de la pensée juridique le concept libéral de droit naturel.
Trêve de suspense : l’auteur n’est autre que Maître Patrick Simon, avocat spécialisé en droit maritime et essayiste libéral bien connu.
Membre du conseil scientifique de l’institut Turgot, ce libéral-conservateur est titulaire d’un doctorat et est diplômé de Cambridge. On l’a notamment vu plaider dans plusieurs affaires de marées noires dans les années 1970.
Avec ce livre, lisible en une grosse après-midi, l’auteur nous offre un réquisitoire intemporel contre le droit constructiviste.
En effet, après avoir fait un constat de l’échec du constructivisme normatif, l’auteur se lance dans une plaidoirie exquise en faveur du droit invisible.
De la découverte à la construction
Partant de l’histoire de la création du contrat d’assurance maritime, à l’origine bons échangés dans des bars britanniques afin d’éviter des pertes trop importantes en cas d’échec des voyages (citant ici l’exemple de Lloyd’s), l’auteur n’hésite pas à affirmer très rapidement que les grandes découvertes juridiques sont nées d’en bas.
Pour lui, il faudra attendre le vingtième siècle pour voir une nouvelle tendance se dessiner ayant pour objectif de forcer la société par le haut, avec une législation antinaturelle qui tend à faire de la loi un instrument de méfiance à l’égard de l’Homme. Cette méfiance est née d’un pessimisme que l’auteur attribue non sans raison aux matérialistes historiques ainsi qu’aux existentialistes, rejetant pour les uns les valeurs morales, pour les autres l’idée même d’essence humaine.
Le politicien contre le juge
La seconde partie de son constat vise à dénoncer la logique démocratique en tant que clientélisme électoral, rejoignant ainsi dans une moindre mesure les théories d’un Hermann Hoppe quant à la perversion de la règle majoritaire propre aux démocraties.
La loi devient alors un instrument électoral. On protège les plus nombreux : locataires, salariés, consommateurs, héritiers…
L’auteur donne un certain nombre d’exemples, que ce soit en matière de bail, de droit du travail, de monopole des dockers, de dette privée ou encore d’héritage.
Cela aboutit à une perversion des droits-créances, c’est-à-dire des droits sociaux dont le débiteur est l’État. Or, pour donner, très peu rappellent qu’il faut d’abord prendre.
Dans le même esprit, le provisoire devient permanent, on créé de la fixité là où le temporaire est salvateur. C’est le cas du bail.
Cette question reboucle naturellement aujourd’hui avec celle de l’état d’urgence permanent.
Comme souvent, cette bienveillance étatique a un coût, avec un réajustement tôt ou tard.
Nous sommes en 1992, année charnière pour les libertés publiques. Il était impossible à l’auteur de ne pas évoquer la loi Gayssot, dénoncée également ici comme fixant un tabou inutile et renforçant un peu plus les thèses contre lesquelles la loi prétendait lutter.
Dans ce marasme, Patrick Simon n’oublie pas de rappeler les différents épisodes de résistance, que ce soit en 1984 contre la loi Savary, dans la rue, mais surtout dans les prétoires.
Plus que les manifestants, le juge est en effet ici clairement identifié comme résistant principal, avec un Conseil constitutionnel gardien du temple des libertés depuis 1971 et la fameuse décision sur la liberté d’association. Une fonction toutefois affaiblie par le fait que toutes les propositions pour le renommer en « Cour » constitutionnelle ont toujours hérissé les poils de nombreux politiques.
On peut ici citer le rejet de l’immunité syndicale en cas de dommages aux personnes ou aux biens inscrit dans la loi Auroux censuré par le Conseil en 1982.
Le juge est alors un résistant à cette tendance constructiviste.
Cette tendance est vouée à l’échec. En effet, la protection de la partie faible devient source de malthusianisme, de restriction. On nivelle par le bas. L’intervention publique n’est pas un stimulus, mais une drogue, et ce dans sa nature même. Elle fait du bien sur l’instant mais, ensuite, elle détruit.
Au final, elle nuit au protégé, elle accroît les coûts, elle uniformise, elle déresponsabilise et surtout elle enferme. Ainsi, ce qu’ils appellent progrès n’est qu’un accroissement des inégalités.
Cet échec est d’autant plus patent lorsqu’on regarde ce qu’était le Code civil à sa rédaction, en 1804. Le droit civil était un droit invisible, c’est-à-dire découvert, non-écrit, relevant de principes simples.
Aujourd’hui, les lois de circonstance sont légions, au mépris du bon sens.
L’auteur en profite donc pour tordre le cou à la thèse selon laquelle ce mal serait né de la culture catholique, en citant Louis XV et Henri IV comme contre-exemples.
Au contraire, et reprenant la thèse notamment défendue par Philippe Nemo (avec lequel il collaborera plus tard sur ce sujet) et Charles Gave, visant à dire que le libéralisme est d’essence chrétienne voire catholique.
Cet ouvrage est une version juridique de ce qu’ont pu être les thèses de Smith et Hayek, en réhabilitant le droit naturel, spontané, évolutif, contre le culte de la raison, de la loi, ayant pour racine l’intellectualisme idéaliste niant les faits et l’expérience qui en découlent. L’opposition entre la loi et la jurisprudence est ici parfaitement claire, entre droit décrété et droit invisible, spontané. Je ne pus m’empêcher de songer à la distinction faite par Jean Carbonnier entre droit dur et droit mou dans son ouvrage de sociologie juridique paru en 1983 intitulé Flexible droit, c’est-à-dire entre le droit classique, susceptible de sanctions, et le droit non-obligatoire, simple déclaration d’intention.
Enfin, l’euroscepticisme de l’auteur n’est pas pour déplaire, bien au contraire, voyant d’avance le danger d’une Union européenne qui est dans son essence même une construction qui aboutira plus tard à la machine bureaucratique, destinée à produire de la norme, de l’harmonisation, du même, chose que l’on connaît par ailleurs aujourd’hui.
L’auteur réitère son goût de la concurrence, qu’elle soit fiscale ou plus généralement normative. Un goût qu’il ne manquera pas de rappeler au moment des propositions.
Un droit du bon sens
En effet, très rapidement, dans le chapitre majeur de son livre – 80 pages sur les 291 pour un essai comportant 8 chapitres – l’auteur s’évertuera à présenter l’apport du droit invisible au droit en général.
Expliquant la naissance d’une myriade de principes tels que l’obligation d’information, de la liberté du consentement ou encore de la théorie de l’imprévision, l’auteur permet ici de comprendre les fondements du droit invisible, intemporel et plein de bon sens, et ce de manière extrêmement pédagogique et concrète.
Avec une anticipation rare, Maître Simon pose la question de l’intérêt de la cause en droit civil, laquelle sera supprimée en 2016, au moins de jure, avec la récente réforme du droit des contrats.
La cause y est vue comme l’introduction d’un critère de moralité dans les relations contractuelles, alors que le droit n’a pas à sanctionner les consciences.
Le droit invisible est donc adapté à la vie, à la liberté, tout en étant la preuve d’une grande sécurité.
Patrick Simon rappelle sa position en faveur de la concurrence, notamment fiscale, afin de découvrir – ce mot est fondamental dans cet essai puisque la découverte sera toujours supérieure à la construction – la norme juste plutôt que de la construire de toute pièce. Cette concurrence permet également une spécialisation normative qui n’est pas sans rappeler le travail de Ricardo.
N’étant pas euro-centré, on retrouve ici une analyse pragmatique du modèle américain, dont l’auteur dénonce le matérialisme tout en appréciant l’absence de Parquet agissant en substitution des parties requérantes.
L’auteur ne manque pas de rappeler l’intérêt de sa spécialité, le droit maritime, et plus généralement le droit transnational, comme échappatoire à la norme étatique.
Cependant, le droit invisible peut également être source d’erreurs, comme avec le mandat d’intérêt commun, où le juge a déjà pu refuser la résiliation sans cause légitime alors que l’allocation d’indemnités aurait été plus juste.
Le droit invisible est également une réponse du marché à la surpuissance de l’État, comme avec les cas de boycott frappant Israël.
L’auteur centre son propos sur l’efficience de la norme, et non sur un quelconque logiciel partisan.
On a donc affaire à un véritable manuel de droit libéral, égayé d’anecdotes professionnelles, toutes vouées à démontrer la supériorité du droit découvert, comme avec le contentieux autour du principe de la garde de la chose.
Le droit invisible est également menacé par la corruption, laquelle ne peut être combattue sans une opinion publique responsable qui n’hésite pas à faire confiance au juge, voire à l’arbitre. On note la force avec laquelle, dès 1992, l’auteur n’hésite pas à balayer les objections faites au principe même de l’arbitrage.
Le juge, gardien du droit libéral
Mais l’auteur ne se limite pas à un simple constat d’échec du droit décrété face au droit invisible. Patrick Simon est également un homme de propositions, notamment pour renforcer à la fois la démocratie et le contrôle du juge sur les gouvernants.
Extension de l’exception d’inconstitutionnalité, qui rappelle la question prioritaire de constitutionnalité introduite en 2008, référendum d’initiative populaire, indépendance des magistrats, privilégier les lois supplétives afin de favoriser l’intériorisation du droit …
On reprochera toutefois, et ce sera la seule critique que je formulerai, une confiance parfois trop forte envers l’institution judiciaire, qui peut être interprétée pour de la naïveté.
Cet ouvrage est donc probablement un monument de droit libéral qu’il ne faudra pas hésiter à lire et relire plusieurs fois, tant sa simplicité et la pertinence de ses thèses reste intemporelles.
- Patrick Simon, La main invisible et le droit, éditions Les Belles Lettres, 291 pages.




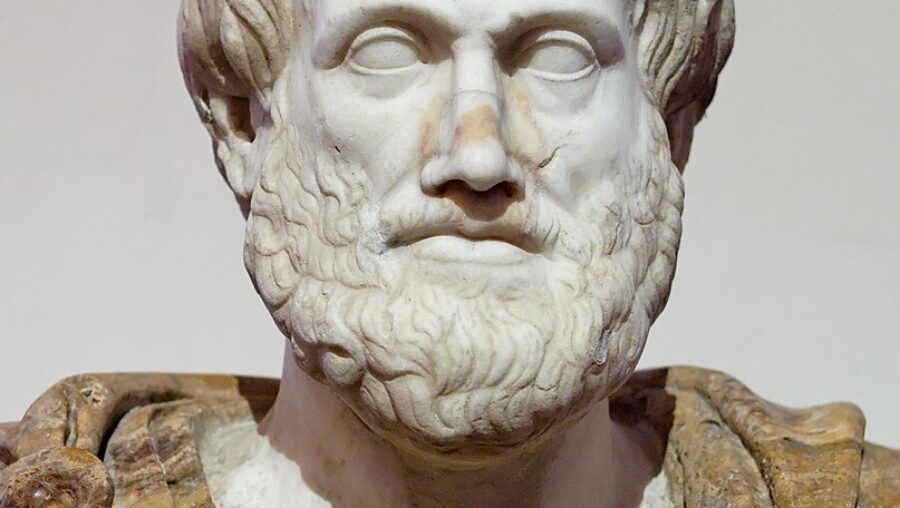
Ce qui me choque le plus dans le système judiciaire Français, c’est qu’au nom de l’indépendance de la justice les juges sont en train de créer un état dans l’état sans contrôle démocratique.
Il faut que les juges soient élus démocratiquement.