Par Francis Richard
 “Il n’y aura jamais d’impôt parfait, sauf, diraient certains, l’absence d’impôt !”
“Il n’y aura jamais d’impôt parfait, sauf, diraient certains, l’absence d’impôt !”
Dans cette petite phrase, isolée volontairement de son contexte, est résumé le propos du livre de Jean-Philippe Delsol. Et dans le titre, L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun, est contenu ce à quoi aboutit sa réflexion sur l’impôt.
Dans un texte philosophique, tel que celui-là, la définition des notions qui permettent d’étayer le propos de l’auteur est essentielle. L’auteur s’en charge souvent lui-même pour s’assurer qu’il est bien compris par celui qui le lit. Et c’est bien le cas ici.
Le droit et la loi
Retraçant leur histoire, depuis l’Antiquité, Jean-Philippe Delsol montre d’abord combien les notions de droit et de loi peuvent différer dans le temps, et s’opposer en fonction de la place que le pouvoir laisse aux hommes :
“Écrite, la loi dit ce qui est défendu, pour que le reste soit permis, ce qui est l’essence même du droit de toute cité libre, à l’inverse du droit des cités tyranniques, et aujourd’hui totalitaires, où le droit dit ce qui est permis, tandis que tout le reste est interdit.”
S’il fallait prendre un raccourci, la première acception serait celle de la République romaine et du common law anglo-saxon, la seconde celle de la Rome impériale, et du continent latin…
Dans la première acception, le droit est en recherche et pluriel. Dans la seconde, la loi se veut une et universelle.
Le droit naturel et la justice
Le droit naturel relève de la première acception. Il est “muable” et il est premier par rapport à la loi. Il s’inspire de la pâte humaine.
La justice est une vertu cardinale, distincte des autres vertus en ce qu’elle est une vertu par rapport aux autres, et non par rapport à soi.
Elle revêt deux formes :
- Commutative, elle est spécifique à l’échange
- Distributive, elle restitue à chacun ce qui lui revient
La volonté contre la raison
Si la source du droit est la volonté humaine ou divine, au lieu de l’être de la raison humaine ou divine, on aboutit à l’arbitraire, au droit subjectif. C’est “la tentation hégémonique du pouvoir libéré de toute référence à une raison qui lui soit antérieure ou d’une nature transcendante”.
Le droit est ainsi abandonné aux mots de la loi. Ce qui complaît aussi bien aux contempteurs du droit qu’aux passionnés du nivellement et de l’uniformité, c’est-à-dire à ceux qui ont une obsession maladive pour l’égalité.
De distributive la justice devient alors distributrice pour rendre la cité parfaite.
Le juste, le bien et le bien commun
Comment s’articulent ces trois ordres ?
“La justice doit s’imposer à tous car elle réunit les règles de vie qui donnent cohésion et pérennité à la société. Mais elle ne peut pas dire le bien qui est éminemment personnel. Tout au plus elle peut concourir au bien commun par l’ordre qu’elle fait respecter et qui est à la base de toute vie commune durable et paisible.”
Le juste n’est pas le bien, et le bien n’est pas le juste. Le juste relève de la loi humaine, une loi d’airain, tandis que le bien peut relever de la loi divine, la Loi, qui parfait la loi humaine. Mais cette dernière n’est pas “du ressort de l’autorité temporelle, mais seulement du domaine spirituel” :
« Toute confusion entre la règle de Dieu et la règle d’airain est dangereuse et risque d’ouvrir le passage d’un monde libre à un monde soumis. »
Qu’est-ce que le bien commun ?
À l’origine, il recouvre la sûreté, la sécurité et la justice, autrement dit les devoirs régaliens du souverain. Or, progressivement, dans l’histoire, le bien commun va recouvrir bien autre chose.
L’État-providence
Le champ du bien commun s’étend progressivement, d’abord quand l’objet de l’attention publique devient plus large, ensuite quand cela se traduit par des politiques d’assistance et de reconnaissance des droits des pauvres, enfin quand l’État-providence prétend se substituer à la providence divine.
Jean-Philippe Delsol rappelle que “le bien commun est sans doute essentiellement l’ensemble des conditions qui permettent de vivre ensemble, et il s’agit d’un dosage qui n’est pas défini a priori ; il est différent selon les pays, les époques, les circonstances…”. Il rappelle que ce n’est pas sans risque que l’État s’en arroge le monopole “au lieu de laisser les hommes le construire à leur mesure” :
« La réalité est que bien souvent, l’État érige en bien public ce qu’il veut contrôler, et il a un appétit toujours grandissant à tout contrôler. »
La cité et les Hommes
Le contrat social d’un Rousseau est « une fiction philosophique » :
“Ce contrat ne saurait être que celui que les hommes nouent progressivement tout au long de leur histoire, dans les heurs et malheurs de leur vie commune, dans les arcanes de leur vie sociale. Il ne s’agit pas vraiment d’un contrat, mais de l’acceptation plus ou moins libre, plus ou moins forcée d’une vie commune imposée par les nécessités.”
C’est pourquoi il ne faut pas se tromper :
“L’homme n’est pas fait pour la cité, mais la cité est faite pour l’homme. Cette règle doit prévaloir lorsque la cité prélève l’impôt pour assurer ses fonctions. Sans ressources, elle n’existerait pas et les citoyens seraient sans défense, sans justice, sans police, sauf à les organiser eux-mêmes et à y contribuer, c’est-à-dire à reconstituer les institutions de la cité ! »
La liberté responsable
La cité est faite pour l’homme et non l’inverse :
“L’homme ne peut pas faire fi de la société, mais celle-ci ne peut pas oublier que l’homme reste l’agent libre et agissant au profit duquel doit être organisée la société.”
La société doit donc laisser l’homme libre de rechercher son bien : c’est la condition pour qu’elle trouve le sien propre et son harmonie ; et c’est efficace parce que le bien de l’un profite au bien des autres à partir du moment où il les respecte.
Si la liberté n’est pas une fin en soi, elle est un préalable pour que le bien poursuivi par l’homme ait un sens ; elle est “le ressort de son sursaut lorsqu’il lui est refusé tout droit ou qu’au contraire il est assisté jusqu’à l’infantilisation, cette forme moderne du despotisme archaïque que représente l’État-providence” ; elle lui est nécessaire pour rechercher la vérité, sans prétendre jamais la posséder, tout en l’espérant ; elle le rend responsable de ses actes, sans quoi la justice ne peut s’exercer.
Irresponsables
Seulement, en France, “la justice souffre de plus en plus de ne plus être faite pour des hommes en particulier, mais pour des catégories sociales”.
Cela résulte de :
- la confusion du droit avec le nivellement des conditions
- la confusion de l’équité avec l’égalité
- la construction d’une grande machine à modeler les comportements
- la main-mise de l’État sur la société
- la croissance incessante de l’État-prévoyance (les dépenses publiques représentent 57,1 % du PIB en 2013, et les dépenses sociales 60 % de ces dépenses…).
“En déresponsabilisant les citoyens, l’État les anémie, détruit leur humanité qui se façonne tous les jours dans l’exercice de sa liberté responsable” :
“Au-delà d’un certain niveau de prise en charge, il ne sert à rien de dépenser sans compter. Au contraire l’alimentation de la machine sociale entretient la pauvreté matérielle et crée de la pauvreté morale en rendant ceux qui en profitent moins responsables et parfois plus du tout responsables.”
Un totalitarisme doux
Le bien commun est invoqué sans cesse par ceux qui construisent l’État-providence à coups de lois toujours plus prégnantes.
Mais il a bon dos, celui d’une fausse solidarité, parce que contrainte et accomplie au prix d’une injustice fiscale, qui est un véritable tour de passe-passe :
“Lorsque l’impôt vient prendre en charge l’assistance, il transforme la bonté en obligation à l’égard de celui qui donne et le secours en droit pour celui qui reçoit.”
Que ces politiciens le construisent par intérêt propre ou par idéologie (dans ce cas, “ils croient à la perfection humaine sur cette terre”…), « l’État-providence est un totalitarisme doux et d’autant plus acceptable par la masse de ceux auxquels il est inoculé qu’il lui offre les facilités d’une vie assistée, débarrassée du souci d’y penser pour ne pas dire de penser. Le citoyen se rend lui-même et progressivement l’esclave de la collectivité. Il y perd son humanité quand il est persuadé de la gagner. Mais il est censé ne pas s’en rendre compte par la lente habitude à la facilité que le système suppose.”
- Jean-Philippe Delsol, L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun, Desclée de Brouwer, 332 pages.
—

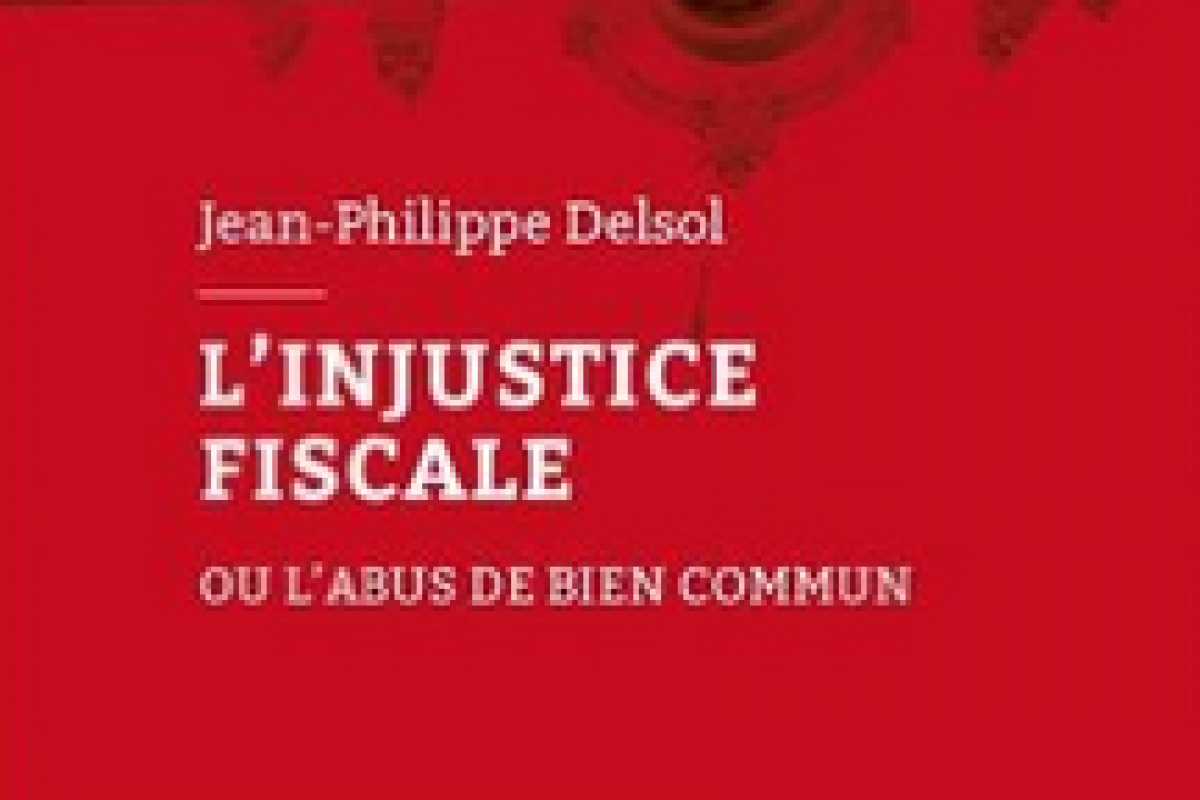



On parle toujours des conséquences, l’Etat-providence ceci l’Etat-providence cela mais pourquoi la France en est arrrivé là et ne parvient pas à s’en extirper. Parce que dire il faut réformer l’économie à la sauce libérale n’est pas suffisant je crains si on ne change pas l’architecture de notre régime politique. Il suffit de regarder l’histoire de la 5e République pour comprendre le lent et inexorable enlisement du pays. Redonnons au parlement ses lettres de noblesse et le pays (re)deviendra plus pragmatique.
“Redonnons au parlement ses lettres de noblesse” voilà une phrase bien grandiloquente qui n’est pas pragmatique. C’est justement parce que le parlement se considère comme de la noblesse face aux sans dents que nous sommes qu’il y a un problème grave en france.
Pourquoi la France en est arrivée là ?
Parce que c’est facile de se donnee bonne conscience en distribuant l’argent péniblement gagné par d’autres et cela permet aussi d’acheter des voix pour se faire réélire.
Vous remarquerez que ceux qui distribuent l’argent public en profitent aussi largement, mais y contribuent le moins possible…
Ils sont rémunérés sous forme d’indemnités confortables plutôt que de salaires, les dites indemnités étant très ( trop) peu imposées…
Barrons-nous, plutôt.