Par Farid Gueham.

Dès l’annonce de la première attaque, vendredi 13 novembre aux alentours de 21h, les plateformes et les réseaux sociaux ont été des fils d’information extrêmement importants mais aussi et surtout des balises, des repères, un refuge pour des internautes et des Parisiens en état de choc.
« Un phare dans la nuit, une bouteille à la mer »
C’est l’expression du journaliste Sylvain Lapoix, qui a eu l’idée du hashtag #PorteOuverte. Car plus encore que des flux RSS, les réseaux sociaux ont joué, ces derniers jours plus que jamais, un rôle de canal de recherche, d’information, de plateforme de solidarité. Des espaces pour créer, recréer et densifier du lien. #PorteOuverte a permis aux personnes affolées, rescapées sans possibilité de rentrer chez elles ou d’aller à l’hôtel, de trouver refuge chez des Parisiens solidaires. Mais quand il a créé ce hashtag, Sylvain Lapoix était loin d’imaginer l’ampleur que cela allait prendre. Il voulait tout simplement aider. « C’est sur Facebook que j’ai appris que les attentats avaient eu lieu mais mon premier réflexe a été d’aller sur Twitter. Si j’ai pensé à Twitter c’est parce que j’étais chez moi et je recherchais moi aussi de l’information pour comprendre ce qu’il se passait. Au final, l’idée n’est pas venue de moi, mais des gens, désemparés, qui ne sachant pas vers qui se tourner […] étaient en panique. Et lorsque l’on est désemparé, on demande de l’aide à n’importe qui. Or, n’importe qui, c’est les réseaux sociaux. On pose des questions à des millions de personnes, c’est une bouteille à la mer » explique Sylvain Lapoix.
Il fallait donc un point d’ancrage à ces appels à l’aide, quelque chose qui les lie pour les retrouver plus facilement dans le flot des messages, cette nuit là, sur Twitter.
Cet ancrage, cette balise, c’est ce hashtag #PorteOuverte, créé en moins d’une minute. Cela commence par un petit tweet, suggérant aux internautes de l’utiliser, avec quelques précautions tout de même, comme de n’envoyer les adresses précises qu’en « DM », en messages privés. Sylvain Lapoix se désintéresse de son hashtag pour prendre des nouvelles de ses proches et deux heures plus tard, une chaine de solidarité se met en place. « J’ai vu s’afficher ce chiffre qui m’a totalement abasourdi : plus de 200 000 tweets, soit 100 000 tweets par heure. C’est là que j’ai pris conscience de l’ampleur de signal. J’ai vu des appels au secours, j’ai reçu des propositions d’aide, puis j’ai vu un troisième type de message qui m’a vraiment fait plaisir. Des gens m’expliquaient que dans une nuit pareille, marquée par une telle horreur, voir des gens qui tendent la main, spontanément, leur redonnaient confiance et espoir en l’humanité ».
Outre l’initiative personnelle, l’outil qui a rencontré un grand succès, c’est le « safety check » de Facebook.
Safety check est un service qui a permis aux membres de Facebook, présents ce weekend à Paris, de signaler à tous leurs amis, par un simple clic, qu’ils se trouvaient en sécurité. Un outil très efficace déjà utilisé lors du Tsunami de 2011 au Japon, aux Philippines et au Népal. Victime de son succès, le dispositif se trouve aujourd’hui au centre d’une polémique. Pourquoi Facebook n’a pas déployé le dispositif au Liban, également frappé jeudi 12 novembre par un attentat revendiqué, là aussi, par l’État Islamique. De nombreuses voix se sont élevées pour fustiger Mark Zuckerberg et son entreprise, accusés de privilégier les victimes d’un drame, à celles d’un autre. Facebook a répondu, en s’engageant à généraliser l’outil, initialement prévu pour les catastrophes naturelles et non pour les attentats. Par ailleurs, les Libanais ont, malheureusement, une plus grande habitude des d’attentats. Ils ont développé une application nationale « Je suis en vie », pour signaler à une liste de contacts dédiés que l’on est à l’abri, sain et sauf.
Mais sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, le meilleur comme le pire, de la désinformation aux messages de haine.
Les réseaux sociaux sont aussi une source inépuisable de « fakes », comme l’annonce d’un attentat dans une synagogue de Londres, on encore un incendie dans la jungle de Calais. L’attentat de Londres est une invention, quant à l’incendie dont une photo était relayée, il s’agissait en fait d’un incident du 1ernovembre dernier. Le site de fact-checking « les décodeurs », s’est penché sur ces photos trompeuses qui circulent sur le net après les attentats. Leur but est de faire le buzz, attiser la haine. Les détournements ne manquent pas, profitant de l’émotion populaire pour faire parler des images hors contexte, souvent truquées. Des scènes de liesse à Gaza sont présentées comme une célébration des attaques terroristes à Paris. Les clichés datent en fait de 2012, d’après les crédits photo de l’agence Reuters. Les rues désertes de Paris prises au mois d’août sont présentées comme le désert post-explosions de la semaine passée. Des manifestations du mouvement anti-immigration allemand Pegida sont elles présentées comme des marches de soutien au peuple français. De quoi dérouter.
Au-delà des détournements, les réseaux sociaux sont surtout le lieu de la mémoire et de l’espoir.
Le hashtag #PrayForParis, a déjà été utilisé plus de 3,5 millions de fois. Un autre, en français #NousSommesUnis, est relayé plus de 50 000 fois. Il y a bien eu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Mais rapidement, la lecture des posts publiés sur Internet depuis ce vendredi noir, montre une majorité de messages positifs. Sur les millions de commentaires publiés, les soutiens, les condoléances et l’entraide l’emportent largement sur le racisme ou la haine. Un enquête réalisée par L’Express et Netino.fr, société en charge de la modération de nombreux sites, force l’optimisme : « ce qui ressort en premier lieu, c’est le recueillement, l’émotion, la compassion pour les victimes et les questionnements du type ‘comment peut-on faire ça ?’. Nous avons fait un petit carottage, qui est proche des 70% de commentaires positifs ». Au niveau international, on observe un véritable élan de solidarité avec près de trois-quarts des messages rédigés dans des langues étrangères, le plus souvent en anglais. Une utilisation inédite des réseaux sociaux comme réseaux d’entraide. Une instrumentalisation spontanée, humaine, qui prouve une fois de plus que si les réseaux sociaux impactent nos liens et notre rapport à l’autre, ils les transforment, les amplifient, les exposent, mais ne les dégradent pas.
Pour aller plus loin :
- « Attentats de Paris : sur les réseaux sociaux, vous tentez de positiver », L’Express.
- « Attentats à Paris. Les réseaux sociaux au cœur du deuil collectif », Courrier International- Medium San Francisco.
- « Attentats : une chaîne de solidarité voit le jour sur les réseaux sociaux », Le Parisien.
- « Attentats à Paris : Les réseaux sociaux, entre aide précieuse et grand n’importe quoi », 20 minutes.
- « Sur les réseaux sociaux, ils recherchent ceux qui les ont sauvés pendant les attentats », Metro News.
- « Attentats à Paris : Le twitto qui a lancé le hashtag «#PorteOuverte» raconte », 20 minutes.
—
Lire sur Contrepoints notre dossier attentats à Paris

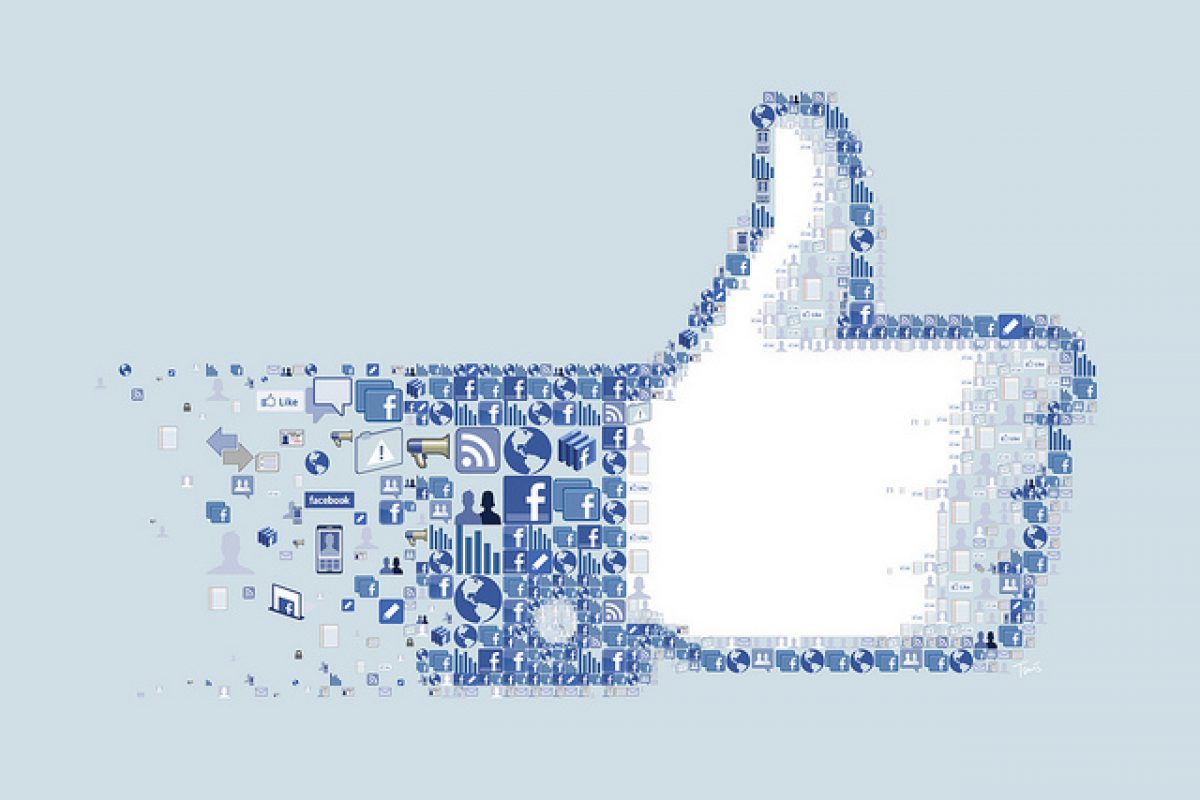


Laisser un commentaire
Créer un compte