Par Emmanuel Bourgerie.

L’économie est une science sociale pour une très bonne raison. Il serait difficile d’analyser des échanges monétaires entre individus de façon sérieuse sans une solide compréhension de la psychologie. C’est pour cela qu’une nouvelle branche de l’économie a émergé et attire de plus en plus d’attention : l’économie comportementale. En d’autres termes, utiliser ce que l’on sait de la psychologie pour déterminer comment les consommateurs dévient du « modèle » de rationalité. Avant eux, le keynésianisme avait été créé pour analyser l’impact global (macro-économie) des interactions individuelles (micro-économie), et pour montrer que des actions individuellement rationnelles pouvaient avoir un impact négatif sur l’économie au sens large du terme.
Petite parenthèse, ces deux domaines sont systématiquement dénigrés par les libéraux parce qu’ils contredisent en apparence leurs idées préconçues sur l’économie ; ce qui est bien dommage pour un courant de pensée qui se veut non-idéologique et ayant une approche scientifique de la politique. Le keynésianisme est un domaine très large, avec des aspects discutables, comme tous les autres domaines de l’analyse économique. Balayer d’un revers de la main un pan entier de la science économique parce que les conclusions ne vous plaisent pas n’est pas ce que j’appelle une approche critique.
Analyser et comprendre en quoi l’équilibre de marché et la rationalité des consommateurs sont des concepts bien plus difficiles à atteindre qu’on ne le pensait n’est pas une preuve de faiblesse, ou une remise en cause de l’économie de marché toute entière. Est-ce que l’asymétrie d’informations est l’argument ultime pour casser le concept d’économie de marché ? Non. Hayek parlait du problème de la connaissance avant la fondation de l’école keynésienne. Que les consommateurs n’aient accès qu’à une quantité limitée d’information et obéissent à leurs instincts ne sont pas vraiment des idées neuves. L’argument central des critiques du socialisme par Mises et Hayek est justement de pointer du doigt que les dirigeants ne sont pas des dieux omniscients bénévoles, mais des individus comme les autres, victimes des mêmes imperfections.
La première erreur communément commise est de croire que l’économie de marché requiert une parfaite rationalité de la part des acteurs. Ce serait appréciable, c’est certain, mais ce serait déformer mes propos. Partir du principe que les consommateurs tendent à être rationnels est différent que d’affirmer que nous sommes tous des robots reliés à la Matrice et que nous ne commettons jamais la moindre erreur. L’idée est justement que l’économie de marché « punit » l’irrationalité. Si j’achète un yaourt trois fois le prix que je devrais normalement payer, je perds la différence que je ne pourrais pas utiliser pour autre chose. Prenez un autre exemple trivial : si vous passez une nuit bien arrosée, et vous réveillez le lendemain le portefeuille vide parce que vous êtes allé dans des bars particulièrement huppés, vous allez certainement vous dire « la prochaine fois, je rentre plus tôt », ou « je n’irai pas dans ce bar ». Le postulat de base de l’économie de marché est que les désirs sont illimités mais que les ressources sont limitées, et que (je simplifie à l’extrême) les droits de propriété permettent de gérer cette rareté des ressources. Bien entendu qu’il y aura des consommateurs pour agir de façon irrationnelle, mais ils en seront les premières victimes, et y réfléchiront à deux fois avant de commettre la même erreur. À moins que nous soyons si irrationnels que nous achetons des voitures et contractons des prêts immobiliers sur un coup de tête sans jamais nous poser de questions, mais ce serait une affirmation pour le moins extraordinaire.
La seconde erreur est de créer cette fausse dichotomie entre consommateurs et électeurs. Si l’économie de marché échoue parce que les consommateurs sont irrationnels, il n’y a aucune raison de croire que lorsqu’ils pénètrent dans l’isoloir ils vont soudainement changer du tout au tout et devenir parfaitement rationnels. De même pour les dirigeants, qui ne sont pas des surhommes aux dernières nouvelles. Il existe de nombreux problèmes dans l’économie de marché, c’est certain, mais cela n’est pas une carte blanche pour un socialisme débridé (c’est à peine une exagération de ma part). Les électeurs sont, eux aussi, ignorants, influencés par leurs peurs, attirés par tout ce qui est « gratuit », et jugent à l’apparence plus qu’au contenu. Mais il existe un problème fondamental avec le processus démocratique : l’action individuelle a un impact virtuellement nul sur le résultat d’une élection. Si cela parait anecdotique, en réalité cela signifie qu’un électeur qui vote pour le bon candidat n’en percevra pas les bénéfices directs, et n’en paiera pas les conséquences s’il se trompe. Si l’économie de marché récompense la rationalité et punit l’irrationalité, la démocratie fait l’inverse : elle élit les candidats qui caressent les électeurs dans le sens du poil et embrassent leurs idées fausses.
—



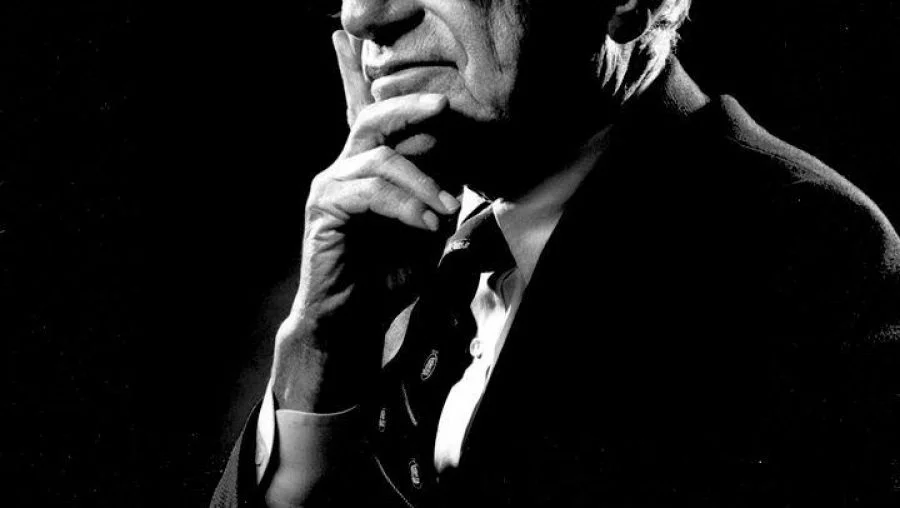

Allons. Appliquez aux électeurs le raisonnement que vous prêtez aux piliers de bars. Ce gouvernement qui promettait de baisser les impôts les a augmenté comme jamais. Je ne voterai donc plus pour lui, devrait être la suite cohérente de ce constat fait. Dans la réalité de la Grance des trente dernières années, l’ histoire ne manque pas de surprendre qu’il y ait autant d’adorateurs du Père Noël..
je dirai le contraire : il est plutôt étonnant qu’il y ait si peu d’adorateur du Père Noël. En toute rationalité, l’électeur devrait demander bien plus de dépenses payés par les autres, sans se faire chier à produire puisqu’il lui reste à tout casser 1/4 de son produit.
Ce qui me rappelle une vieille blague :
En France il y a quatre partis, de gauche à droite :
Le parti des pauvres pour l’exploitation des riches
Le parti des riches pour l’exploitation des riches
Le parti des pauvres pour l’exploitation des pauvres
Le parti des riches pour l’exploitation des pauvres
Aujourd’hui c’est plus simple, on a plus que deux partis
Le parti des riches pour l’exploitation des autres
Le parti des pauvres pour l’exploitation des étrangers
« La première leçon de l’économie est celle de la rareté : qu’on n’a jamais assez de tout pour satisfaire entièrement les besoins de chacun. Et en politique, la première leçon est de ne pas tenir compte de la première leçon de l’économie »
Thomas Sowell