Par Johan Rivalland.

À travers cet ouvrage, le philosophe et essayiste Éric Werner établit une sorte de parallèle, qui ne pouvait que me séduire lorsqu’il est question de deux personnages que j’admire depuis longtemps au plus haut point, entre Antigone et Sophie Scholl, dont elle serait comme l’incarnation vivante.
Suivant en cela George Steiner, dans « Les Antigones », Éric Werner écrit que
«Certaines grandes œuvres de la littérature occidentale ont pénétré l’inconscient collectif au point de s’y imprégner durablement, d’y prendre racine, contribuant à faire de nous ce que nous sommes. »
Une vision positive à laquelle j’aimerais croire, et qui milite dans le sens de l’intérêt de la lecture, de la culture.
Un personnage hors du commun
Néanmoins, l’auteur note que nous ne sommes pas tous appelés à devenir Antigone. Et le cas de Sophie Scholl (autant que de son frère, d’ailleurs), aussi ordinaire qu’on veuille bien la décrire ou l’imaginer, n’est pas si banal.
« Il n’est pas donné à chacun de mourir ainsi. Une telle force d’âme, en tout état de cause, nous interpelle. »
Morte sur l’échafaud, sans ciller, tout comme une certaine Charlotte Corday (citée, parmi quelques autres en dédicace par l’auteur), elle fait preuve d’un courage et d’une détermination hors du commun, réservés à un tout petit nombre, tout en exprimant tout haut, à l’instar de ce qu’affirme le personnage d’Antigone, ce que beaucoup pensent sans oser l’exprimer.
Selon Antigone (Sophie Scholl), Créon (Hitler) commettait un abus, une démesure (hybris), allant à l’encontre de l’ordre naturel, des règles éternelles, non écrites (nomos), se prenant ainsi pour Zeus (Dieu), alors même qu’il en nie les lois fondamentales en refusant une sépulture à un mort (en perpétrant des crimes de masse). Ce qui entraîne la Nemesis (vengeance) des dieux (des Alliés), occasionnant des malheurs au peuple thébéen (des raids aériens sur les villes allemandes).
Créon a ainsi franchi les limites fixées par la Justice (dikè) à l’homme à travers la guerre.
Un cheminement profondément philosophique
Se pose alors la question du rapport à Dieu, ou à la conscience (l’intériorité de celui-ci, pour le croyant). Et Éric Werner nous explique la difficulté d’appréhension de cette sagesse philosophique (le « connais-toi toi-même ») dans le contexte contemporain de la conception démocratique (et de ses limites). Un passage très intéressant (chapitre 2).
L’Antigone de Sophocle serait elle-même de nature divine, selon Éric Werner. Ce qui explique beaucoup de choses. Dans le cas de Créon, à l’inverse, l’articulation de l’humain au divin échoue. Or, c’est cette articulation (à l’Autre, dans le cas de la démocratie contemporaine) qui permet le respect des limites (sôphrosunè).
Très inspiré par Héraclite, de même que le furent Eschyle et Euripide, Sophocle préfigure aussi les Lumières, par sa vision humaniste, mais en n’omettant pas les lois non écrites, celles voulues par Dieu, « car à défaut, l’humain a toute chance de virer à l’inhumain. »
Et on perçoit bien ici toute l’importance de la traduction et de la précision de l’interprétation de chaque mot dans le texte, en particulier du chœur, dont le rôle est central. Un véritable cours auquel nous convie Éric Werner de manière captivante et passionnante.
L’audace, l’espérance et l’amour sont présentés comme des affects et qualités indispensables de l’homme, qui le guident dans son action, mais qui peuvent conduire aussi bien sur le bon chemin (le Bien) que le mauvais (la route du mal). Profondément philosophique. Et c’est là qu’intervient l’erreur de Créon : se croire autosuffisant, ayant la sagesse infuse, là où il devrait s’en remettre à Dieu. Ce qui le conduira à sa perte.
Éric Werner nous présente ainsi les liens entre transcendance et immanence, raison et religion : « Dieu ne nous est pas extérieur, mais bien intérieur ». C’est là que le cheminement d’Antigone est accompli (l’adhésion aux règles non écrites). L’alliance entre le sophiste et le philosophe est abouti chez Antigone, là où Créon n’en est resté qu’au stade de bon sophiste, pourvu d’une bonne éducation et d’une bonne maîtrise du langage, sans qu’il soit parvenu à trouver le bon chemin (ici, le respect des limites liées à la guerre).
La remise en cause, chez Oedipe
C’est encore l’hybris, la démesure, qui condamne Œdipe, dans « Œdipe Roi », écrit vingt ans plus tard, où l’orgueil de Jocaste et Œdipe, qui se défient des dieux, les emporte vers un chemin dangereux, celui de la tyrannie. Péché beaucoup plus grave que ceux que l’on retient habituellement, selon Éric Werner, (tuer son père et épouser sa mère, sans le savoir), autosuffisance qui ne lui sera pas pardonnée.
Mais Éric Werner va beaucoup plus loin, car il situe cette autre pièce dans son contexte historique, qui a changé, et en montre la régression. On est passé de l’époque-phare de Périclès, la démocratie athénienne et la société ouverte (il fait lui-même référence au célèbre ouvrage de Karl Popper et à son tome 1, consacré au caractère précurseur du totalitarisme de la pensée de Platon) à l’époque de remise en question de celle-ci. Or, aucun personnage semblable à ce que symbolise Antigone n’y figure plus. D’où l’idée de la symbolisation de la remise en cause du péché d’autosuffisance et de la fin de la société ouverte, qui avait cherché à remettre en cause les traditions (chères à Platon, mais aussi à Aristote).
Antigone, personnage christique
Antigone, selon Éric Werner, figure ainsi un personnage de type christique. Elle appelle, pour ainsi dire, au pardon face à l’ennemi, lorsqu’elle se réfère aux limites de la guerre (savoir mettre fin à la guerre, mais aussi poser des limites dans la guerre : ne pas massacrer des ennemis désarmés ou faits prisonniers, ne pas prendre pour cible des populations civiles, secourir l’ennemi s’il est blessé).
Principes qui ont inspiré le droit public européen et la 5ème thèse de la déclaration de Barmen, devant prémunir contre le désir d’extermination : « Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l’État devrait et pourrait, dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, prétendre devenir l’ordre unique et total de toute la vie humaine. »
Le rapprochement avec la parabole du fils prodigue est, ici aussi, très intéressante et éclairante quant à la question de l’autonomie avec Dieu (ce qui l’oppose à l’autre fils, à l’attitude plus passéiste).
Quant à la vision christique, Antigone, elle, « ne ressuscite pas mais, note l’auteur, n’en continue pas moins à vivre dans la mémoire collective », prenant la place d’un paradigme qui marque de son empreinte notre civilisation.
Les problèmes de la modernité
C’est ainsi que les histoires d’Œdipe, Antigone et du fils prodigue illustrent bien, selon notre auteur, les problèmes de la modernité.
Œdipe symbolise l’arrachement à Dieu et à la Tradition (qui va lui coûter cher, jusqu’au pardon final à Colone), l’homme moderne qui prétend se suffire à lui-même, se veut « la mesure de toute chose » et s’affranchit de toute espèce de limite (et donc des lois non écrites), tandis qu’Antigone personnifierait la modernité avec Dieu, le fils prodigue représentant la voie médiane entre les deux (le retour vers le Père, après l’échec de la tentative d’autonomie).
Éric Werner s’intéresse alors à la période de la Seconde Guerre Mondiale qui, selon Ernst Jünger, constituerait une tentative d’achèvement de la Révolution française.
En cause, les millions de morts et de blessés déjà constatés lors de la Première Guerre Mondiale, doublés des multiples « exactions en tous genres : massacres de civils, déportations de populations entières, établissement de camps de concentration, etc. »
Déjà, un certain Winston Churchill constatait avec dépit :
« Ni les peuples ni leurs dirigeants ne posèrent de limite à quelque acte que ce soit qui, pensaient-ils, pourrait les aider à vaincre. »
Ces fameuses limites (l’hybris), dont il est question ici.
Éric Werner établit, à ce stade, un parallèle entre la perte de la foi en l’homme et en les progrès de la civilisation qui s’en est suivie et le phénomène analogue qui s’est produit à la suite de la guerre du Péloponnèse.
C’est là qu’intervient Antigone et l’espoir en la possibilité de construire une civilisation. Par l’incarnation (et non la soumission à Dieu, via la Tradition). À rebours de l’interprétation erronée qu’en a fait Heidegger à dessein, comme le démontre Éric Werner, Sophocle concluant au contraire que « la violence à l’état pur ne mène à rien », là où le philosophe semblait la légitimer, probablement dans le but (mais pas seulement) de dresser une « apologie déguisée du nazisme », faisant dire à Sophocle l’exact contraire de ce qu’il défend.
En définitive, à l’issue de la Grande Guerre, Paul Valéry conclut : « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » Nous entrons alors dans la post-civilisation. Ce qui réjouit Heidegger, qui l’interprète comme l’ère du mouvement (l’homme doit « se mettre en marche au-delà de lui-même »), phénomène que le chœur d’Antigone craint par-dessus tout.
Là où les choses se gâtent sérieusement…
À ce point du livre, passionnant jusque-là, un regret et une déception.
Que devient Sophie Scholl dans tout cela ? À part dans les toutes premières pages, on n’en parle plus. Et la déception, vive : l’aboutissement de toute cette démonstration conduit à ceci :
Éric Werner entend à présent montrer que cette post-civilisation (qui n’en est donc plus une) est celle que Naomi Klein appelle le « capitalisme du désastre ». Aïe. Je ne m’y attendais pas à celle-là…
L’objectif est désormais celui de l’accélération du mouvement, « option nazie » qui s’appuie sur le registre « techniciste, ou encore économiste », en particulier « dans le contexte de l’après-guerre froide et du redéploiement néolibéral consécutif à la chute du mur de Berlin (…) capitalisme qu’on pourrait aussi qualifier de jusqu’au-boutiste, au sens où il s’emploie à éliminer tout ce qui ferait obstacle aux lois du marché (les systèmes de protection sociale, entre autres, mais aussi les lois du travail, les normes environnementales, etc.). Là encore, on assiste à l’effacement de toute limite. »
N’en jetez plus… Toute cette démonstration pour conclure, à travers Antigone (sic), à la monstruosité suprême du capitalisme et du « néolibéralisme » ? Quid du lien de parenté entre pensée libérale et droits naturels, depuis au moins John Locke ? L’auteur ne connaît sans doute pas… Éric Werner serait-il lui-même entré dans la démesure (hybris), en établissant presque un parallèle incroyable entre nazisme et capitalisme ?
Puis on entre carrément dans le tract politico-idéologique :
« En l’espèce, le mouvement pour le mouvement prend la forme de la croissance pour la croissance, processus ayant pour effet non pas l’enrichissement collectif, comme on l’entend dire parfois, mais bien le contraire : l’appauvrissement collectif, en raison même de l’énormité des coûts qu’il occasionne, coûts en termes d’atteintes à l’environnement, d’exploitation sur le lieu de travail, de stress, de maladies diverses et variées, etc. L’alternative est évidemment de refuser une telle logique, concrètement parlant de refuser la deinotès sans la justice des dieux. »
Je vous fais grâce de la suite… (que vous pouvez lire si cela vous chante). Je ressors désespéré de cette lecture. Pourquoi les esprits les plus brillants tombent-ils si souvent dans les mêmes travers, avec les conséquences que l’on connaît parfois, et sont-ils si éloignés des principes qu’ils entendent pourtant défendre, alors qu’ils ont matière à utiliser leurs connaissances de façon tellement plus utile ?
- Éric Werner, Le temps d’Antigone, Xénia Éditions, octobre 2015, 160 pages.

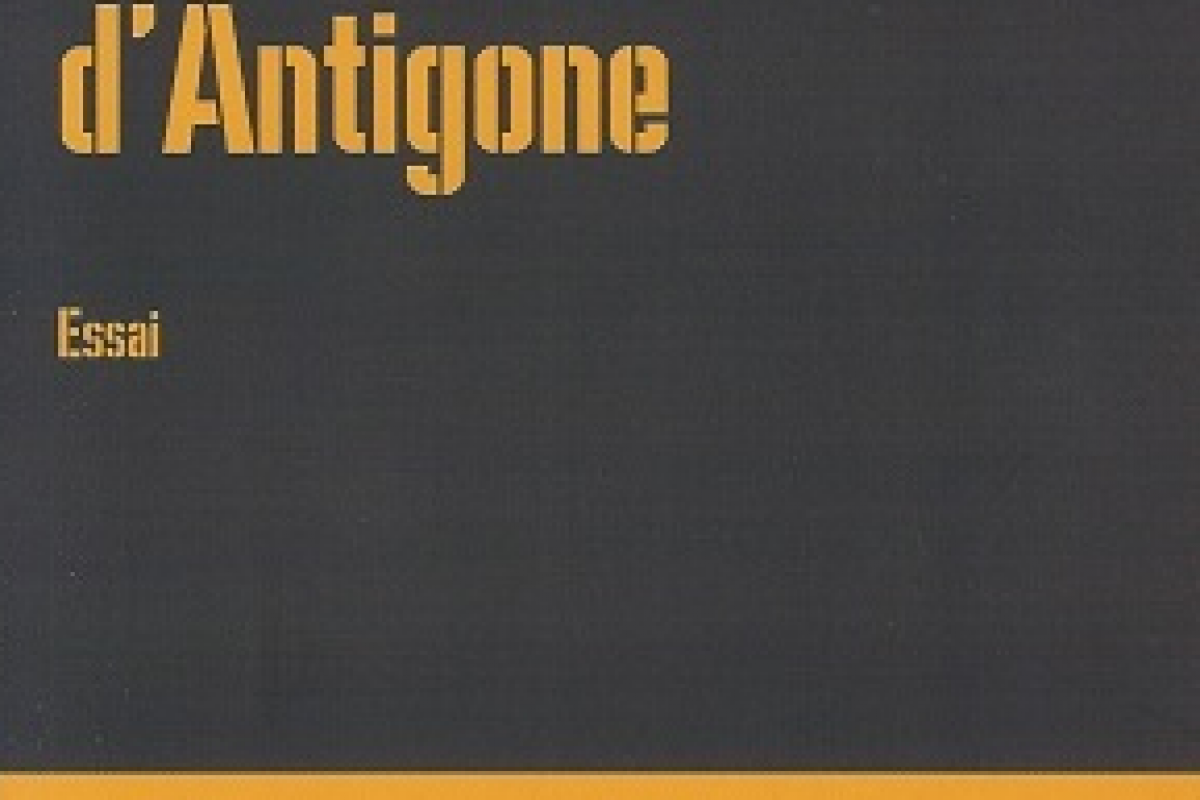

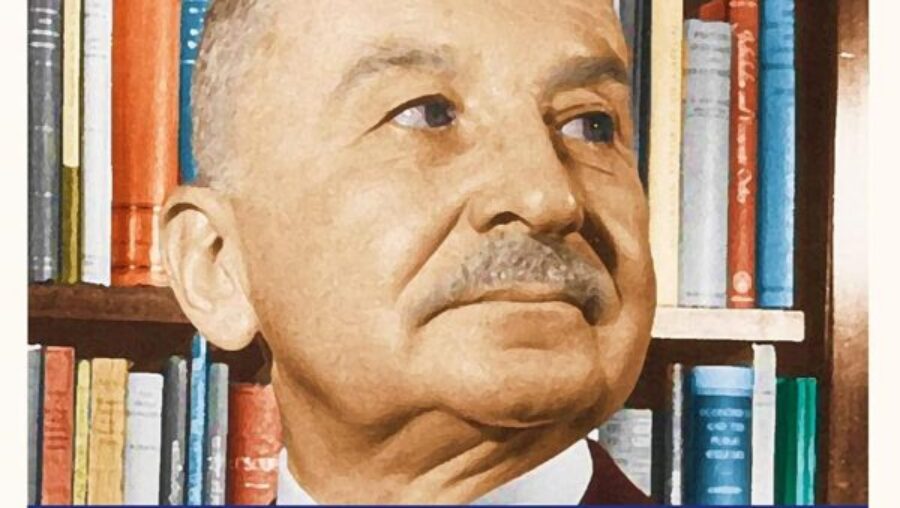

Article tres interessant , et livre sans doute à lire malgré la fin . L’auteur du livre a peut être cédé au diktat pour être dans l’air du temps et se faire publier , belle ironie si c’est le cas et qui sied dont bien à sa conclusion …
Une fois de plus M. Rivalland nous donne un excellent et passionnant article.
La clef de la crise de la modernité, ou du droit naturel moderne pour parler comme Leo Strauss est bien dans ceci : « l’homme moderne qui prétend se suffire à lui-même, se veut « la mesure de toute chose » et s’affranchit de toute espèce de limite (et donc des lois non écrites) », ou encore cette fameuse « autonomie de la volonté » de Kant.
De là, il n’est pas sûr que M. Rivalland ait tout à fait raison quant à la conclusion « décevante » du livre. Certes, on peut voir rouge en constatant qu’au bout on trouve Naomi Klein. Mais il y a capitalisme et capitalisme, l’un reposant sur la propriété privée et le respect de la loi naturelle, l’autre reposant exclusivement sur l’appât du gain et se servant de privilèges et de l’Etat, et favorable aux transgressions.
Une certaine marchandisation chère au libertaires, peut entraîner de graves dérives, comme, je cite en vrac, la GPA, peut-être la GPA, l’avortement et la vente d’organes, l’euthanasie, maintenant étendue ou en voie de l’être, aux enfants, dans certains pays. On pourrait ajouter le mariage unisexuel, qui en lui n’a pas la gravité des autres transgressions, mais est symptomatique de l’homme se déifiant.
Saint Augustin définissait ainsi le péché originel : « amor sui usque ad contemptum Dei ».
Si on ne garde pas à l’esprit cet avertissement, cette conscience des limites, le capitalisme peut ressembler à son contraire, car l’hubris n’est pas enfoui profondément en nous.
Merci, Hildebrand, pour votre intervention très pertinente.
Je ne nie pas qu’Eric Werner puisse avoir en partie raison. Certains points qu’il évoque vont bien dans le sens de l’excès, de la démesure. Et loin de moi l’idée de vouloir dresser un portrait idéaliste du capitalisme, qui serait le plus parfait des systèmes.
Cependant, il globalise son raisonnement et n’établit absolument pas la distinction que vous définissez.
Je crains qu’il ne rejette le capitalisme “d’un bloc”, comme pervers dans son essence et que certains termes ou certaines idées ne laissent penser à une sorte d’appel à une “révolution” (selon les préceptes marxistes), sans qu’il le lance toutefois (on serait peut-être plus proches, ici, d’un “Indignez-vous” à la Stéphane Hessel).
En réalité, l’auteur reste dans le flou dans ce qu’il préconise comme réaction. Tout juste ne fait-il que constater et en appeler à une réaction. Mais laquelle ? Celle du retour au Nomos, certes, mais plus précisément, en l’occurrence ?
Pour le reste, je ne puis qu’adhérer pleinement à l’idée que nous n’évoluons pas dans une forme saine de capitalisme. En cela, je suis totalement l’idée de Jean-Marc Daniel à travers ce qu’il appelle le “capitalisme de connivence” (http://www.contrepoints.org/2015/04/09/203851-eloge-de-la-concurrence-contre-la-connivence), ou plus précisément “L’Etat de connivence”. Un ouvrage que je désire commenter depuis près d’un an (ce que je me déciderai à faire un jour ou l’autre, tant cet ouvrage me parait majeur).
Quant aux graves dérives que vous soulignez à travers les quelques exemples que vous donnez, sont-ils le fait du capitalisme ? Cette inquiétante marchandisation (d’organes, etc.) n’est-elle pas plutôt le fait de personnes ou d’entités malfaisantes nullement liées au système capitaliste en particulier ? Ne trouve-t-on pas les mêmes phénomènes dans des pays dits communistes, des économies de types tribales, des mafias (auxquelles le système de référence importe peu) ?
En définitive, il n’est pas certain que le capitalisme soit le système qui encourage le plus ce genre de pratiques, même si les dérives sont bien réelles.
Et, encore une fois, on en revient au respect du droit naturel, des droits fondamentaux de l’être humain et à la “conscience” (le mot le plus important, non prononcé hélas par Eric Werner, même si je me permets de l’énoncer moi-même une fois vers le début de l’article, qui symbolise selon moi Sophie Scholl et le message qu’elle transmet à l’ensemble de l’humanité). Quels regrets que l’auteur ait négligé Sophie Scholl, qui n’a servi que de prétexte artificiel à son écrit, là où j’attendais qu’il en fasse le coeur de son ouvrage, comme le quatrième de couverture le laissait penser !
Et, en fin de compte, c’est vous qui détenez la parfaite conclusion, avec votre dernière phrase, où vous vous référez bien, en effet, à cette “conscience des limites” que nous devons en permanence garder à l’esprit si on ne veut pas dévoyer le capitalisme (sans qu’on ait besoin de se référer forcément à un système, d’ailleurs) et tomber dans l’hybris.
Cher Johan Rivalland,
Je ne connais pas l’auteur du livre, mais je vous crois tout à fait lorsque vous évoquez le rejet du capitalisme en bloc. En effet, lorsque je lis des articles ou livres critiquant le capitalisme, je dois souvent constater que ce qu’ils dénoncent, ce n’est pas tant le marché libre et le droit de propriété privée, mais bien un capitalisme de connivence, un capitalisme se servant de la puissance publique pour exploiter les clients. Tenez, le livre de Stiglitz sur les inégalités : la plupart des critiques en fait viennent de la proximité des capitalismes et des hommes de l’Etat. Cela dit, je pense que beaucoup rejettent le capitalisme en bloc par simple haine à priori, et lorsqu’ils trouvent de bons arguments, refusent de faire la distinction intellectuelle qui s’impose. Vous évoquez les fameux « indignés », ce qui me fait repenser à ceci :
http://blog.turgot.org/index.php?post/Braun-Ropke
Sinon, le reste aussi sur ma faim quant à Sophie Scholl, mais dans mon cas, à ma honte, c’est que je ne sais pas qui elle était et comptait apprendre quelque chose.
Vous m’interrogez sur l’imputabilité des transgressions au capitalisme, en notant qu’on voit ces choses ailleurs. Vous avez raison, et j’ai pu n’être pas clair. Ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas lié à un système particulier, mais à des aspects de l’humanité, c’est pourquoi on les trouve partout. La cupidité n’a pas de couleur. En revanche, certains libertaires au nom d’un principe de liberté absolue, poussent à l’adoption de législations normalisant ces choses que je dénonce, comme par exemple la GPA, ou le commerce des bébés. Ce qui est ironique, c’est qu’il y a aussi une alliance objective entre les libertaires et les étatistes, ces derniers se chargeant d’aider les premiers à vivre leur vie dégagée de toute contrainte morale, en détruisant les corps intermédiaires entre l’individu et l’Etat, et en les subventionnant ensuite.
Sans le Droit naturel, qui fonde et limite la liberté à la fois, je crains que la civilisation soit en danger. Aristote a si bien dit la chose dans sa Politique (Livre 1 chapitre 1, in fine, dans la traduction de Barthélémy-Saint-Hilaire, mais j’ai vu une traduction en anglais encore plus saisissante) :
« (…) si l’homme, parvenu à toute sa perfection, est le premier des animaux, il en est bien aussi le dernier quand il vit sans lois et sans justice. Il n’est rien de plus monstrueux, en effet, que l’injustice armée. Mais l’homme a reçu de la nature les armes de la sagesse et de la vertu, qu’il doit surtout employer contre ses passions mauvaises. Sans la vertu, c’est l’être le plus pervers et le plus féroce; il n’a que les emportements brutaux de l’amour et de la faim. La justice est une nécessité sociale ; car le droit est la règle de l’association politique, et la décision du juste est ce qui constitue le droit. »
Très belle citation, qui résume parfaitement bien notre sujet.
Quant à l’excellent article d’Olivier Braun, dont je vous remercie pour la référence, il permet particulièrement bien d’illustrer le terrible malentendu qui perdure effectivement à l’encontre du capitalisme et de ses maux, ainsi que vous l’expliquez.
Avant de présenter les idées de Wilhelm Röpke, Olivier Braun souligne à juste raison, à propos des adversaires du capitalisme, ou tout au moins de beaucoup d’entre-eux, “qu’ils se trompent de cible” concernant “certaines de leurs critiques (qui) peuvent être fondées”.
Et son évocation du “capitalisme de connivence” chez Röpke (déjà) m’a beaucoup intéressé.
Sur Sophie Scholl, si cela vous intéresse, outre les écrits sur la Rose blanche (http://www.amazon.fr/rose-blanche-Inge-Scholl/dp/270732051X/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1446126272&sr=1-2&keywords=la+rose+blanche), je vous conseille tout particulièrement le film suivant, qui m’a permis de découvrir le personnage :
http://www.amazon.fr/Sophie-scholl-Julia-Jentsch/dp/B000KIX6JY/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&dpID=519aN8n-71L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR127%2C160_&refRID=1W55PK80MBXR01K5M6MJ&dpID=519aN8n-71L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR127%2C160_
Bien cordialement.
Merci pour les références. Je vais profiter de mon séjour en France la semaine prochaine pour acheter le film.