Par Jean-Baptiste Noé
 La recherche sur l’histoire du vin progresse et nous permet ainsi de mieux comprendre la constitution de l’Europe viticole que nous connaissons aujourd’hui. Après s’être intéressée à la culture viticole, la recherche actuelle se penche de plus en plus sur les notions juridiques du vin. Cela peut paraître un peu fastidieux, mais outre qu’il n’en est rien, c’est surtout essentiel pour bien circonscrire la formation des grands vignobles.
La recherche sur l’histoire du vin progresse et nous permet ainsi de mieux comprendre la constitution de l’Europe viticole que nous connaissons aujourd’hui. Après s’être intéressée à la culture viticole, la recherche actuelle se penche de plus en plus sur les notions juridiques du vin. Cela peut paraître un peu fastidieux, mais outre qu’il n’en est rien, c’est surtout essentiel pour bien circonscrire la formation des grands vignobles.
Le présent ouvrage est la publication des actes d’un colloque mené à Bordeaux sur le thème de la construction de la grande propriété viticole en France et en Europe, du XVIe au XXe siècle. Plusieurs historiens y ont participé, traitant de différentes régions françaises ainsi que de l’Espagne et de l’Italie.
Ce livre étudie le rôle des élites dans la mise en place de la grande propriété viticole. En effet, ces grands domaines sont les acteurs essentiels de la valorisation des vins et de la fabrique de la qualité. Alors que, dans l’esprit des consommateurs, la grande propriété est souvent associée à la standardisation des goûts et au nivellement de la qualité, et la petite propriété à une expression plus authentique des terroirs, l’ouvrage montre bien que c’est l’inverse qui s’est joué dans l’histoire, et que ce furent les grands vignobles qui ont bâti la grande qualité que nous connaissons aujourd’hui. Souvent, les petites propriétés n’ont fait que suivre le mouvement, ou bien ont disparu pour celles qui sont restées trop standardisées.
Le bon vin est un produit de culture et de finance. Il faut de l’argent pour investir dans des techniques de plus en plus modernes, il faut des capitaux pour s’ouvrir des marchés et pour mener des campagnes publicitaires. Ces moyens, seuls les gros domaines ont pu les fournir. Et seuls les clients fortunés ont pu suivre les prix nécessités par ces investissements. Comme toujours en histoire, connaître le passé est essentiel pour tisser des perspectives d’avenir et d’espoir.
- Collectif, La construction de la grande propriété viticole en France et en Europe, XVI-XXe siècle, Feret , février 2015, 286 pages.
—
Sur le web.

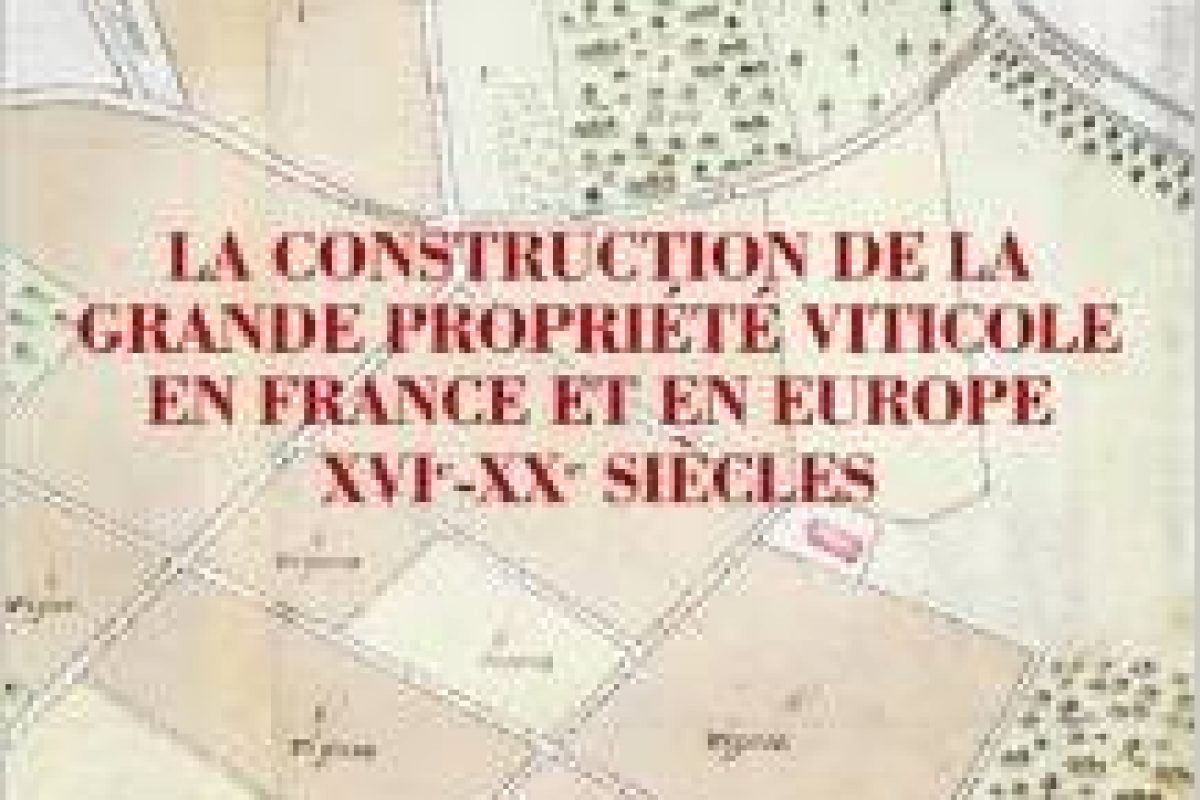



oui les grands domaines, le châteaux ont fait et font encore l’embelli de la tradition du vin qui est un produit du terroir. Le passé historique des grandes familles accompagnent ces belles demeurent ornées de magnifiques massifs fleuris et d’arbres anciens. Il est franchement regrettables que ces propriétés soient vendues à des asiatiques.
Quant au petit ouvrier viticole on en parle moins. Il fait bien parti de la chaîne de production tout comme le tractoriste.
Dans cette chaine de production qualitative, Il faut un chef de culture, un œnologue etc….et ensuite il faut un commercial pas facile à concilier tout cela.
Heureusement les unions coopératives existent pour la vinification et le commerce. Pour asseoir cette commercialisation, il faut s’occuper de près de l’État sanitaire et de la maturité du raisin.
Pas facile le métier de l’exploitant viticole au fil des saisons
Parlez moi des usines à vin de la Nouvelle Zélande ou de l’Australie. Du leadership américain dans ses grandes propriétés californiennes qui sont arrosées quotidiennement avec leur maître à goûter Parker.
Que devient le vin de garde puisqueon fait du vin “scientifique” au gout américain.
J’ai vu non loin de Santiago de Chile une tres belle propriété de Concha Y toro qui vous faisait déguster un vinaigre épouvantable.
Est ce que Pomerol est un grand terroir et combien vaut une bouteille de Petrus?
le pomerol est une aire infiniment petite où le vin se vend très bien. la pierre et la terre font bon ménage. Ce que l’on ne voit pas lors de la parade commercial est le travail fourni par ces femmes et ces hommes payés au SMIC horaire pour “tirer les cavaillons, ebourgeonner pour reguler la production trop intense”.et bien d’autres choses que j’oublie.
il est curieux que le Portugal cultive des treilles. Des vignes hautes sur pied et les vendangeurs prennent des échelles pour cueillir le raisin. Dans le Médoc c’est quasiment l’inverse, les vignes dont très basses.