Par Philippe Silberzahn
La complexité du processus d’innovation et l’incertitude à laquelle sont confrontés les entrepreneurs a posé depuis longtemps la question de l’approche générale du processus entrepreneurial. Une approche qui se développe ces derniers temps est celle d’échouer vite (« fail early »). En substance, l’idée est que comme on ne peut pas trop savoir où l’on va, il faut essayer quelque chose, voir rapidement si ça marche et si ça ne marche pas, abandonner et essayer autre chose. Cette idée est séduisante : elle appelle à une ouverture d’esprit et flatte l’entrepreneur en mettant en avant sa capacité à prendre de difficiles décisions. Elle est toutefois dangereuse car, comme souvent dans ces cas-là, elle repose sur une conception implicite, mais erronée, du processus d’innovation, que ce soit pour l’entrepreneur ou pour l’entreprise existante. Regardons pourquoi.
Dans un article précédent, je montrais au travers du cas des kits photoélectriques en Afrique en quoi l’innovation est un processus social dans lequel l’action de l’innovateur (ou de l’entrepreneur) consiste à créer un réseau de valeur constitué d’un ensemble d’acteurs (clients, fournisseurs, préconisateurs, partenaires, régulateurs, etc.) qui deviennent parties prenantes au projet. La nature sociale de la démarche de l’innovateur en fait donc un processus extrêmement complexe et fastidieux. Il faut convaincre les parties prenantes de s’engager dans le projet une à une.
 De cela il résulte que la phase initiale d’un projet d’innovation de rupture (en gros jusqu’au moment où le modèle d’affaire est déterminé) peut durer très longtemps : Adobe a mis près de dix ans pour que sa technologie PDF soit rentable, Nestlé en a mis plus de vingt pour Nespresso. On voit au travers de ces exemples les limites des impératifs que l’on entend souvent dans le domaine de l’innovation, selon lesquels ce qu’il faut c’est échouer le plus vite possible pour essayer autre chose. Bien au contraire, l’innovation de rupture n’est pas un jeu statistique, elle n’est pas non plus une suite d’essais-erreur, mais beaucoup plus la construction patiente d’un réseau de valeur, une partie prenante à la fois. Il est parfaitement possible que le projet ne produise pas grand-chose en termes de chiffre d’affaires pendant longtemps, mais il serait suicidaire de l’interrompre à cause de cela. C’est un peu comme un viaduc : vous devez construire dix-sept piliers ; vous en construisez seize, et à ce moment-là le financier de l’entreprise arrive et dit : « ça fait seize piliers que je finance et pas une seule voiture n’a encore pu traverser le viaduc, on arrête tout. » En fait le viaduc n’est pas une image si bonne que cela car au moins, dans ce cas, on sait où l’on va et combien de piliers il reste à construire. Dans le processus d’innovation, on sait très rarement où l’on en est, et ce n’est que lorsqu’il est terminé qu’on sait qu’on a effectivement terminé.
De cela il résulte que la phase initiale d’un projet d’innovation de rupture (en gros jusqu’au moment où le modèle d’affaire est déterminé) peut durer très longtemps : Adobe a mis près de dix ans pour que sa technologie PDF soit rentable, Nestlé en a mis plus de vingt pour Nespresso. On voit au travers de ces exemples les limites des impératifs que l’on entend souvent dans le domaine de l’innovation, selon lesquels ce qu’il faut c’est échouer le plus vite possible pour essayer autre chose. Bien au contraire, l’innovation de rupture n’est pas un jeu statistique, elle n’est pas non plus une suite d’essais-erreur, mais beaucoup plus la construction patiente d’un réseau de valeur, une partie prenante à la fois. Il est parfaitement possible que le projet ne produise pas grand-chose en termes de chiffre d’affaires pendant longtemps, mais il serait suicidaire de l’interrompre à cause de cela. C’est un peu comme un viaduc : vous devez construire dix-sept piliers ; vous en construisez seize, et à ce moment-là le financier de l’entreprise arrive et dit : « ça fait seize piliers que je finance et pas une seule voiture n’a encore pu traverser le viaduc, on arrête tout. » En fait le viaduc n’est pas une image si bonne que cela car au moins, dans ce cas, on sait où l’on va et combien de piliers il reste à construire. Dans le processus d’innovation, on sait très rarement où l’on en est, et ce n’est que lorsqu’il est terminé qu’on sait qu’on a effectivement terminé.
Plus le projet est un projet de rupture, plus il se développe dans un environnement incertain. Dans ce type d’environnement, la démarche d’essai-erreur fonctionne mal. Quelque chose peut échouer, mais on peut avoir intérêt à continuer néanmoins : Nespresso a ainsi connu deux échecs de lancement avant de réussir la troisième fois. Le risque avec le credo « échouer vite pour essayer autre chose » n’est pas seulement d’abandonner trop tôt, mais surtout d’abandonner pour de mauvaises raisons sans pouvoir tirer les leçons d’un premier échec. Cet impératif est plus une attitude macho de gens peu au fait de ce qu’est l’innovation qu’un guide pratique pour l’innovateur.
—
Sur le web.

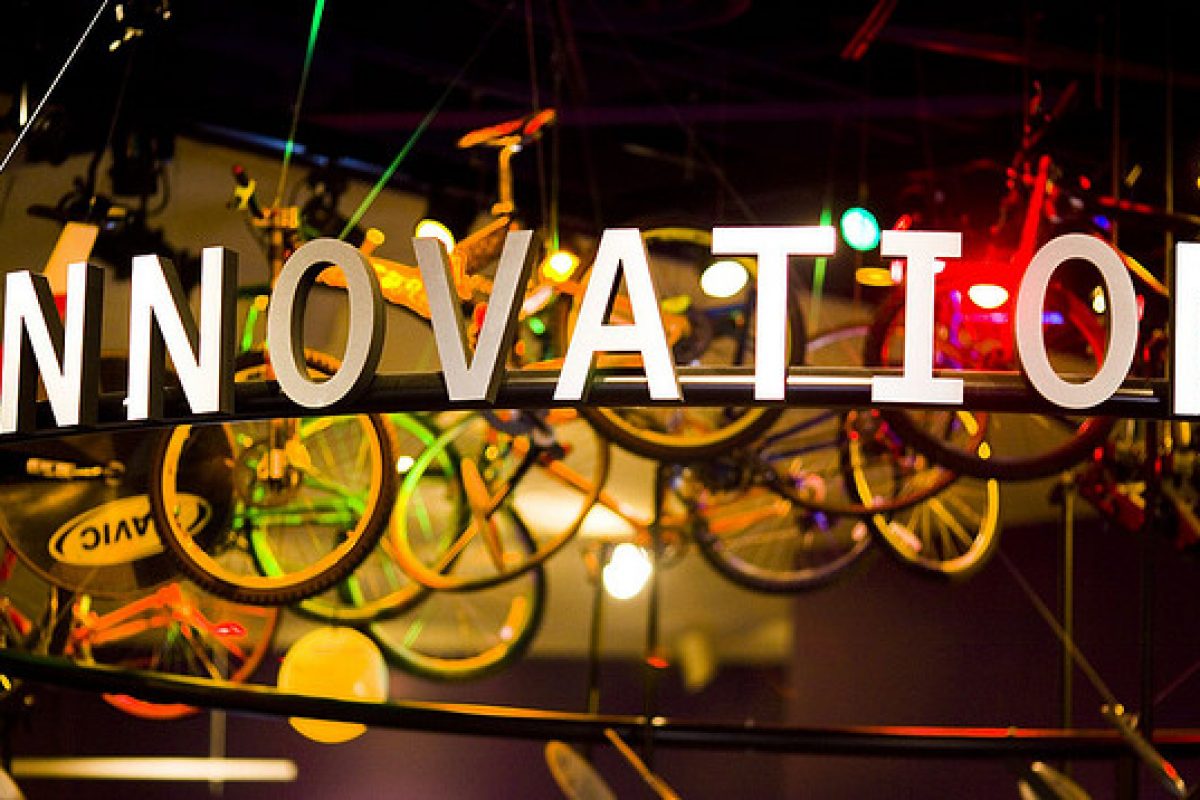

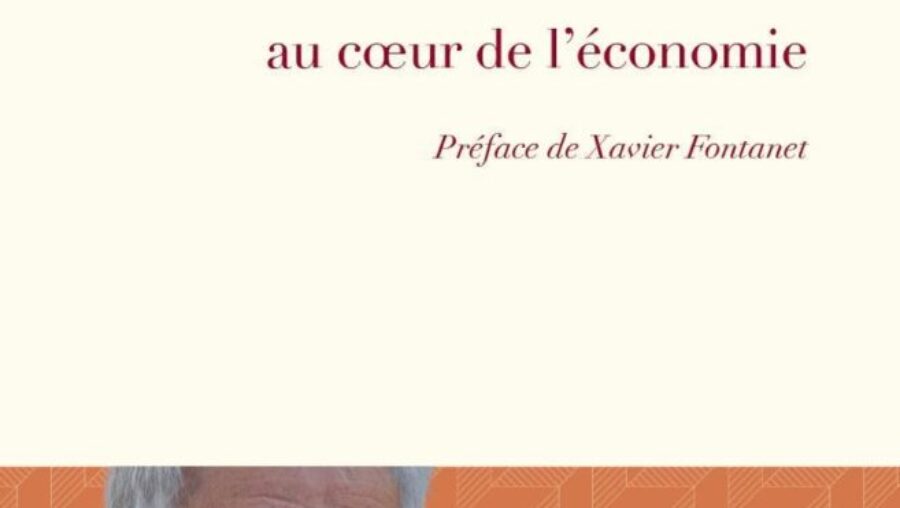
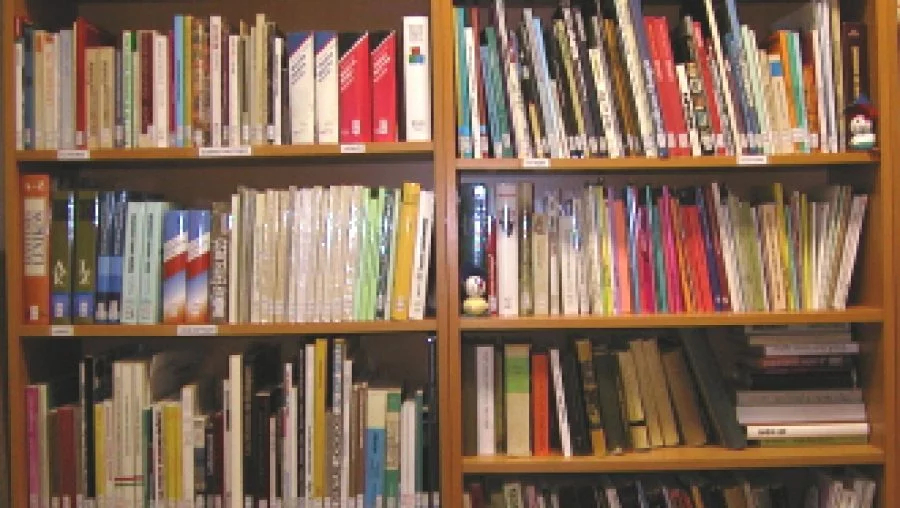

Pour moi la conclusion est qu’il faut commencer “petit” et sur une partie limitée de l’activité de l’entreprise. On tire les mêmes enseignements d’un projet à petite échelle qu’à grande échelle. En revanche aucun banquier ou actionnaire sensé ne suivra l’entrepreneur en risquant l’ensemble du capital mais sans aucune visibilité sur les chances même de réussite.
Plus facile à dire qu a faire… Une fois le brevet payé( ou les!), les frais juridiques, le tps de développement… Il faut avoir les reins solides. Prendre le tps s adresse aux grosses Pme. Nous avons 300000€ (argent perso+bpi+reseau initiative+banque)… On est en mode start-up… Quand y en aura plus y en aura plus:-)