Par Francis Richard.
L’alcool, voilà l’ennemi. Alors que la consommation dans nos pays n’a jamais été aussi basse depuis 50 ans… En fait, les boissons alcoolisées devraient être inscrites au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. Car elles ont inspiré, entre autres, les plus grands poètes. Je pense spontanément aux libations homériques, mais, beaucoup plus près de nous, au “Vin des amants”, ce sonnet de Charles Baudelaire:
Aujourd’hui l’espace est splendide !
Sans mors, sans éperons, sans bride,
Partons à cheval sur le vin
Pour un ciel féerique et divin !Comme deux anges que torture
Une implacable calenture,
Dans le bleu cristal du matin
Suivons le mirage lointain !Mollement balancés sur l’aile
Du tourbillon intelligent,
Dans un délire parallèle,Ma sœur, côte à côte nageant,
Nous fuirons sans repos ni trêves
Vers le paradis de mes rêves !
Ou encore à ces vers d’Alfred de Musset – ce grand frère qui a traîné ses guêtres à Henri IV bien avant moi –, extraits de son poème dramatique “La coupe et les lèvres” :
L’amour est tout, — l’amour, et la vie au soleil.
Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ?
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ?
Faites-vous de ce monde un songe sans réveil.
S’il est vrai que Schiller n’ait aimé qu’Amélie,
Goethe que Marguerite, et Rousseau que Julie,
Que la terre leur soit légère ! — ils ont aimé.
 Boire sans mesure est nocif, j’en conviens. Comme toute démesure. Est-ce raison suffisante pour déclarer plus que jamais la guerre à l’alcool à grands renforts d’interventions étatiques ?
Boire sans mesure est nocif, j’en conviens. Comme toute démesure. Est-ce raison suffisante pour déclarer plus que jamais la guerre à l’alcool à grands renforts d’interventions étatiques ?
Dans des domaines de plus en plus étendus, les femmes et les hommes sont considérés comme des enfants par l’État. Ils ont le droit de vote. Ils peuvent faire des enfants à leur tour et à leur guise (en Chine ce droit leur a été retiré pendant un temps, avec les dégâts que l’on sait). Mais, quand il s’agit, par exemple, du tabac, du cannabis ou des boissons énergétiques, de leur santé d’une manière plus générale, ils deviennent tout à coup miraculeusement irresponsables.
Quant à l’alcool, “plutôt que de faire confiance à l’individu, de nombreuses personnes pensent qu’il incombe à l’État d’en réguler la production et le commerce, tout comme il le fait pour des produits bien plus dangereux” dit François Monti dans l’introduction à son livre, Prohibitions.
Il n’a pas fallu attendre l’apparition de l’État-providence et de l’État-nounou pour qu’il en soit ainsi. En effet, dans ce livre, l’auteur fait le récit de trois prohibitions qui, en définitive, ont provoqué plus de dommages que de bienfaits (toujours les bonnes intentions affichées, en réalité autres, dont l’enfer serait pavé) :
- La folie du gin au Royaume-Uni, entre 1689 et 1760,
- La prohibition itself, aux États-Unis, entre 1919 et 1933,
- Les ailes coupées de la fée verte, en France, en 1915.
Intéressons-nous ici à La folie du gin (ce qui ne dispense pas le lecteur de lire les chapitres consacrés aux deux autres), qui est la première et la moins connue, et qui est l’illustration parfaite du principe des calamités de Michel de Poncins : “Une calamité d’origine publique conduit toujours à une autre calamité pour soi-disant corriger la première”.
Les calamités successives de la folie du gin figurent ainsi un parcours de corrections en montagnes russes qu’il convient de mettre en perspective, en ayant présent à l’esprit que “on” c’est l’État britannique :
- En 1690, on libéralise la distillation des spiritueux de grain (c’était auparavant le monopole de la Compagnie des distillateurs, dont l’objet était médicinal).
- On protège les spiritueux anglais des spiritueux français (on est en guerre avec la France, c’est la guerre de la Ligue d’Augsbourg), mais on les avantage par rapport aux bières, toujours réglementées ; du coup le gin, plus nocif, est davantage consommé que la bière par les personnes les plus pauvres (les riches ont les moyens de se procurer les alcools qu’ils veulent et notamment, par contrebande, les alcools français).
- En 1729, pour lutter contre les méfaits du gin sur la santé des pauvres, on ne l’interdit certes pas, mais on en taxe le distillat pur et ce sont donc seuls ceux qui le transforment en gin qui sont touchés, les autres boissons alcoolisées étant exemptes de cette taxe de circonstance.
- Pour échapper à cette taxe, les petits producteurs contournent la loi et vendent de l’alcool pur, de mauvaise qualité et toxique : il en résulte que le rendement de la taxe au lieu d’augmenter baisse, ce qui n’arrange finalement pas du tout l’État, qui abroge cette taxe en 1733.
- Toute une campagne mensongère est alors menée pour grossir les méfaits du gin et, cette fois, en 1736, non seulement le gin légal est fortement taxé et inaccessible aux petits et aux sans grade, mais sa version illégale est sévèrement réprimée, avec pour contrepartie crime et corruption organisés : la consommation augmente inexorablement de 30%…
- En 1742, guerre de Succession d’Autriche oblige, l’État ayant besoin de sous, on augmente autant les taxes sur les céréales maltées que sur l’alcool et on diminue le coût de la licence.
- En 1751, on n’a plus besoin de sous, mais on saura trouver une utilité aux taxes qui augmentent à nouveau de même que le prix de la licence.
- Entre 1757 et 1761, les récoltes étant mauvaises, on interdit la distillation, puis quand les bonnes années reviennent, on l’autorise tout en augmentant les taxes à nouveau sous la pression de tous ceux qui y trouvent un bénéfice (brasseurs, planteurs etc.) et on subventionne les gros distillateurs pour qu’ils puissent exporter, en empêchant tout nouveau venu sur le marché, qui pourrait leur faire ombrage.
Cette folie régulatrice s’est-elle traduite par une baisse de la consommation ? On pourrait le penser puisqu’en fin de période elle baisse effectivement, mais c’est se méprendre sur la cause. En réalité l’économie est devenue plus ouverte ; le niveau de vie a augmenté ; les infrastructures se sont améliorées : les gens boivent moins parce qu’ils ont d’autres loisirs… que de boire sans soif.
S’est-on jamais soucié réellement du bien-être des gens ? Non, l’État, derrière cette façade honorable, a toujours décidé en fonction de ses intérêts politiques ou économiques. Quand on augmente les taxes pour prétendument protéger les consommateurs, en réalité pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, on favorise l’émergence de produits de moindre qualité et la contrebande, et on punit ceux qui ont le moins de moyens. Quand on interdit un produit, c’est qu’il ne rapporte plus à l’État et ne présente donc plus d’intérêt, et on donne satisfaction aux hygiénistes ou aux soi-disant vertueux.
Quand on taxe ou quand on interdit, on privilégie toujours les uns, par connivence, au détriment des autres. Au nom de quoi taxe-t-on ou interdit-on ? On le fait parce que, prétend-on, on sait ce qui est bon et bien, mieux que vous. Alors soyez dociles, comme les éternels enfants que vous êtes et que vous devez rester pour mieux être asservis.
— François Monti, Prohibitions, Les belles lettres, 2014, 80 pages.
—
Sur le web.

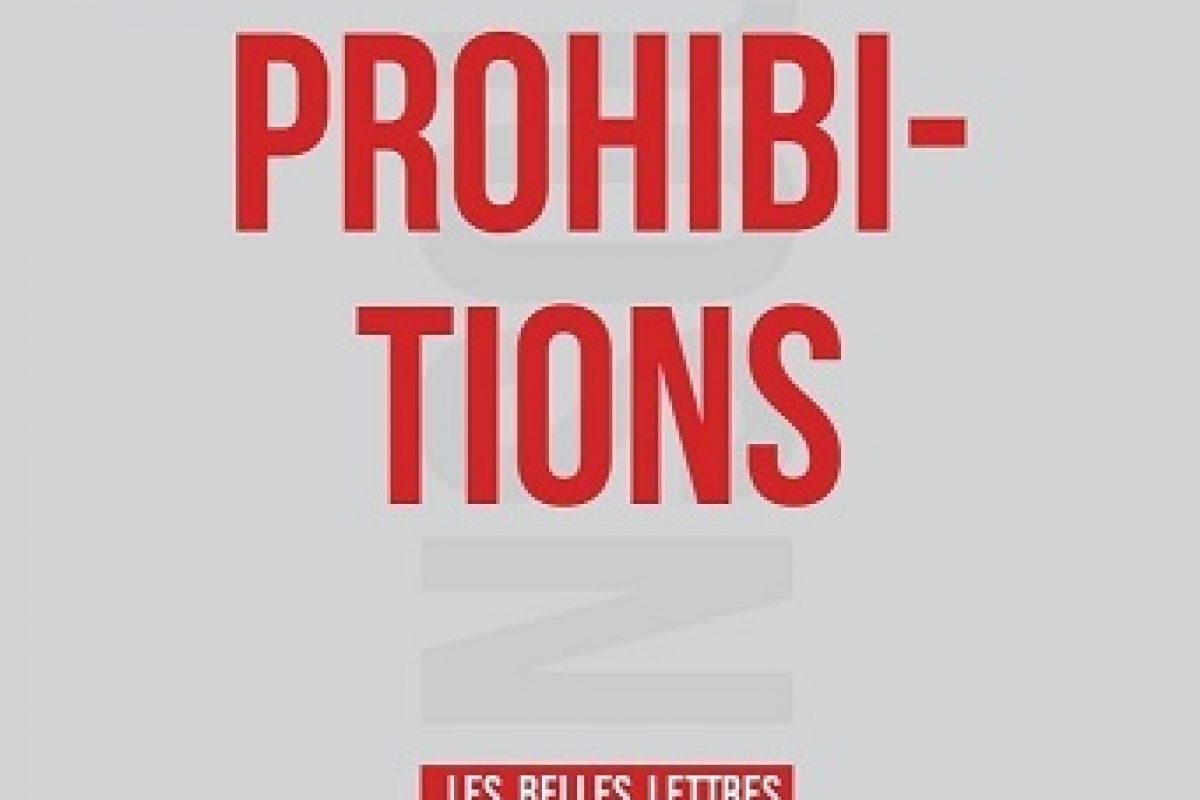
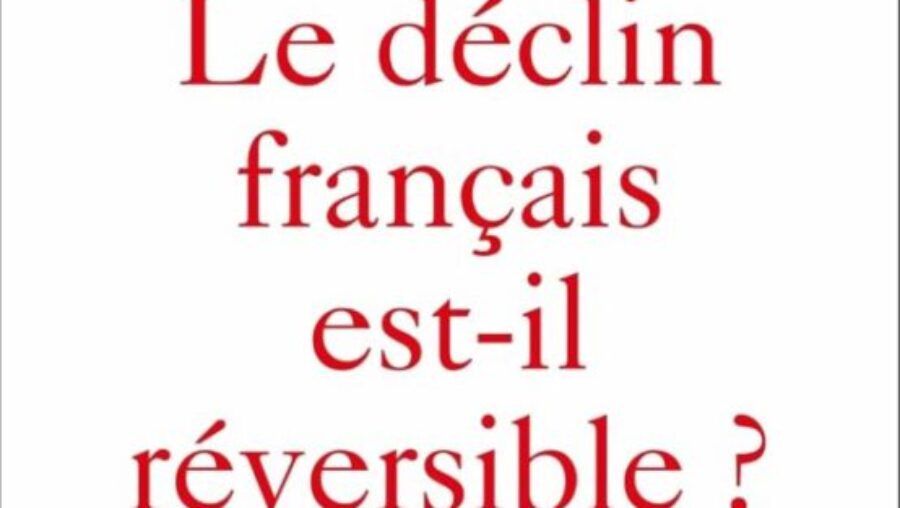
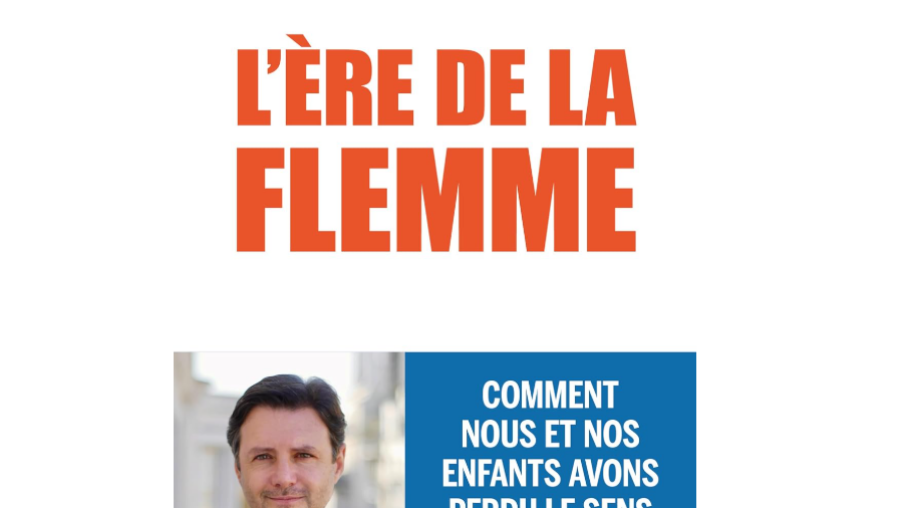

Laisser un commentaire
Créer un compte