La loi de séparation de l’Église et de l’État, dépassée car incarnant une laïcité de combat ? Pas vraiment…
Par Roseline Letteron.

Certains considèrent aujourd’hui que la loi de séparation de l’Église et de l’État est dépassée, car trop dogmatique, trop autoritaire, incarnant une laïcité de combat qui n’aurait plus cours aujourd’hui. Le combat pour la laïcité n’a pourtant pas disparu, comme en témoignent les débats qui ont précédé la loi sur la dissimulation du visage dans l’espace public, ou ceux qui se développent aujourd’hui sur le mariage pour tous.
Or la loi de 1905 demeure un instrument juridique indispensable pour distinguer clairement l’espace de la vie privée de celui de la vie publique. Dans le premier, les libertés de religion et de culte peuvent s’épanouir librement, dans le second en revanche, les convictions religieuses ne peuvent s’exprimer. Cette longévité de la loi de 1905 s’explique précisément par l’absence de ce dogmatisme que certains croient pourtant déceler dans ses dispositions.
Un arrêt du Conseil d’État rendu le 26 novembre 2012 illustre parfaitement ce pouvoir d’adaptation. Comme chacun sait, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est un établissement public industriel et commercial, dont l’objet est de participer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’économie d’énergie (art. L 131-3 c. environnement). À ce titre, elle offre des aides directes à la réalisation de certains projets, notamment en matière d’économie d’énergie. La congrégation religieuse de la Chartreuse de Portes, installée dans l’Ain, sollicite justement l’une de ces subventions, afin de l’aider à installer une chaudière à bois qui permettrait de chauffer les moines en utilisant les ressources d’une région largement boisée.
Rien de très choquant dans l’objet des travaux qui entrent parfaitement dans les missions dévolues à l’ADEME, celle-ci développant à l’époque des faits un “plan bois énergie” qui préconise l’installation de ce type de chaudière. La subvention demandée est pourtant refusée aux Chartreux, au motif que cette communauté a des activités liées au culte, et que l’article 2 de la loi de 1905 énonce que “La République (…) ne subventionne aucun culte“. Ce refus est successivement annulé par la Cour administrative d’appel, puis par le Conseil d’État, qui s’appuient sur une jurisprudence libérale dans ce domaine.
L’interdiction de subvention, un champ d’application étroit
L’article 2 conduit à considérer comme illégale toute subvention versée directement aux associations cultuelles, groupements créés sur le fondement de la loi de 1905 et dont l’objet exclusif est l’exercice public du culte. Cette interdiction ne concerne cependant que l’activité cultuelle, au sens le plus étroit du terme. Le droit positif se montre donc beaucoup plus libéral, lorsque la subvention ne vise pas directement l’exercice du culte.
D’une part, la loi de 1905 elle-même prévoit ses propres dérogations, avec par exemple la possibilité, pour la collectivité publique, de subventionner des aumôneries dans les services publics, l’armée ou l’enseignement. D’autre part, aucune loi n’interdit de rémunérer des prestations spécifiques. Dans un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d’État estime ainsi que la rémunération versée par l’administration pénitentiaire à une congrégation pour le soutien et la prise en charge de détenus n’est pas contraire à la loi de 1905.
Enfin, et c’est précisément la dérogation invoquée dans l’affaire de la chaudière à bois de nos Chartreux, rien n’interdit le financement public d’activités non religieuses assurées par des organismes à caractère confessionnel. Il est vrai que, la plupart du temps, cette faculté est facilitée par la constitution d’une association de la loi de 1901, indépendante de la communauté religieuse, et qui pourra recevoir la subvention pour développer une activité, par exemple de soin ou d’enseignement. Même en l’absence de ce type de structure, le Conseil d’État considère, dans un arrêt du 4 mai 2012, que la ville de Lyon peut financer un colloque organisé par une congrégation, dès lors que cette manifestation est ouverte à tous et reçoit des participants de confessions différentes.
L’intérêt général
In fine, c’est la notion d’intérêt général qui guide le juge. La subvention est, en effet, licite si elle répond à un besoin d’intérêt général entièrement dépendant des aspects religieux de l’activité du demandeur. C’est sur ce fondement que, dans une décision du 19 juillet 2011, le Conseil d’État a considéré que la mise à disposition des musulmans d’un lieu d’abattage des ovins par une communauté urbaine n’a pas pour objet de financer un culte, mais répond à une préoccupation d’intérêt général, en l’espèce la protection de l’hygiène publique. Dès lors, il est parfaitement logique de considérer que la chaudière à bois des Chartreux est d’abord considéré comme l’instrument d’une politique d’économie d’énergie qui touche l’ensemble de la population, cloitrée ou non.
Cette jurisprudence témoigne de la grande souplesse de la loi de 1905. Car nul n’ignore que le culte va bénéficier, en quelque sorte par ricochet, de ces aides publiques. Lorsqu’une commune restaure l’orgue de l’église, elle permet l’organisation de concerts, mais aussi d’une grand-messe du dimanche un peu plus attractive. Lorsque l’ADEME donne une subvention pour le chauffage des Chartreux, elle leur permet d’avoir moins froid, y compris pendant les offices. Mais la lutte contre le rhume est aussi une politique d’hygiène publique.

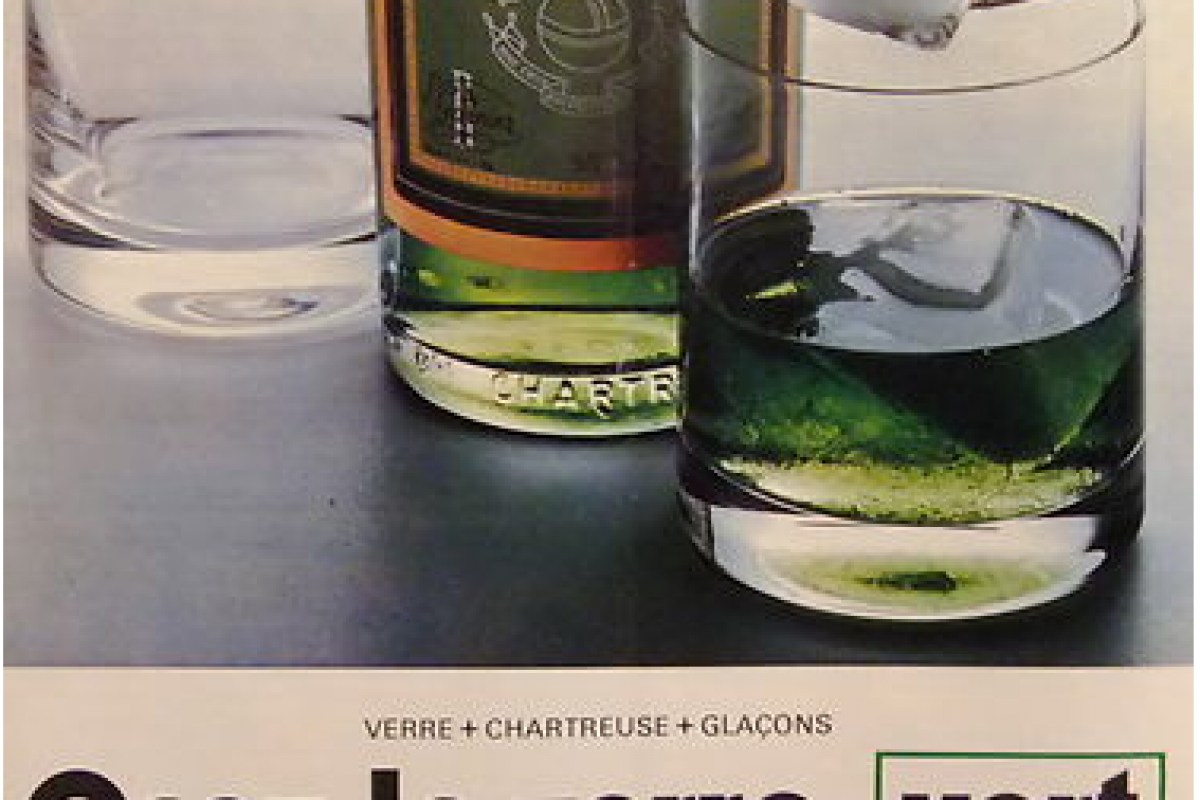



RT @Contrepoints: Le chauffage du #couvent et la séparation de l’#Eglise et de l’Etat http://t.co/RdS3ZKtj cc @ademe #laicite
L’Etat est manifestement anti catholique là où il se prétendait areligieux.
Ironie, c’est en voulant éradiquer une religion, plutôt portée par les femmes qu’il en fait entrer une autre plutôt portée par des hommes.
Ce que je sais, en tant que catholique, c’est que la loi de 1905 est avant tout une redoutable arme utilisée par tout ceux qui veulent bouffer du curé ou leur ouailles ! Ma petite fille de 7 ans se fait régulièrement gronder à l’école parce qu’elle parle de Jésus. Et bien entendu, les gramscistes me sortent toujours l’argument massue de la laïcité.
La loi de 1905 instaure la prise de contrôle de l’État par la cléricature du socialisme – religion séculière qui ne reconnaît pas la séparation entre Dieu et César.
La morale socialiste (athée et relativiste) est “enseignée” aux enfants, imposée à la presse et à la société civile par des associations socialistes subventionnées par l’argent prélevé par l’État socialiste et réprimant la déviance par la justice socialiste.
La laïcité est un terme chrétien perverti par le socialisme pour faire le contraire de ce qu’il signifie (retournement de sens dont la dialectique socialisme est coutumière comme le signalait J-F Revel).
La laïcité, c’est confier l’absolu à l’autorité chrétienne, et le séculier à l’autorité régalienne. Je ne vois pas comment le décrire en remplaçant le mot “chrétienne” par “religieuse”, puisque cette définition supposerait que ladite autorité reconnaisse cette limite … donc qu’elle soit chrétienne !
La laïcité telle que le socialisme la pratique, c’est: L’absolu (la morale) appartient au socialisme, l’État aussi, et la société civile aussi.
La pente naturelle du socialisme est le totalitarisme (lire Hayek, The road to serfdom), tout comme celle de l’islam est la théocratie, et celle du christianisme est la démocratie libérale.