Des légions de bureaucrates bornés étouffent l’économie indienne. Tant que ceux-ci continueront à mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs, il y a peu de chance que l’Inde puisse défier l’Occident.
Par Shikha Dalmia, depuis Londres, Royaume Uni.
L’obscurité s’étend sur Londres : on redoute la fin des jours de gloire de l’Europe. Les excès des banques privées et les dettes du secteur public sont sur le point de faire sombrer le vieux continent (et l’Amérique) pour plusieurs générations. Les seules étoiles montantes dans le firmament international semblent être la Chine et l’Inde. Leurs jeunes économies sont au point mort cette année, mais on prévoit qu’elles sauront apprendre des erreurs occidentales, redresser la barre et reprendre le flambeau de l’hégémonie mondiale.
 Laissons de côté la Chine et son autocratie opaque. En ce qui concerne l’Inde, je crois pouvoir affirmer qu’elle ne plantera pas son drapeau tricolore sur la planète avant un long moment, en tout cas pas avant qu’elle se débarrasse de sa bureaucratie débilitante. La plus grande démocratie du monde n’est pas un État de droit, c’est l’État des « babus », le terme local pour désigner les bureaucrates obtus. Et tant que ceux-ci continueront à mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs, il y a peu de chance que l’Inde puisse défier l’Occident.
Laissons de côté la Chine et son autocratie opaque. En ce qui concerne l’Inde, je crois pouvoir affirmer qu’elle ne plantera pas son drapeau tricolore sur la planète avant un long moment, en tout cas pas avant qu’elle se débarrasse de sa bureaucratie débilitante. La plus grande démocratie du monde n’est pas un État de droit, c’est l’État des « babus », le terme local pour désigner les bureaucrates obtus. Et tant que ceux-ci continueront à mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs, il y a peu de chance que l’Inde puisse défier l’Occident.
Malgré leurs nombreux problèmes, les puissances occidentales (l’Amérique, le Canada, l’Angleterre, l’Allemagne et les autres) ont des institutions qui fonctionnent comme des droits de propriété bien définis, des tribunaux efficaces pour faire respecter les contrats et des infrastructures modernes pour optimiser la productivité des citoyens. Par opposition, l’horrible bureaucratie indienne écrase systématiquement les citoyens, détruisant leurs initiatives souvent sans aucune raison apparente autre que le plaisir sadique du pouvoir.
En voici un exemple que j’ai récemment vécu : j’étais à New Delhi avec mon mari et mon fils, et nous voulions faire un court voyage en Malaisie avec nos cousins. Suite aux attaques de Mumbai de 2008, les ressortissants étrangers (c’est le cas de ma famille) qui souhaitent quitter puis regagner le territoire dans un délai de 90 jours doivent obtenir une autorisation spéciale.
Nous nous sommes donc retrouvés un jour à 8h du matin, armés de nos tickets pour la Malaisie, réservations d’hôtel et autres documents listés dans le site gouvernemental, à l’Office Régionale des Étrangers. À la sortie de la file d’attente, un des cinq babus moustachus nous a informés que nous étions au mauvais endroit. D’abord, nous devions avoir la permission du ministère de l’intérieur. Ensuite, ils pourraient l’entrer sur nos passeports.
Nous avons donc traversé la ville en direction du ministère où, après fouille et interrogatoire, nous avons été dirigés vers un espace de 5 mètres sur 10 où s’entassait une centaine d’autres suppliants. Une odeur d’urine se dégageait d’un lavabo déglingué. À une extrémité se trouvait une secrétaire, à l’autre trois nouveaux babus. Le feu vert de la secrétaire étant nécessaire pour accéder aux babus, nous avons pris un numéro pour la voir : 85. À ce moment précis, elle traitait le numéro 12. Deux heures plus tard, elle nous riait au nez : « Dossier incomplet. Apportez des photocopies de vos visas, passeports et billets de retour vers les États-Unis avant de voir les babus ou vous devrez revenir un autre jour. »
Nous avons donc couru dans tous les sens, et tout était prêt (de justesse) avant notre convocation. Hélas, un autre problème se posa : la Malaisie n’a pas de frontière commune avec l’Inde et ne fait par conséquent pas partie des pays à partir desquels le retour est permis. Nous allions devoir annuler notre voyage, d’après le babus, à moins de parvenir à convaincre son supérieur, appelons-le M. Singh, de nous accorder une permission spéciale.
 Nous nous sommes anxieusement dirigés vers le bureau de M. Singh, l’interceptant par chance juste avant qu’il ne quitte le bâtiment avec sa femme pour manger. Il nous griffonna rapidement un papier d’autorisation, que nous avons joyeusement présenté à notre babus, qui sembla satisfait. Il garda tous nos documents et nous dit de retourner avant 16h au premier bâtiment que nous avions visité.
Nous nous sommes anxieusement dirigés vers le bureau de M. Singh, l’interceptant par chance juste avant qu’il ne quitte le bâtiment avec sa femme pour manger. Il nous griffonna rapidement un papier d’autorisation, que nous avons joyeusement présenté à notre babus, qui sembla satisfait. Il garda tous nos documents et nous dit de retourner avant 16h au premier bâtiment que nous avions visité.
Étourdis de soulagement, nous avons fait le trajet inverse en espérant une conclusion rapide. Nouvelle erreur. Nous devions présenter à nouveau toute la paperasserie que le babus du ministère nous avait confisquée ou l’office refusait de tamponner le passeport. Après une nouvelle frénésie bureaucratique, notre dossier était à nouveau complet 15 minutes avant la fermeture à 18h. Complet, à l’exception de la facture d’électricité de notre adresse permanente à New Delhi, dont ils avaient oublié de nous dire qu’elle était nécessaire.
J’étais au bord de l’hystérie. Mais j’ai eu assez de présence d’esprit pour jouer ma dernière carte : j’ai menacé de faire un rapport à M. Singh, dont j’ai prétendu qu’il était un ami de la famille. Le bluff a marché, et après quelques renâclements pour sauver la face, ils ont apposé leur tampon de mauvaise grâce.
En d’autres termes, une affaire de routine qui n’aurait pas dû prendre plus de 10 minutes a dévoré 30 heures de nos vies. Et pourtant, selon les normes indiennes, c’est un dénouement heureux. Des histoires encore plus kafkaïesques se déroulent en permanence partout sur le territoire. Nous avions suffisamment de temps, de ressources et de jugeote à accorder à cette affaire qui n’était d’ailleurs pas pour nous d’une importance vitale. Mais qu’en est-il par exemple, du pauvre conducteur de pousse-pousse qui a besoin d’un permis pour gagner son maigre revenu ? Ou du fermier qui a besoin d’un titre de propriété pour ses terres (démarche qui peut prendre 240 à 400 jours dans certaines parties du pays) ?
Les bureaucraties occidentales ne sont pas assez efficaces, mais elles arrivent quand même à mener à bien leurs tâches. La bureaucratie indienne est pire de plusieurs ordres de grandeurs et n’arrive à rien (sauf si on compte le harcèlement parmi ses objectifs), ce qui explique pourquoi elle est considérée comme la pire en Asie. Tous les classements mondiaux, sans exception, classent l’Inde dans les pays les plus hostiles au business. La banque mondiale place virtuellement l’Inde en dernière position parmi 183 pays pour la possibilité de faire respecter les contrats.
Tout cela grâce aux immenses pouvoirs discrétionnaires que les règlements indiens offrent aux bureaucrates. Tant que ça ne changera pas, la peur que l’Occident perde sa place au soleil est prématurée, c’est le moins que l’on puisse dire.
—-
Article original titré Why India Can’t Catch Up With the West, publié le 17.07.2012 sur reason.com.
Reproduit avec l’aimable autorisation du site. Traduction : Lancelot/Contrepoints.

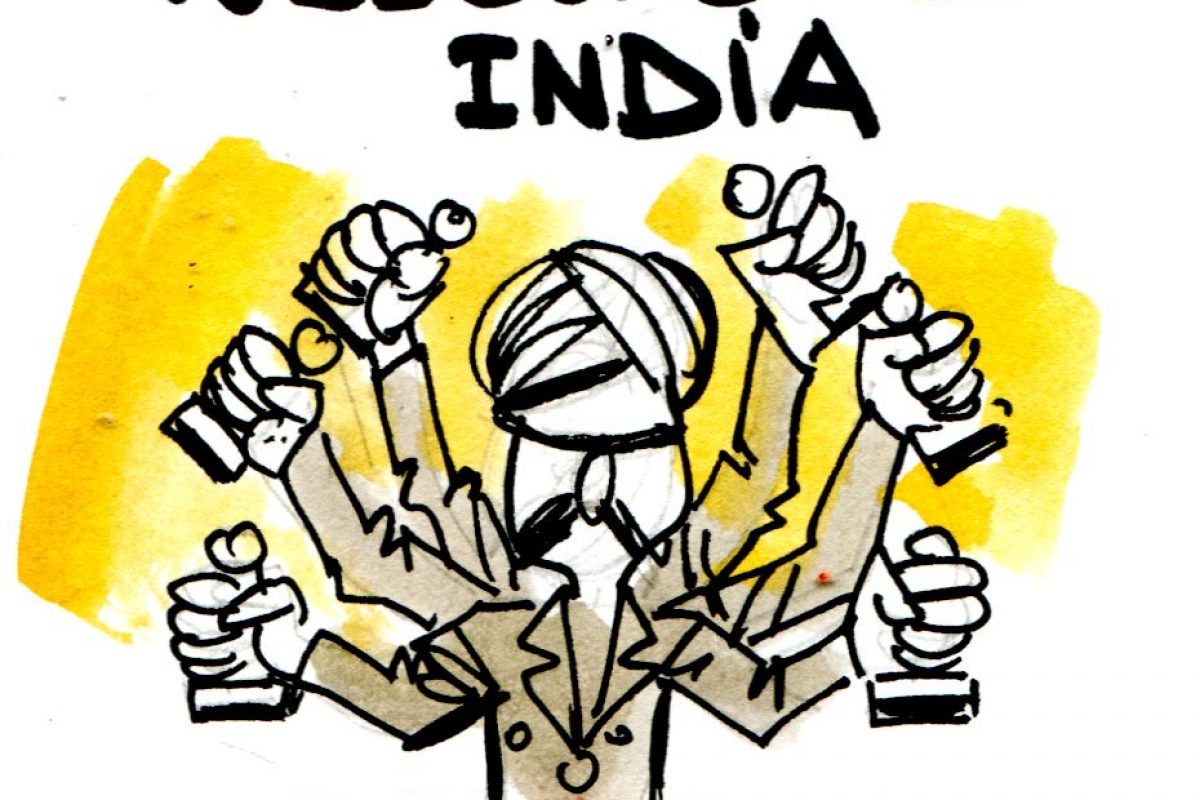
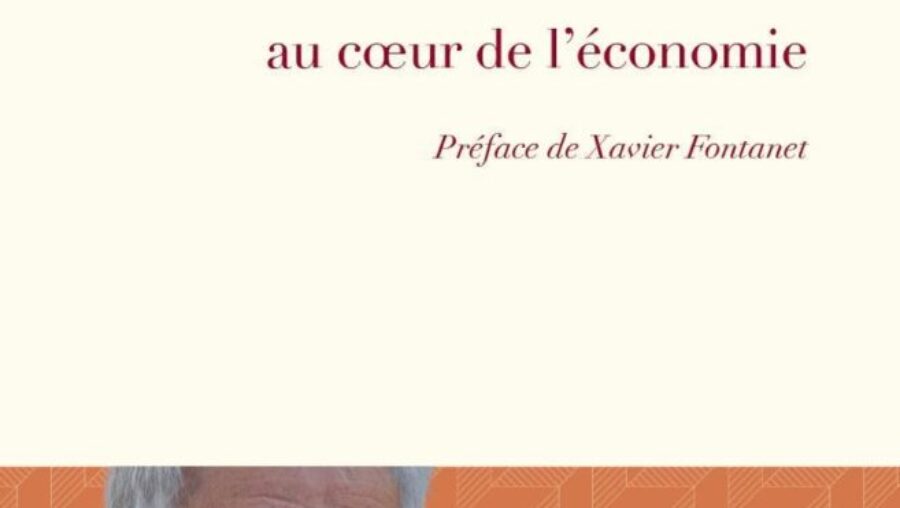

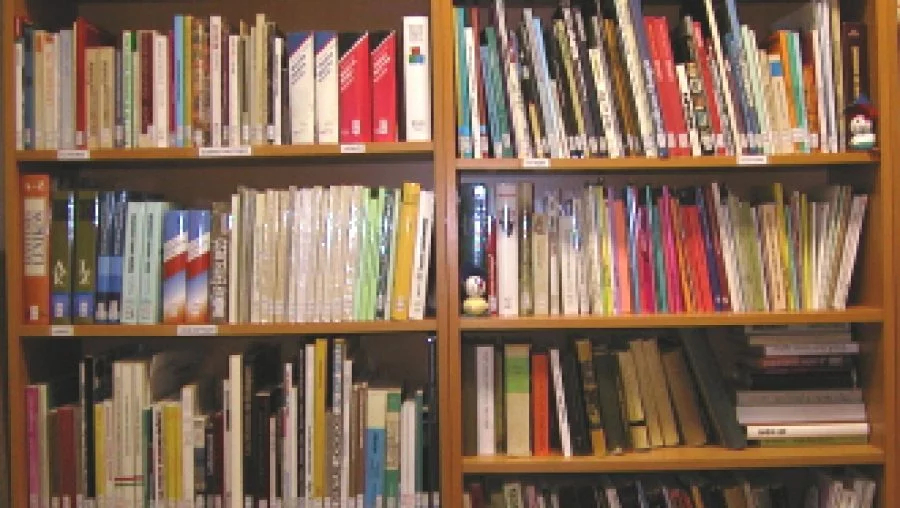
C’est tout ?
Complètement à l’ouest cet article…
Je passe sur la Chine et “l’autocratie opaque” (qui a réussi plusieurs transitions économiques et bientôt sociales dans une pleine continuité politique, et dont les débats se passent en interne dans un seul parti, comme ça peut se faire au Japon au final…), dont l’auteur ne veut pas parler.
Mais résumer l’économie indienne, ses perspectives, sa place géopolitique et s’en moquer en prenant un exemple aussi futile, ça fait pitié.
Le fait est que l’Inde, par sa bureaucratie écrasante, ne facilite pas l’arrivée d’entreprises étrangères et maintient un contrôle ferme sur celles qui sont présentes, par peur de la subversion occidentale (peur justifiée à bien des égards).
Certes, la propriété n’est pas toujours respectée, notamment la propriété intellectuelle, mais c’est le cas dans toute l’Asie, qui n’a pas du tout la même vision que l’Occident.
Sauf que l’Inde ne se résume pas à ça… : alphabétisation en hausse, croissance potentielle à 9%, secteur financier qui a résisté à la crise, structure politique en castes qui le rend le pays redoutable dans la mondialisation et capable d’en soutenir les inégalités, une production agricole parmi les premières mondiales (premier producteur de lait, de boeuf, de thé, deuxième producteur de blé, canne à sucre et riz, troisième producteur de pommes de terre et de coton), la possession de l’arme atomique, sa démographie, son fonctionnement malgré tout démocratique, de bonnes relations stratégiques avec la Russie, l’Iran (pétrole) et Israël, un adoucissement des relations avec les Etats-Unis, un secteur informatique (Bangalore) et pharmaceutique en plein boom…
Dans cette compétition mondiale, il serait bien un jour que l’Occident admette d’autres façons de fonctionner. L’Inde est opaque, mais elle a de solides atouts, et contrairement à l’Union européenne, elle connaît l’adversité (conflits avec ses voisins), son identité et son histoire…
Si le Bien est l’état d’harmonie de droits égaux pour tous et exprimés ou réalisés librement par chacun, et le Mal sa négation – à savoir la domination et l’inéquité mises en oeuvre, de l’un sur l’autre.. alors la bureaucratie est la forme la plus aboutie du Mal: organisée, systématisée et même institutionnalisée.
Ludwig von Mises avait fait le tour des raisons qui dévoient systématiquement les agents des administrations vers plus de bureaucratie, plus d’inéquité, plus d’arbitraire et surtout: toujours plus de pouvoirs, dans son court opus de 1944, “Bureaucratie”.
Dans un système de prise de décision hors-marché (une administration), le calcul économique n’existe pas, il n’y a aucun retour de la société civile vers les agents en terme de valeur de leur action (positive comme négative !), et par conséquent ces derniers se retrouvent “dans le vide”, avec pour seule échelle de valeur la mission de leur département et les règles édictées du haut vers le bas. La seule voie de succès consiste alors à ne pas dépasser de ce cadre: la veulerie et le zèle imbécile, seuls comportements qui s’inscrivent dans ce système sans en sortir, se généralisent. Un bon bureaucrate est un bureaucrate qui ne dérange pas ses supérieurs, un meilleur bureaucrate est un bureaucrate qui applique encore mieux le réglement qu’un autre. L’avancement se fait à l’ancienneté, stérilisant toute initiative qui pourrait mettre en péril le statu quo, brimant les jeunes espoirs et confortant les plus âgés dans le maintien en l’état du système. Le statut particulier pousse les agents à développer une religion de leur mission: appliquer toujours plus leurs règles au reste de la population, s’affranchir toujours plus des contrôles que la société civile pourrait leur imposer, parce que les moyens qu’ils emploient sont progressivement devenus leurs propres fins.
J’aimerais pour finir illustrer à quel point les principes fondateurs de la bureaucratie sont opposés à l’esprit humain, comment ils en détruisent la substance: pour chaque petite décision que nous prenons, la DISSONANCE est le mode de fonctionnement naturel. Nos neurones s’engueulent et se font la guerre en permanence, le consensus est un artifice, l’exception à la nature humaine et certainement pas sa règle.
Dans une bureaucratie, au contraire, tout est fait pour évacuer toute forme de dissonance, associée à “l’autre” ou “l’extérieur” qu’il convient de réguler à mort. Chaque niveau de hiérarchie doit réprimer ses opinions et inspirations pour ne pas choquer le niveau supérieur, dans un conformisme total. Cela constitue une double agression: d’une part une agression contre soi-même, une destruction sournoise de sa propre opinion et de sa propre identité ; mais c’est aussi un manque patent de respect pour l’autre, que de le croire trop faible pour faire face à la moindre dissension, en plus d’être un bien mauvais service à lui rendre que de le laisser confire dans ce que l’on est convaincu d’être une erreur. C’est ainsi que la bureaucratie, via le conformisme, l’autoritarisme et le politiquement correct, tue l’esprit humain, littéralement, au niveau cellulaire.
On voit tonton jean que vous n’etes pas Indien… Impossible de faire du business avec une bureaucratie comme celle la…
Ce qui est marrant (enfin façon de parler), c’est que des histoires comme celles-là j’en ai vécues plusieurs… en France (et aussi en Géorgie) !!! Tout ça parce que ma femme a le bon goût de ne pas être française… Parlons par exemple des préfectures françaises, l’odeur d’urine est sûrement la même qu’en Inde (et qu’à l’aéroport CDG que le monde nous envie… ou pas). Et la joie de se lever à 3h du matin pour entrer dans la queue à 4h et avoir un des précieux tickets à l’ouverture à 9h après avoir attendu debout des heures dans le froid, qui vous permettra de passer au guichet à 11h… Bref, je ne sais pas pour l’Inde, mais la France est archifoutue, et je ne sais pas pour vous, mais moi ça me saute aux yeux tous les jours.
Dans ce cas, un conseil, Partez vite !
Si les immigrés indiens avaient le même talent littéraire que l’auteur de cet article ils pourraient vous raconter en vingt feuillets ce qu’ils endurent dans notre beau pays et dans ses consulats. Vous n’en reviendriez pas (dans tous les sens du terme).