On nous demande de manifester notre solidarité en cautionnant les nombreux droits. Toutefois, n’est-il pas temps de réhabiliter le principe de la responsabilité individuelle?
Par Nathalie Elgrably-Lévy
 Droit au logement, au travail, à l’éducation, etc. Un recours collectif vient même d’être autorisé contre Air Canada pour avoir facturé deux sièges à leurs passagers obèses. Verrons-nous bientôt l’apparition d’un droit au confort? Le concept de « droit » est décidément très tendance. Toutes les dimensions du discours de la gauche sont d’ailleurs centrées autour de ce concept qui, disons-le franchement, vise souvent à justifier le fait que l’État permette à certains de vivre aux crochets des contribuables.
Droit au logement, au travail, à l’éducation, etc. Un recours collectif vient même d’être autorisé contre Air Canada pour avoir facturé deux sièges à leurs passagers obèses. Verrons-nous bientôt l’apparition d’un droit au confort? Le concept de « droit » est décidément très tendance. Toutes les dimensions du discours de la gauche sont d’ailleurs centrées autour de ce concept qui, disons-le franchement, vise souvent à justifier le fait que l’État permette à certains de vivre aux crochets des contribuables.
Il faut toutefois faire une distinction entre la liberté – qui implique que chacun peut poursuivre ses objectifs personnels sans que l’État fasse obstruction – et le « droit à » quelque chose. Ce dernier suppose que l’État (et donc les contribuables) est responsable du bien-être de ses citoyens.
Aujourd’hui, la liberté n’a pas la cote. On préfère travestir les besoins et les aspirations personnelles en droits et faire systématiquement appel à la notion de responsabilité collective ou sociale. En revanche, une autre notion est rarement invoquée: celle de la responsabilité individuelle.
Évidemment, certaines personnes souffrent d’un handicap physique ou intellectuel les empêchant de se prendre en charge. Dans ce cas, il est indiscutable que nous avons le devoir moral de veiller à leur bien-être. Pour les autres, le fait qu’ils possèdent ou qu’ils exigent des droits ne devrait pas les dispenser d’agir de manière responsable. Au contraire, chaque droit engendre une responsabilité.
Par exemple, le « droit à l’éducation » devrait être accompagné de la responsabilité des étudiants de prendre leurs études au sérieux, de se présenter en classe, de se préparer aux évaluations, d’éliminer tout ce qui nuit à leur apprentissage et de persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme.
Le « droit au travail » ne signifie pas que des employeurs viendront frapper à notre porte. Nous avons la responsabilité de ne pas paresser, de chercher activement un emploi et d’être aussi productifs que possible.
Le « droit à l’eau » ne nous autorise pas à gaspiller cette précieuse ressource, et le « droit à un revenu minimum » ne constitue pas un passeport pour l’oisiveté.
Il y a aussi les droits à la santé et à la sécurité. Mais qu’en est-il de la responsabilité de chacun de prendre soin de sa personne, d’éviter les comportements autodestructeurs, de fuir les situations compromettantes?
Les libertés aussi doivent être exercées de manière responsables. Par exemple, la liberté d’expression n’est pas une invitation à exprimer sans retenue tout ce qui nous traverse l’esprit. Nous avons la responsabilité de réfléchir préalablement à nos propos et d’en évaluer leur portée.
On nous demande de manifester notre solidarité en cautionnant les nombreux droits. Toutefois, n’est-il pas temps de réhabiliter le principe de la responsabilité individuelle? Après tout, on ne peut pas faire des demandes à autrui sans jamais rien donner en échange. Et puis, il n’y a que celui qui est responsable de lui-même, qui se prend en charge sans dépendre d’autrui, qui est réellement solidaire des autres!
—-
Sur le web



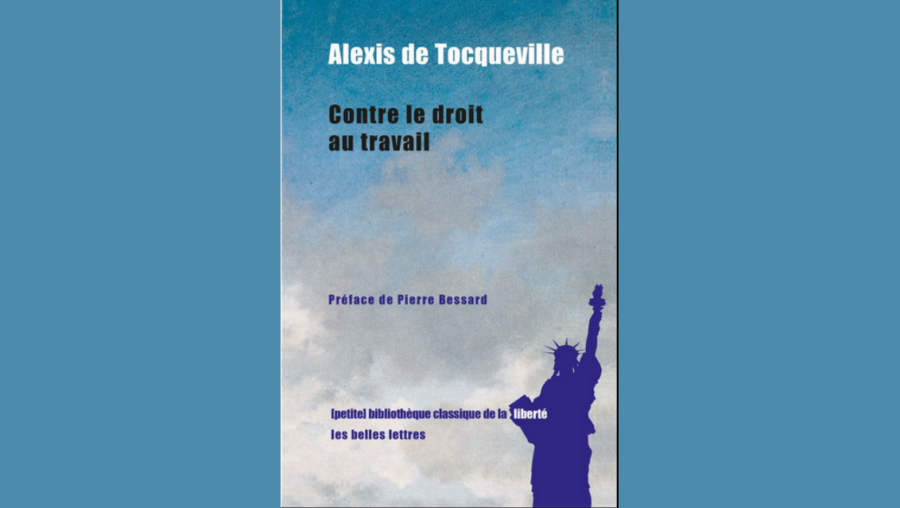
La responsabilité individuelle est oubliée. La personne qui propose devrait assumer le coût de sa proposition. C’est facile de proposer en dépensant l’argent des autres.
Pensée faible, facile. On croit qu’un si vaste thème sera traité de manière profonde. On se heurte aux faits; jetés en pleine face sans aucune subtilité. On se heurte surtout au fait: une dissertation de café du commerce qui ressasse à tour de bras banalités et préjugés populaires.
D’un point de vue libéral, le droit de travailler est bafoué par toutes les lois qui interdisent de travailler: les licences nécessaires pour exercer certains métiers sont un monopole moyenâgeux. Les lois de salaire minimum ne sont rien d’autre que l’exclusion des plus pauvres (et souvent jeunes, étrangers) hors du monde du travail salarié légal.
Quant au droit de loger, c’est sans doute le droit le plus impitoyablement piétinés par nos lois. Le nombre effroyables de lois faites pour empêcher de construire et d’habiter, spolie locataires et acquéreurs de plusieurs dizaines de milliards par année. Et pour les plus pauvres, c’est l’exclusion pur et simple.
Évidemment, certaines personnes souffrent d’un handicap physique ou intellectuel les empêchant de se prendre en charge. Dans ce cas, il est indiscutable que nous avons le devoir moral de veiller à leur bien-être.
Ah oui et comment ?
Je vous donne une piste. peut être en empêchant que des obèses payent deux places dans un avion par exemple; il y a des cas ou l’obésité relève d’une maladie génétique et donc d’un handicap. Peut-être que les obèses dont vous parlez ont réfléchi individuellement à leur situation et décidé collectivement d’une action pour pallier sans doute à l’absence du devoir moral dont vous parlez