À quelques jours de la Journée mondiale de l’alimentation, l’Institut économique Molinari publie une étude remettant en cause la pertinence du concept d’autosuffisance alimentaire et sa mise en avant pour des motifs environnementaux. Cette étude montre que ce concept est un mode de production ne favorisant pas le développement durable et risquant, au contraire, d’exacerber les problèmes qu’il est supposé résoudre.
 Selon ses auteurs, Pierre Desrochers et Hiroko Shumizu, dans les faits, la souveraineté alimentaire ne fait qu’exacerber les problèmes que ses supporters disent vouloir combattre. Le débat doit évoluer vers une meilleure prise en considération des différents coûts et incertitudes associés aux mesures destinées à favoriser l’autosuffisance alimentaire.
Selon ses auteurs, Pierre Desrochers et Hiroko Shumizu, dans les faits, la souveraineté alimentaire ne fait qu’exacerber les problèmes que ses supporters disent vouloir combattre. Le débat doit évoluer vers une meilleure prise en considération des différents coûts et incertitudes associés aux mesures destinées à favoriser l’autosuffisance alimentaire.
Parce qu’elle est moins productive, l’agriculture de proximité requiert davantage de surfaces cultivées. Son essor pourrait donc aller à l’encontre de la protection des forêts et espace naturels, thèmes chers aux environnementalistes.
Produire dans les zones les plus proches, au lieu de produire dans les zones les plus appropriées, ne réduit pas forcément les gaz à effet de serre. Aux États-Unis seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre associées à la production de nourriture proviennent du transport sur de longues distances. La production proprement dite des aliments représenterait 83 % des émissions. Insister sur l’intérêt d’une agriculture de proximité, au motif d’un prétendu gain environnemental lié aux économies de transport, n’est pas pertinent.
Par ailleurs, la consommation de denrées produites localement, y compris si les conditions économiques sont moins favorables, a nécessairement un impact sur les dépenses des ménages. Ils payeront le même prix pour un produit de moindre qualité ou plus cher pour un produit similaire. Ils auront in fine moins de pouvoir d’achat à consacrer aux autres consommations, ce qui aura des effets négatifs sur la création d’emplois non-agricoles, ce qu’omettent de prendre en compte nombre d’études sur le sujet.
Paradoxalement, la souveraineté alimentaire entraîne des risques beaucoup plus élevés en concentrant les risques. Peu importe leur nature, toutes les productions agricoles sont périodiquement victimes d’aléas climatiques et autres calamités, d’où l’intérêt du commerce agricole inter-régional.
Historiquement, les échanges inter-régionaux ont permis de répartir les risques inhérents aux productions agricoles en acheminant les surplus de certaines régions vers d’autres où les récoltes ont été mauvaises, prévenant par le fait même une hausse autrement plus rapide des prix dans les régions en difficulté.
L’agriculture de proximité, loin d’être un gage de développement durable, est donc bien un mode de production couteux. Vouloir l’imposer, au nom d’une vision environnementale, serait contre-productif.
Intitulée « L’autosuffisance alimentaire n’est pas gage de développement durable », l’étude de l’Institut économique Molinari est disponible en format de Note économique (4 pages) et de Cahier de recherche (17 pages) sur le site de l’Institut.


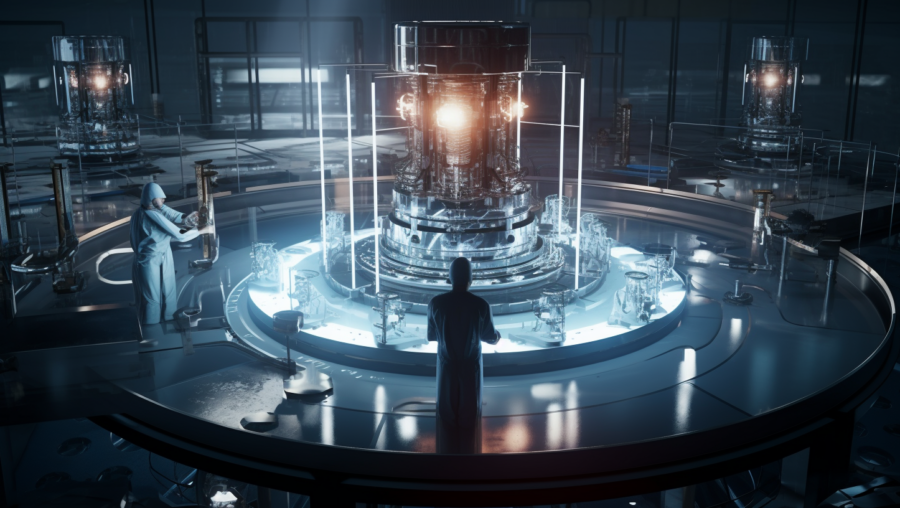

Bien souvent, les produits locaux sont certes plus chers, mais de bien meilleure qualité! Il n’y a qu’à voir l’aspect et le goût des pêches ou des brugnons venant d’Espagne, contre ceux produits dans la région du Roussillon en France par exemple.