Depuis sa création en 1979, la République islamique d’Iran est devenue la troisième plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Il peut donc sembler que la stratégie idéale pour lutter contre cette menace soit une stratégie de confrontation et d’agression. Cependant, cette approche s’est révélée largement inefficace. La vérité, c’est qu’une politique belliciste qui met l’accent sur l’interventionnisme ne fait qu’aggraver les tensions avec les puissances étrangères adverses. En outre, de telles actions ternissent l’image internationale de l’Amérique. Bien que l’Iran doive être traitée avec prudence, une action militaire – qu’il s’agisse d’une déclaration de guerre du Congrès ou d’un décret de l’exécutif – serait futile et contre-productive.
Article original de Jacob R. Swartz publié dans le Mises Institute.
Premièrement, les interventions militaires ont tendance à susciter le ressentiment des populations locales. Deuxièmement, les guerres de changement de régime créent souvent des vides de pouvoir et réduisent les conditions de vie. Par exemple, l’intervention américaine en Libye sous Barack Obama a entraîné l’effondrement des institutions, ouvrant la voie à l’anarchie, au règne des gangs et aux marchés noirs, comme la « bourse aux esclaves » actuelle de la Libye.
Si l’Iran représente indubitablement une menace pour la stabilité internationale, il serait plus efficace de répondre à cette menace en adoptant une doctrine d’entente – une stratégie axée sur le commerce, la neutralité et la réduction des déséquilibres de pouvoir – plutôt que de recourir à la guerre. Le rétablissement de l’accord nucléaire est essentiel dans ce contexte, car il permettrait d’atténuer les hostilités, de promouvoir la stabilité et d’encourager la coopération plutôt que le conflit.
À partir de la fin du XIXe siècle et pendant la majeure partie du XXe siècle, l’Iran a été l’un des alliés les plus fidèles des États-Unis au Moyen-Orient. Toutefois, cette relation a connu un tournant en 1953, lorsque le Premier ministre démocratiquement élu, Mohammad Mosaddegh, a été renversé par un coup d’État orchestré par la Central Intelligence Agency et le MI6.
Winston Churchill et Dwight D. Eisenhower craignaient que sa position modérée ne facilite l’accès au pouvoir politique du parti Tudeh, pro-soviétique. En outre, Mosaddegh a lancé la nationalisation du pétrole persan, qui comprenait des réserves appartenant à l’Anglo-Iranian Oil Company, la plus grande société privée de l’Empire britannique. En réponse à ces actions, les États-Unis et le Royaume-Uni ont orchestré la destitution de Mosaddegh et installé le shah Mohammed Reza Pahlavi à sa place.
En 1979, des révolutionnaires anti-occidentaux déposent le shah et instaurent la République islamique, prenant au passage un certain nombre d’otages américains. Cela a marqué le début d’une relation tumultueuse et souvent hostile entre les États-Unis et l’Iran.
Depuis 1979, les États-Unis ont imposé une série de sanctions à l’Iran, à commencer par l’ordre exécutif 12170 – qui a gelé des avoirs persans estimés à 1,02 milliard de dollars – suivi d’un embargo sur les importations persanes un an plus tard et, enfin, d’une interdiction totale de tout commerce.
Un changement important s’est produit en 2015 avec la signature du Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a vu les États-Unis commencer à lever certaines de ces sanctions.
Toutefois, ce répit a été de courte durée. Dès son entrée en fonction en 2017, le président Donald Trump a rétabli la plupart de ces sanctions. Le mandat de Trump a été marqué par un langage et une rhétorique durs à l’égard de l’Iran, qui ont ravivé certaines hostilités que le président Obama avait auparavant tempérées.
Les tensions ont atteint un nouveau sommet en janvier 2020, lorsque Trump a ordonné l’assassinat extrajudiciaire du général Qasem Soleimani, une action qui a suscité la colère du gouvernement iranien.
Malgré ces mesures rigoureuses, les sanctions américaines n’ont pas atteint leur objectif et n’ont pas réussi à freiner l’expansion iranienne. En outre, l’administration Trump a menacé d’imposer des sanctions aux pays qui commercent avec l’Iran. Étant donné que les avantages économiques du commerce avec les États-Unis l’emportent sur ceux du commerce avec l’Iran, la plupart des nations se sont pliées aux exigences de Washington, ce qui a considérablement entravé la capacité de l’Iran à exporter du pétrole.
L’opinion publique sur les Américains est plus élevée en Iran que dans la moyenne des nations islamiques. C’est le gouvernement américain, et non le peuple américain, dont les Iraniens se méfient. Cette méfiance découle de décennies de sanctions paralysantes et d’interventions américaines à proximité de la sphère d’influence de la Perse. Des sanctions renforcées ne feraient que nuire davantage à l’amélioration de l’opinion publique, réduisant ainsi toute perspective de paix dans un avenir prévisible.
Malheureusement, c’est exactement l’approche adoptée par l’administration Biden.
La menace que l’Iran fait peser sur les intérêts américains au Moyen-Orient pourrait être considérablement atténuée si les États-Unis levaient les sanctions et ouvraient le commerce. Actuellement, les États-Unis et le Royaume-Uni sont les seuls grands adversaires occidentaux de l’Iran. En revanche, l’Iran entretient de solides relations commerciales avec l’Union européenne. L’Iran est le septième exportateur européen de pétrole brut. L’Allemagne, en particulier, a cultivé des liens économiques solides avec l’Iran, ses exportations vers ce pays ayant augmenté de près de 30 % rien qu’entre 2015 et 2016. Cela souligne la volonté de l’Iran de s’engager dans le commerce avec l’Occident.
Les Émirats arabes unis sont l’un des partenaires les plus proches des États-Unis au Moyen-Orient. Toutefois, entre 2020 et 2021, ils sont devenus le principal partenaire commercial de l’Iran dans la région. Cette évolution pourrait avoir des conséquences négatives à long terme, d’autant plus que les États-Unis continuent de réduire leur présence au Moyen-Orient. Une présence diplomatique réduite, associée à des sanctions continues, pourrait permettre à l’Iran de rallier les Émirats arabes unis à sa cause.
Des situations similaires pourraient se produire dans les pays européens mentionnés précédemment.
La poursuite de l’expansion économique de l’Iran est précisément ce que les sanctions américaines visent à étouffer. Les possibilités limitées de croissance ont poussé l’Iran à rechercher d’autres partenaires commerciaux, comme la Russie et la Chine. La stratégie américaine actuelle semble donc contre-productive, car elle pousse l’Iran à s’allier à des puissances rivales.
Depuis le milieu des années 1990, la Russie est l’un des principaux investisseurs étrangers dans la capitale persane et a joué un rôle essentiel en aidant l’Iran à se doter d’armes nucléaires, ce qui conférerait un avantage stratégique aux deux pays. Les États-Unis, dans leurs efforts pour isoler davantage l’Iran, risquent de renforcer involontairement ce partenariat. Par exemple, le 8 mai 2019, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, qui vient de prendre sa retraite, a rencontré le ministre russe des affaires étrangères Sergey Lavrov à Moscou, où ils ont discuté des sanctions américaines et de la menace d’une agression occidentale.
Plus récemment, alors que les efforts pour relancer l’accord nucléaire se sont intensifiés, les contre-propositions de l’Iran ont obtenu le soutien de la Chine et de la Russie. Lorsque les négociations officielles ont repris le 29 novembre 2021, Vladimir Poutine s’est positionné comme un allié proche du nouveau président iranien Ebrahim Raisi, qui a récemment trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère en mai. Les récentes manœuvres stratégiques du Kremlin témoignent de nouveaux efforts pour s’assurer l’allégeance de l’Iran.
Au lieu d’isoler l’Iran, les sanctions renforcent involontairement le pouvoir de la Russie. Si les États-Unis levaient ces sanctions, ouvraient le commerce et rétablissaient les relations diplomatiques, l’Iran pourrait considérer les États-Unis comme moins menaçants et reconnaître que les avantages d’une amitié avec les États-Unis l’emportent sur ceux d’une alliance avec la Russie.
En outre, les tensions pourraient diminuer si les États-Unis réduisaient leur soutien à l’Arabie saoudite, le principal rival de l’Iran. Après le déclenchement de la guerre civile au Yémen en 2015, le président Obama a offert une aide substantielle à l’Arabie saoudite, notamment des renseignements et un accès aux stations de ravitaillement américaines, étendu en réponse à la promesse du prince héritier Mohammed bin Salman d’aider les forces du Conseil présidentiel de leadership alignées sur l’Arabie saoudite contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran.
Malgré une opposition bipartisane, le président Trump a poursuivi cette stratégie, en opposant notamment son veto à un projet de loi visant à mettre fin à l’aide à l’Arabie saoudite dans son intégralité.
Si l’administration Biden réévaluait cette position et limitait ce partenariat à des fins strictement commerciales, voire adoptait une position neutre, les États-Unis seraient perçus comme une menace moindre pour les intérêts iraniens.
Jusqu’à la signature du JCPOA en 2015, l’Iran était déterminé à développer des armes nucléaires. Pendant des décennies, la perspective d’une nucléarisation de l’Iran a incité les États-Unis et Israël à maintenir une position belliqueuse, suggérant qu’un Iran nucléarisé représentait une menace existentielle pour la stabilité mondiale. Néanmoins, une perspective différente suggère que si l’Iran était autorisé sous condition à maintenir un arsenal nucléaire limité dans le cadre d’un accord fraîchement négocié, cela rendrait la région plus stable. Il s’agirait à la fois d’un compromis et d’une mesure pour la sécurité nationale de l’Iran.
Contrairement à ce que nous dit la propagande occidentale, le facteur déterminant contre la prolifération nucléaire dans les pays en développement est de décourager les invasions, et non d’inciter à la guerre. Même si elle n’est pas idéale, la triste réalité est que la dénucléarisation rend souvent un pays vulnérable aux invasions. Si Mouammar Kadhafi n’avait pas renoncé à l’arsenal libyen huit ans plus tôt, l’OTAN aurait probablement adopté une approche diplomatique pour résoudre la crise de 2011.
De même, si l’Ukraine n’avait pas renoncé à sa cache dans les années 1990, il n’y aurait probablement pas eu d’invasion russe. Pour le meilleur ou pour le pire, les armes nucléaires sont avant tout des moyens de dissuasion.
Bien que n’étant pas une puissance nucléaire officiellement déclarée, Israël est le seul pays du Moyen-Orient à posséder un arsenal nucléaire, ce qui en fait la menace la plus redoutable pour l’Iran. Lorsqu’une nation A détient le pouvoir d’anéantir une nation B sans capacité réciproque, le monde devient moins stable. La conclusion logique serait donc qu’un Iran nucléarisé atténuerait les disparités de puissance au Moyen-Orient, créant ainsi une dissuasion mutuelle.
Toutefois, si le fait d’autoriser l’Iran à posséder des armes nucléaires peut créer un équilibre des forces dans la région, cela ne garantit pas qu’elles ne seront pas utilisées. Si un dirigeant iranien imprudent lançait une frappe nucléaire sur Tel-Aviv, Israël répondrait certainement avec une force équivalente. En outre, rien ne garantit que l’Iran acceptera un jour les ouvertures diplomatiques des États-Unis. Le département d’État américain considère l’Iran comme le principal État soutenant le terrorisme dans le monde. Si l’Iran devenait une puissance nucléaire, la possibilité que des armes nucléaires se retrouvent entre les mains de terroristes pourrait augmenter.
Bien que l’Iran représente un défi géopolitique au Moyen-Orient, une agression ne peut qu’exacerber l’instabilité régionale, ce qui ne serait pas bénéfique pour le monde. D’un point de vue stratégique, les États-Unis auraient davantage intérêt à adopter une doctrine d’entente. L’intervention n’est pas une méthode appropriée pour répondre à la menace posée par l’Iran, mais serait en fait la preuve de l’échec des États-Unis à cet égard.


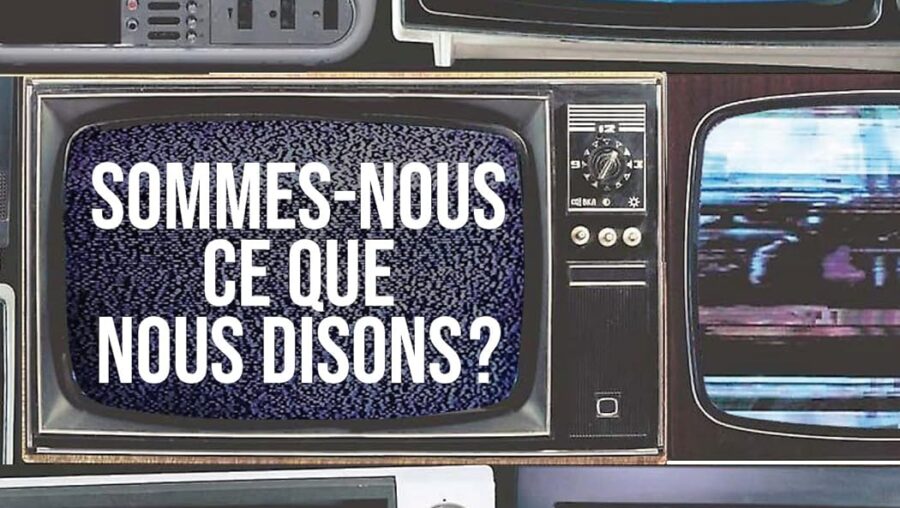


Cet article veut nous démontrer qu en faisant sauter toutes les sanctions vis à vis de l iran…..Le commerce reprendra pour le bonheur de tous……
L esprit bisounours fait toujours des dégâts même chez les libéraux……
L accord sur le nucléaire signé par Obama occultait complètement le rôle déstabilisateur des proxys iraniens qui permettent d entretenir des conflits larvés internes et externes dans plusieurs pays du moyen Orient ( Liban syrie, Irak, hamas, Yémen…..) tout autour d israel
Les iraniens rêvent de l american way of live….
Voilà un article qui déforme la réalité avec une facilité ahurissante !
Les États Unis dirigés par Hussein Obama ont eu avec l’Iran des relations apaisées en raison de la volonté unilatérale de ce président pro-islamiste. La conséquence a été de permettre à l’iran de développer sa marche vers l’arme atomique et d’essaimer partout au Moyen Orient … et ailleurs … des groupes terroristes formés et entraînés.
Trump a essayé d’inverser cette tendance en revenant sur l’accord désastreux signé par Hussein Obama et en imposant des sanctions à l’Iran. Malheureusement, il n’a pas été suivi par les lâches dirigeants occidentaux.
Mr le rédacteur, déformer la réalité c’est au cas précis prendre le parti des terroristes. Vous êtes un chiite iranien ?
Quelle agréable surprise de lire un texte intelligent et argumenté, ce qui nous change des brutales injonctions de l’hyperpuissance étasunienne ! D’une certaine manière, on retrouve là une conception réaliste et souple des relations internationales dans la meilleure tradition des politiques de Richard Nixon et de Henry Kissinger qui n’étaient pas précisément des naïfs : la reconnaissance de la Chine continentale en 1971 en fut une illustration emblématique.
Il s’agit toujours de défendre et faire progresser les seuls intérêts des États-Unis, ce qu’il serait stupide de leur reprocher : il n’y a qu’en Europe que l’on trouve des “dirigeants” bêlants qui font passer l’intérêt national après les hommages vassaliques aux États-Unis et leurs relais (OTAN et, de plus en plus souvent, UE).
Cet article montre ce que pourrait être une politique impériale intelligente des États-Unis de nature à ne pas susciter systématiquement la haine, le mépris ou au moins la défiance à l’égard de cette puissance chez des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers le monde.