Par Gérard-Michel Thermeau.
Pour William Doyle, la Révolution française n’a pas commencé le 14 juillet 1789 car à cette date « l’Ancien Régime était déjà en ruine, au-delà de tout espoir de reconstruction ».
Le point de départ remonte au 20 août 1786, le jour où le contrôleur général des Finances, Calonne, avouait à Louis XVI le désastre financier. Même si l’administration royale, par son fonctionnement très particulier1 était incapable de connaître exactement la situation, Calonne évaluait le déficit au quart des revenus de l’année. Depuis 1777, la croissance des emprunts d’État nécessitait d’affecter la moitié des revenus annuels au service de la dette.
En fait, la monarchie française était en mauvaise santé financière depuis le XVIIe siècle : trop de guerres ruineuses s’étaient succédé, la guerre d’indépendance américaine étant la dernière en date. Or il était impossible de faire des économies substantielles, sinon aux dépens des forces armées, ce qui voulait dire pour la France, renoncer à être une grande puissance.
Il n’était pas davantage question d’augmenter les impôts, les Français et particulièrement les contribuables de la région parisienne étant déjà parmi les plus lourdement taxés en Europe. De surcroît, bien que privilégiés, les nobles qui, depuis la fin du règne de Louis XV, avaient vu le poids de la taxation croître sur leurs biens, ne manquaient pas une occasion de gémir sur le fardeau fiscal qui les accablait, aussi modeste fut-il.
Restait la voie de la banqueroute, le refus de payer les dettes, vieille pratique de la monarchie, mais désormais nuisible au crédit de l’État : aux yeux de l’opinion publique du temps, la dette publique était sacro-sainte.
Au « magicien » Necker qui avait financé la guerre contre l’Angleterre sans créer de nouvel impôt mais par un emprunt, aussi favorable aux investisseurs qu’il était onéreux pour l’État, avait succédé le « prodigue » Calonne, lointain ancêtre de Keynes : il déboursa sans compter pour inspirer la confiance avec l’illusion que financer de grands chantiers, comme le nouveau port de guerre de Cherbourg, relevait de la dépense utile. Il emprunta presque autant que son prédécesseur, mais avec beaucoup plus de difficulté pour convaincre les milieux de la finance.
Il ne restait donc qu’une voie de sortie pour Calonne : réformer l’État.
Dans son Résumé d’un projet pour l’amélioration des Finances il écrit :
Un Royaume dont les Provinces sont étrangères les unes aux autres… où il est impossible d’avoir ni règle constante, ni vœu commun, est nécessairement un Royaume très imparfait.
Calonne proposait donc d’instaurer, à la place du système compliqué des vingtièmes, une « subvention territoriale », c’est-à-dire une taxe foncière universelle, permanente et proportionnelle. Elle serait perçue par des assemblées provinciales élues par les propriétaires fonciers.
Sous l’influence de Dupont de Nemours, Calonne souhaitait également la disparition des douanes intérieures, le remplacement de la corvée par un impôt, et le libre commerce des blés. Mais pour assurer le succès des emprunts nécessaires pour payer les dettes à court terme arrivant à échéance, le contrôleur crut habile d’obtenir un soutien de l’opinion publique par la convocation d’une Assemblée des notables composée de « gens de poids, dignes de la confiance du public », c’est-à-dire triée sur le volet par le pouvoir. Mais la réunion de l’Assemblée à Versailles, à compter du 22 février 1787, ne devait pas se dérouler selon les vœux du trop habile ministre. Si tout le monde ou presque reconnaissait la nécessité des réformes, Calonne réussit surtout à faire l’unanimité contre lui. Plusieurs notables réclamèrent la convocation des États Généraux seuls habilités à approuver des mesures aussi importantes. Calonne était renvoyé et un de ses plus habiles adversaires, Loménie de Brienne, se voyait nommer principal ministre.
Le 21 mai, un bureau de l’Assemblée déclarait :
Nous n’avons pas pensé qu’une Assemblée de notables, sans pouvoir et sans mission, qui n’a point reçu la députation des provinces, et qui n’a rien de commun avec les États généraux, put voter un impôt.
Aussi, Brienne, oubliant les critiques qu’il avait formulées lorsqu’il était dans l’opposition, devait-il s’empresser de la dissoudre pour essayer d’imposer de force le projet de réformes. Mais le gouvernement du Roi révélait ainsi qu’il n’avait pas la confiance de ses sujets les plus éminents, méfiance justifiée au vu du désordre des finances. Ce fut une grande malchance pour ce gouvernement aux intentions réformatrices. Lamoignon inspirait en effet des mesures audacieuses : suppression de la question (ou torture judiciaire), droits civiques accordés aux protestants… Après avoir accepté la plupart des édits réformateurs, le Parlement de Paris refusa les édits fiscaux et réclama la réunion des États généraux.
Au niveau international, paralysée par la fronde parlementaire, la France assistait impuissante à l’écrasement du mouvement « patriote » des Provinces-Unies par l’armée prussienne. Faute d’argent dans les caisses, l’armée française était restée l’arme au pied.
Brienne crut habile de renoncer aux nouveaux impôts au profit du prolongement des vingtièmes, sans exception ni cas spéciaux. Le 19 novembre 1787, lors d’une séance royale, Louis XVI prétendit contraindre le parlement à enregistrer les emprunts. Le duc d’Orléans cria à l’illégalité et le Roi répondit : « Si ! C’est légal parce que je le veux. » Il détruisait ainsi tout espoir d’entente et de compromis. Le 3 mai 1788, après plusieurs mois d’agitation et de protestation dans les provinces, le Parlement de Paris déclarait que les lois fondamentales du royaume comprenaient le consentement de l’impôt par les états généraux réunis régulièrement et des garanties contre les arrestations arbitraires.
Lamoignon dépouilla alors les parlements de la plupart de leurs prérogatives au profit d’une Cour plénière dont la composition rappelait celle de l’Assemblée des notables : hauts magistrats, grands nobles, officiers de l’État, personnages éminents divers. Le rôle judiciaire des parlementaires fut réduit également au profit des cours subalternes. Aussitôt la colère populaire éclata, marquée notamment par des émeutes à Rennes et Grenoble. Toute une littérature pamphlétaire inonda le pays, dénonçant la rupture du contrat social, la nécessité de mettre en place des réformes par les États généraux. Mais cette opposition était plus bruyante que dangereuse face à un gouvernement résolu.
Ce n’est pas la rue qui fit tomber le gouvernement, mais les finances.
En effet, au jour le jour, le gouvernement vivait des « anticipations », crédits à court terme consentis par les banquiers et financiers, garanties par les revenus fiscaux des années suivantes. Mais Brienne se trouva dans l’incapacité de trouver des fonds. Les créanciers du gouvernement ne voulaient plus financer le « despotisme ». Début août, le trésor était vide. Le 16 août, Brienne dut suspendre les paiements du trésor royal. Entretemps, il avait promis la réunion des États généraux pour le 1er mai 1789 et organisé le retour de Necker, auréolé de sa réputation de génie de la finance : c’était annoncer que le pouvoir n’était plus entre les mains du roi.
C’est ainsi que durant cet été 1788 s’écroula l’Ancien Régime.
Selon William Doyle :
La vieille monarchie et ses serviteurs étaient non seulement à court d’argent mais à court d’idées.
La vieille monarchie disparaissait, victime, non de féroces révolutionnaires mais de ses contradictions internes.
- À lire : William Doyle, Des origines de la révolution française, Calmann-Lévy 1988, 312 pages.
Un article publié initialement le 14 juillet 2015.
- Il n’y avait pas d’administration centrale, les finances étaient administrées par des financiers indépendants qui avaient acheté leur charge, comme les Fermiers généraux, et divers officiers ↩




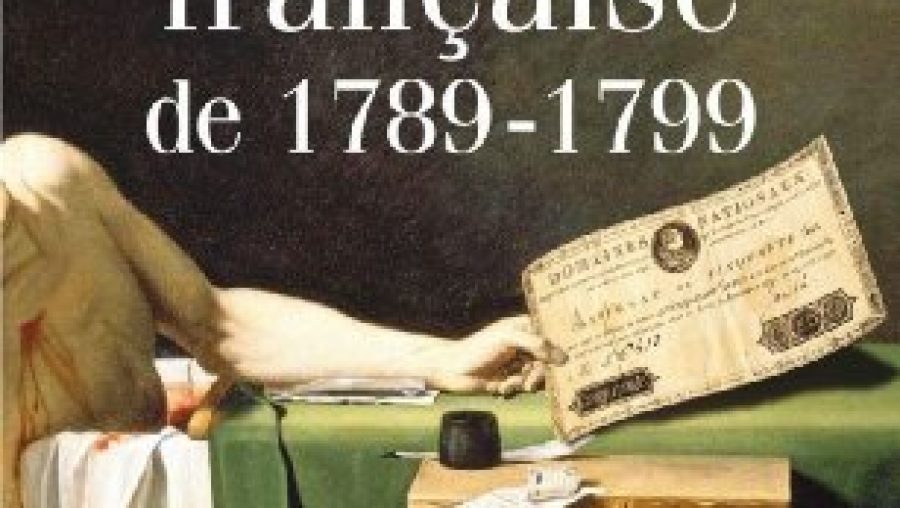
« la vieille monarchie et ses serviteurs étaient non seulement à court d’argent mais à court d’idées »
Nous fêtons le 14 juillet pour ça? Alors que nous somme de nouveau au même point…
«Ce n’est pas la rue qui fit tomber le gouvernement mais les finances.»
Le passé reflet bien le présent, bientôt les grecs et après nous. Le 14 juillet est une pure plaisanterie, c’est le mythe de la révolution.
Conclusion: On ne peut qu’espéré pour la france une chute des finances de l’état, plutot qu’une révolte de la rue.
De grandes similitudes avec la situation actuelle.
Dans la réalité nous sommes tombés dans la pagaille absolue !
Certes ce sont les finances qui sont à l’origine de la chute de la monarchie, mais je ne m’explique toujours pas comment le pays le plus peuplé et le plus riche d’Europe a pu céder face à un Royaume Uni ayant trois fois moins d’habitants et relativement pauvre de surcroît. Bien sûr, le RU a financé des guerres qu’il n’a pas mené lui-même contre la France, mais il a aussi financé une formidable marine qui s’est rendue maîtresse des océans. On ne m’ôtera pas de l’idée que les banques et leurs crédits avaient déjà choisi le vainqueur.
Les anglais savaient nouer des alliances…
Peut être que c’est parce que les rois d’Angleterre étaient d’origine hollandaise ? Ces gens là savent gérer le pognon…
😉
Allemande à l’époque de Louis XVI, c’était la maison de Hanovre!
La maison d’orange a régenté le royaume mais n’y a pas créé de dynastie.
Ne serait-ce pas une fête de la honte par certains côtés ?
Refus de toute réforme qui ajusterait l’effort demandé aux bénéfices retirés. La gauche a mené le pays exactement dans cette situation depuis un siècle. Ajoutez y ses utopies universalistes dépassées et vous avez la France de 2021 exsangue, surtaxée mais munie du mille feuilles administratif le plus grotesque d’Europe et d’une armée de fonctionnaires mal utilisés en place par clientélisme ……
Le 14 juillet, fête nationale de la ruine et de la rigidité pour laquelle on dépense encore un peu plus.. tout s’explique !!
le rôle de Louis XVI n’est pas vraiment clair sur la période.
le livre d’Aurore Chéry ouvre des hypothèses intéressantes :
https://editions.flammarion.com/lintrigant/9782081407916
Souvenir de mon cours d’Histoire sur la prise de la Bastille en 2nde. Question de la prof : « vous croyez que le peuple de Paris s’est révolté contre l’absolutisme ? Tout ce qu’ils voulaient, c’était des canons pour abattre les murs de la ville et pouvoir contourner les barrières d’octroi, la Bastille était le seul endroit dans Paris où on en trouvait ! »