Par Dominique Vian1.
« Objectif Zéro chômeur : l’incroyable histoire d’une entreprise solidaire d’initiative et d’action pas comme les autres » raconte l’histoire de l’ESIAM, un projet de réinsertion à l’emploi porté par ATD Quart Monde à Mauléon dans les Deux-Sèvres.
À l’heure où la question se pose de savoir comment satisfaire les revendications des Gilets jaunes, cette expérimentation remarquable oppose un démenti à ce que disaient les politiques à propos du chômage de longue durée, « on a tout essayé ». Si elle révèle une manière très originale de penser l’action, elle a aussi permis d’aboutir à une solution efficace pour s’attaquer au chômage de longue durée, le faisant quasiment disparaître de la commune. De quoi s’agit-il ?
Engager des chômeurs, puis discuter des projets
Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) de l’ESIAM part d’une vision caractérisée par trois principes simples : nul n’est inemployable, ce n’est pas le travail qui manque, l’argent n’est pas le problème principal. En général, la création d’une entreprise commerciale démarre à partir d’une idée, d’un produit ou d’un service à mettre sur le marché. C’est ensuite que l’entreprise recherche les compétences dont elle aura besoin.
Dans le cas de l’ESIAM, c’est tout l’inverse. L’entreprise décide de recruter en CDI des personnes en situation de chômage de longue durée sans savoir au départ ce qu’elle va vendre. C’est à partir des compétences et de l’envie de chacun que des projets concrets voient le jour.
Contrairement aux cours de stratégie communément enseignés, nous avons la preuve qu’il est possible de créer une entreprise sans connaître le produit ou le service qu’elle vendra. Il n’y a nul besoin d’une étude de marché pour entreprendre. Ce sont les moyens disponibles qui permettent de coordonner l’action.
Renverser les habitudes entrepreneuriales
Le mode opératoire de l’ESIAM est fascinant car il se distingue de la logique habituelle. En effet, traditionnellement, la pensée entrepreneuriale s’organise de façon simple : « quel est le problème ? », « pourquoi ce problème existe-t-il ? » (ses causes), « que pourrait-on envisager pour corriger ce problème ? ». Cette séquence est dérivée de la méthode scientifique qui part d’une situation donnée pour ensuite comprendre pourquoi.
On parle alors d’une approche causale car elle est organisée selon l’effet attendu (le problème résolu) et les moyens nécessaires, ceux permettant d’éliminer au moins une cause jugée importante.
Dans le cas de l’ESIAM, le raisonnement qui est à l’origine de l’idée est très différent. Il commence par « quel est le problème ? », « qu’est-ce que je sais ? », « qu’est-ce qu’il est possible de faire sachant ce que je sais ? ». Cette nouvelle séquence s’apparente à l’approche effectuale : elle s’organise selon une séquence « moyens suffisants » (ce que je sais) et « effet possible » (ce que je peux faire).
Une approche causale pour l’ESIAM aurait été : « pourquoi ce problème existe-t-il ? » (ses causes). Or, il n’est pas facile de répondre à cette question car les causes du chômage de longue durée sont multi-factorielles : il peut s’agir d’une désindustrialisation du territoire, d’un manque de formation sur la région, d’un territoire rural délaissé… Dans ce cas, quelle cause privilégier ? Ensuite, à la question « qu’est-ce qu’il est possible de faire pour corriger ce problème ? », difficile de savoir quel levier actionner. Par exemple, pourquoi ne pas agir sur la formation ? Certainement, mais dans ce cas la dépense publique risque d’augmenter et la désindustrialisation ne baissera pas pour autant, sauf à réinvestir de l’argent public pour aider les entreprises à se maintenir ou à se créer. Au final; ces décisions auront coûté très cher et pas un seul emploi n’aura été créé.
Résoudre le problème du chômage longue durée
L’approche effectuale qu’a poursuivie l’ESIAM semble beaucoup plus prometteuse : « Qu’est-ce que je sais ? » : les 3 principes évoqués précédemment. « Qu’est-ce qu’il est possible de faire sachant ce que je sais ? » : valoriser les compétences des chômeurs en détectant les talents et leurs envies, rediriger l’argent destiné au chômeur. En remettant au travail des chômeurs, je n’augmente pas la dépense publique et je peux même la diminuer à terme. Cerise sur le gâteau : cela fait du bien aux anciens chômeurs, à leur famille ainsi qu’à tout le territoire concerné.
Cet exemple est une avancée majeure pour l’avenir de nos sociétés : nous devons accepter cette révolution cognitive. Sans cette révolution, nous ressasserons nos problèmes sans voir aucune issue. Opérer ce changement conduit à simplement s’interroger sur l’intérêt de reproduire un mode de pensée obsolète et se décider à le changer pour plus d’efficacité. Nul besoin de s’intéresser aux causes d’un problème pour agir. C’est en tout cas ce que démontre l’initiative d’ATD Quart Monde.
Il y a donc deux bonnes nouvelles dans cette belle histoire : il est possible de sortir de l’ornière des chômeurs de longue durée et le raisonnement effectual s’applique avec succès à n’importe quelle situation que l’on croyait insoluble.
La méthode effectuale est un mode de raisonnement et d’action qu’utilisent depuis longtemps les entrepreneurs et dont les politiques devraient s’emparer au plus vite. Il y a urgence car leur impuissance n’est-elle pas la plus grande menace pour nos démocraties ?
- Professeur en cognition entrepreneuriale, SKEMA Business School. ↩



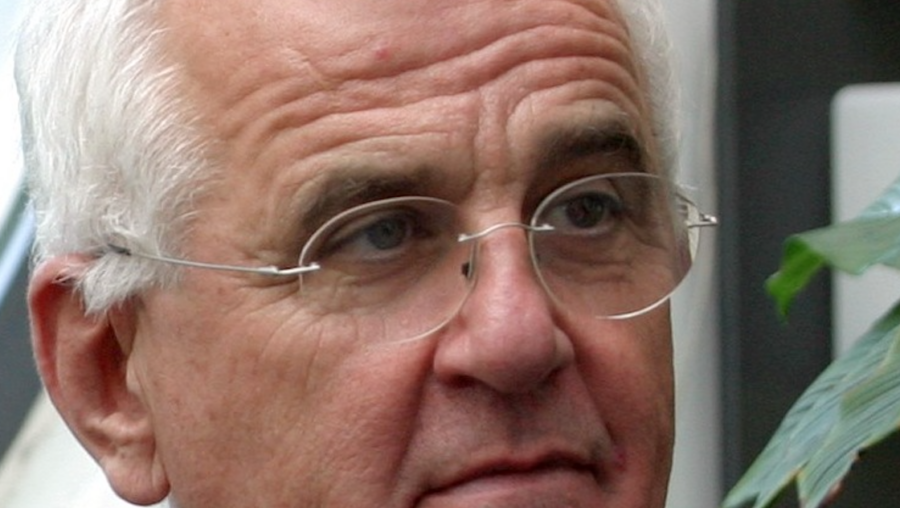

si cette mèthode là donne de bons résultat , il faut la mettre sous le nez des politiques parce que d’eux même ils ne seraient pas capable de cogiter dans ce sens là ….leurs neurones ne sont pas à jour…..
Oui, en effet. La pensée effectuale, bien que naturelle, est très peu enseignée et seulement depuis quelques années. C’est la logique causale qui est très largement majoritaire dans les enseignements.
C’est de l’assistanat comme les autres .
N’importe quel salarie a eu la meme demarche , qui a besoin de mes compétences ?
Et l’auto entreprenneur en l’abscence de debouchees a cree son entreprise.
Je vois pas d’intérêt a ce truc sauf que c’est a petite echelle donc plus pres du chomeur ,plus efficace qu’un stagiaire de pole emploi.
Rien de nouveau ni de revolutionnaire.
Visiblement vous n’avez pas regardé l’émission de M6. Disons que cela coûte un peu plus cher au début puis moins cher dès que l’entreprise Esiam voit son activité marchande augmenter. Le recul n’est que de 3 ans mais l’entreprise génèrerait déjà 240 K€ de CA annuel, en étant parti de 0. Ceci, sans compter les bénéfices cachés sur le territoire dont la baisse des frais de santé de chômeurs qui n’ont plus besoin d’anti-dépresseurs…
oui néanmoins il manque deux élément… combien çà coûte et kicékipaye.. par ce que si c’est le contribuable allez vous faire voir
une annulation du RSA arriverait au meme resultat
ce point de vue est respectable, mais ce projet fonctionne grâce aux aides publiques (RSA, allocations chômage, etc . . ) et il aboutit à une sorte de fonctionnarisation des emplois créés.
Il faudrait que des projets de ce type aboutissent à la réciprocité pour la majorité des emplois créés, id. la réciprocité; soit la capacité des personnes qui suivent cette voie de pouvoir, à moyen ou long terme, rendre à la société, ici, les chômeurs longue durée, ce qu’ils ont reçu par le fruit de leur activité . .
Cette expérience mérite d’être poursuivie à son terme mais dans un cadre restreint (15 – 20 territoires), puis faire un retour d’expérience par un groupe d’experts divers et pas seulement par ceux, certes respectables, qui comme vous ont pour ce type d’expérimentation “les yeux de Chimène”.
L’étude des documents comptables présentés sur le site de l’ESIAM révèle en effet la part prépondérante des aides et subventions dans les rentrées d’argent de “l’entreprise”. La démarche ne peut donc être approuvée que si, rendus de nouveau employables, ces anciens chômeurs de longue durée retrouvent du travail en dehors de ce cocon; ce que le site de l’ESIAM ne dit pas.
Pourrait-on également convertir le RSA et les alloc comme un crédit, remboursable à l’État (ou le département pour le RSA) quand on retrouve du travail?
On serait, je pense, bien plus motivé à travailler pour rembourser le moins d’argent possible.
C’est le fonctionnement du Luxembourg si je ne m’abuse.
bravo