Par Johan Rivalland.
Nous connaissons la célèbre réponse qu’aurait donnée le Duc de La Rochefoucauld, telle que rapportée par le général de La Fayette, en 1789 lorsqu’il vint annoncer au roi Louis XVI la prise de la Bastille : « Est-ce une révolte ? – Non, Sire, ce n’est pas une révolte, c’est une Révolution ».
Gaël Nofri entend, à travers cet ouvrage, présenter une histoire des Révolutions en France. Il s’agit pour lui de montrer que si la Révolution de 1789 est communément considérée comme la mère de toutes les révolutions, elle est loin d’être la seule. Et il y a des enseignements à en tirer sur l’esprit qui s’en dégage et l’héritage commun qui est le leur.
Révolte ou Révolution ?
C’est pourquoi, pour commencer, l’auteur caractérise ce qui distingue une révolte d’une révolution. Pour mieux délimiter le cadre dans lequel se situe son histoire. Avec en arrière-plan cette citation de Simone Weil, en préambule, qui donne bien le ton de l’ouvrage : « On pense aujourd’hui à la révolution, non comme à une solution des problèmes posés par l’actualité, mais comme à un miracle dispensant de résoudre les problèmes ».
Les révoltes, écrit-il ainsi, sont des mouvements dont :
[…] aucun ne porte en lui une remise en cause de l’organisation de l’État assortie d’une volonté d’y substituer une autre organisation. Dès lors, par opposition, il convient d’affirmer que « faire la révolution » présuppose l’existence d’une organisation de l’État et donc d’un État. Celui-ci étant pensé, depuis Machiavel et Jean Bodin, comme l’unificateur et l’organisateur politique de la société, au-dessus des considérations individuelles, qu’elles soient morales, religieuses ou financières.
L’absence de réforme comme mal initial…
Un autre passage, que je vous cite, évoque une situation qui pourrait étrangement faire penser à la situation actuelle (mouvement des Gilets jaunes), même si l’auteur n’y fait évidemment pas référence, car ce n’est non seulement pas l’objet de son livre, mais encore celui-ci a été écrit avant ces événements. :
La réforme est une tentative de réponse dont l’échec contribue à rendre inévitable la révolution, en même temps qu’il la justifie et en structure la pensée. C’est face à l’absence de réforme, à l’impossibilité du pouvoir de se transformer par lui-même, à l’impasse que représente l’ordre établi face au besoin des institutions de s’adapter, que la révolution se transforme, dans l’esprit public, en impérieuse nécessité.
… et les maux qui s’ensuivent
Gaël Nofri note ainsi que la révolution est une rupture de légalité et se fait généralement dans la violence. La plupart du temps sous l’action d’une minorité agissante et déterminée. Et généralement avant tout à Paris, là où sont centralisés les pouvoirs. Quant au peuple en général, ou les masses qui le composent partiellement, il relève ceci :
Partagées entre l’aspiration naturelle à l’ordre et le constat désespéré du blocage institutionnel, les masses restent en général spectatrices et changent de camp en fonction de l’évolution de la situation.
Deux lectures de la Révolution
Gaël Nofri observe que le sens du mot révolution ne fait pas l’unanimité et est, de ce fait, source d’erreurs et d’incompréhensions. En effet, si la vision « progressiste » des dits « modernes » veut y voir « une marche en avant vers un avenir radieux, oublieux d’un passé qu’ils condamnent », étymologiquement, de même que la « réforme » vise à re-trouver la forme, la révolution invite à un retour en arrière.
L’une des premières utilisations du terme en politique, nous dit l’auteur, remonte d’ailleurs au moment de la guerre civile anglaise de 1642, appelée plus tard « première révolution anglaise », qui permit le retour à la monarchie. C’est donc une détérioration par rapport à une situation antérieure, même si un changement de régime avait été accepté, qui est dénoncé par les révolutionnaires. Et qui amène l’idée que, soit le contrat initial entre gouvernants et gouvernés a été trahi, soit il a été altéré par l’immobilisme de ces gouvernants. Dans les deux cas, on aspire au retour à une sorte d’âge d’or passé fantasmé (Gaël Nofri en apporte, bien évidemment plusieurs exemples historiques, et c’est l’intérêt du livre). C’est, entre autres, la philosophie de Rousseau et de son contrat social qui va commencer à transformer le point de vue sur la révolution et faire de l’état de nature le nouvel âge d’or. Sans toutefois que la dimension réactionnaire précédente disparaisse totalement.
Un condensé d’histoire de France
C’est donc à travers de multiples épisodes révolutionnaires que Gaël Nofri nous invite à cette incursion dans l’histoire des révolutions en France : Étienne Marcel, Caboche, Guerres de religions, les Frondes, 1789-1799, 1830, 1832-1834, 1848, 1870, la Commune, révolution antiparlementaire de février 1934, Mai 68, autant d’épisodes d’une œuvre historique et humaine complexe dont l’ouvrage nous dresse un passionnant diaporama éloquent.
Une analyse utile en ces nouveaux temps agités. Et qui montre que les soubresauts de l’histoire ne sont pas si rares…
Gaël Nofri, Une histoire des Révolutions en France, Les éditions du Cerf, juin 2018, 464 pages.

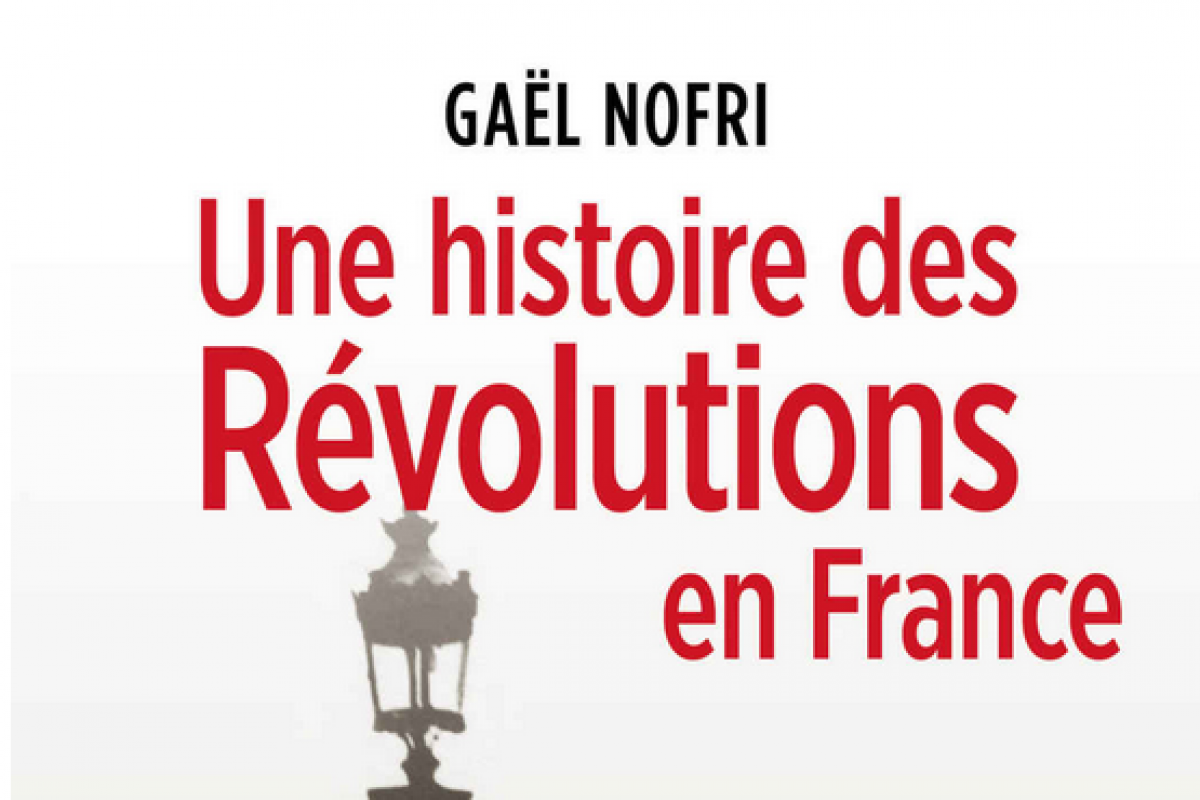

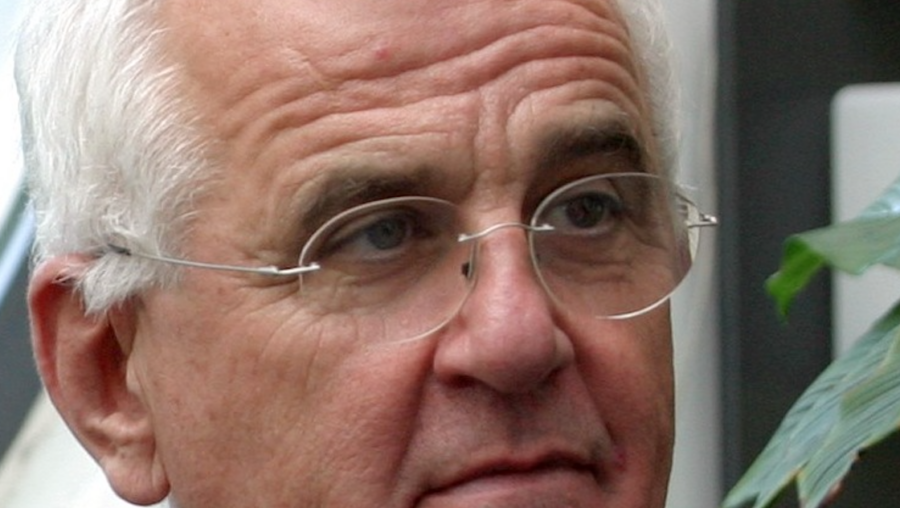

il est clair que la france ne se reforme que par des révolutions, ou a la faveur de guerres perdues.
Les organisations qui la gouverne n’ayant de cesse que de “légaliser” leurs privilèges au fil du temps.. jusqu’à l’insoutenable
fardeau fiscal.*Nous sommes dans cet ère actuellement’
n’en doutons pas.
La révolution c’est surtout l’affaire des pays avec état très centralisé, qui par nature ont une diversité géographique et culturelle importante.
De quelle Simone Weil s”agit-il ?
Celle avec un ‘W’ a ne pas confondre avec celle avec un ‘V’.
Faut cliquer dessus…
Une révolte ne devrait pas tendre vers une révolution mais vers une évolution. Mais il me semble que dans notre cas, le sédiment de la révolte résulte plus du fait que nous voulons réformer “au galop” au lieu de nous donner le temps de nous adapter.
Nous oublions que le plus grand frein à l’évolution est le poids des traditions et que les réformes doivent être comprises pour être acceptées.