Par Marcin Śrama.
C’est dans la nature des choses qu’un homme qui surpasse les autres par son talent s’oppose à l’idée de démocratie et d’égalité.
Il en est ainsi, parmi d’autres, d’Ignace Paderewski, pianiste et compositeur polonais, qui, pendant la Première Guerre mondiale, a utilisé son talent dans la conduite des affaires de son pays avant de représenter la future république à la conférence de Paris.
La source d’information principale au sujet des opinions politiques de Paderewski se trouve dans ses mémoires rédigés par Mary Lawton, et en particulier la deuxième partie, non publiée en Pologne avant 1992. Dans ce chapitre, le pianiste se lance dans une critique de la démocratie et livre également sa conception de l’égalité entre les citoyens. La démocratie est pour lui une idée sublime, qui pourtant n’est jamais parfaitement mise en oeuvre dans la société dès lors que la population se réfère à elle uniquement au moment des élections et que cette société redevient par la suite hiérarchique ; ce qui est absolument nécessaire car « sans hiérarchie, l’exercice du pouvoir n’est pas possible ». Même si cette hiérarchie pouvait être réduite à sa plus simple expression dans un quelconque État, il subsiste une sphère dans laquelle l’égalitarisme ne pourra jamais supplanter la domination, en l’occurrence celle de l’armée.
Selon Paderewski, l’égalitarisme démocratique devient totalement absurde quand,
en parlant d’égalité en droit en général, on parle rarement d’égalité des devoirs. Nous revendiquons l’égalité en droit mais jamais l’égalité des devoirs. Cet aspect n’est jamais abordé. Nous l’ignorons à tel point que nous supprimons l’impôt sur certains faibles revenus ; ce qui est, selon mon opinion, mal à propos voire insultant envers la dignité du citoyen. Indépendamment du niveau de revenu, même le plus bas, celui-ci devrait être imposé pour démontrer que l’égalité entre les citoyens existe réellement.
À son corps défendant, le successeur de Paderewski au poste de Premier ministre, Leopold Skulski, a eu l’occasion de découvrir les méfaits d’une conception égalitaire en droit menée dans l’oubli de l’égalité des devoirs. C’est au cours de son mandat, en effet, qu’a débuté une grève des ouvriers de la compagnie des chemins de fer luttant pour de meilleures conditions de travail. Rien de fâcheux ne se serait sans doute passé, mais cet évènement se déroula au moment même où le jeune État polonais se défendait difficilement face à l’agresseur bolchévique ; les soldats polonais risquaient leur vie sur le front dans des conditions horribles tandis que les ouvriers vivaient paisiblement à l’ouest de la République. Les participants à cette protestation comprenaient parfaitement l’idée de l’égalité en droit des citoyens mais avaient ignoré leurs devoirs.
Le constat de Paderewski que l’égalité en droit va de pair avec l’égalité des devoirs peut en apparence faire croire que le père fondateur de la IIe république était, dans un certain sens, en faveur de l’égalitarisme, mais il n’en est rien. Selon lui, indépendamment de la question des devoirs, le principe d’égalité en droit porte en lui le germe de la déchéance de l’État dans lequel il est admis. Le pianiste se base sur l’histoire des cités-États grecques dans lesquelles les citoyens avaient les mêmes droits ; alors que ceux-ci étaient propriétaires de terres, seule une élite possédait réellement des droits civiques. Malgré cela, les cités-États grecques tombèrent en peu de temps ; ce fut le cas d’Athènes dont les débuts du régime démocratique remontent à la fin du VIe siècle av. J.-C. Après un peu plus de cent ans, cette ville fut conquise par Sparthe après la guerre du Péloponnèse et en 338 av. J.-C., elle perdit son indépendance. Ce fait historique conduit Paderewski à qualifier les cités-États grecques de “première victime de la démocratie”.
Pour renforcer son opinion, il se réfère à Aristote, un des plus grands philosophes athéniens qui déclarait qu’il faut “peser les voix et non les compter”. Il résume sa critique de la démocratie en arguant du fait que la pensée des philosophes grecs, qui ont les premiers élaboré une analyse en profondeur de la démocratie, est toujours d’actualité vingt-deux siècles plus tard.
Cela vaut la peine de se souvenir de la manière de penser de Paderewski pendant cette période de commémoration du centième anniversaire de l’indépendance retrouvée de la Pologne, au cours de laquelle les media mainstream auront certainement à cœur de perpétuer le mythe de l’allégation démocratique dans la pensée du père fondateur de la IIe république polonaise.
—


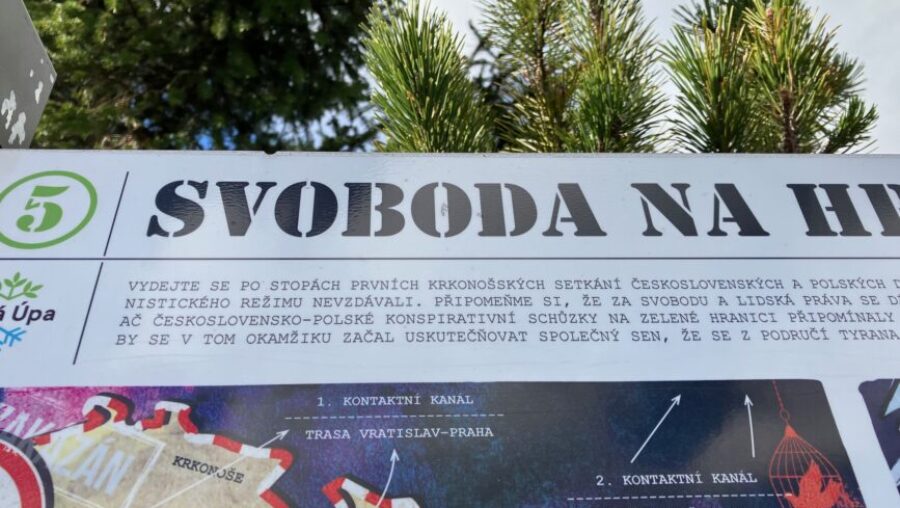

L’égalité des devoirs, préalable nécessaire à l’égalité des droits : voilà un concept furieusement révolutionnaire pour nos Etats obèses et nos démocraties corrompues par des décennies de socialisme et de collectivisme !
hérétique :! comment se faire élire sans promesses des lendemains qui chantent si tout le monde doit accepter des devoirs! surtout “sonnants et trébuchants”..
c’est bien plus facile de trouver 51% de la population en leur promettant faire payer les autres!