Par Fabio Rafael Fiallo.
Temps difficiles pour la culture européenne, et donc pour celle de la France, que le tournant des années 20 du siècle dernier. Voilà une Europe dévastée par une conflagration fratricide et qui subissait alors, de surcroît, la pénétration – politique, économique et culturelle – de la puissance montante de l’époque, celle-là même qui avait pesé de tout son poids dans la défaite du militarisme prussien.
Aussi fallait-il désormais faire face aux ambitions de cette Amérique et à l’arrivée sur sol européen du fameux American way of life, jugé trop superficiel et barbare vu de ce côté-ci de l’Atlantique.
Le danger américain
Il y avait, paraît-il, de quoi crier à l’outrage. Défi relevé par une pléiade d’écrivains français de l’époque, parmi lesquels Robert Aron, Arnaud Dandieu et, plus que tout autre, un Georges Duhamel pour qui
le moment solennel, dans l’histoire du XXème siècle, ce n’est pas le mois d’aout 1914, ni le mois de novembre 1918. Non, écoutez-moi bien : c’est le moment où le marché intérieur de l’Amérique a cessé de lui suffire.
Dans le réquisitoire de Georges Duhamel, tout y passe, à commencer par le supposé goût des Ricains pour le spectacle facile,
qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n’aborde sérieusement aucun problème, n’allume aucune passion, n’éveille au fond des cœurs aucune lumière, n’excite aucune espérance sinon celle, ridicule, d’être un jour ‘star’ à Los Angeles
Nous voilà donc avertis.
La France américanisée
Les mises en garde de ces écrivains éclairés sur le mode de vie aux États-Unis n’y purent rien. Comme le monde en général, l’Europe s’est américanisée. Et la France avec.
Aujourd’hui, quand on voit que la loi Toubon (obligeant à traduire en français les expressions angloaméricaines utilisées dans la publicité en France) fut contournée (au moins pour un certain temps) par la mairie de Paris pour afficher le Made for sharing sur la Tour Eiffel et ainsi faire la promotion des JO 2024.
Quand on voit que le Minitel, voulant se mesurer à Internet, rejoignit rapidement le musée des inventions ratées. Quand on voit que le jeans a déplacé le costume trois pièces, parfois même pour les enterrements.
Quand on voit, enfin, que le hamburger est devenu un met incontournable dans les cartes de nombreux restaurants bien cotés à Paris et en province, et ce, malgré les cris contre la « malbouffe » des porte-étendards de la gastronomie française. Quand on voit tout cela, donc, il faut se dire que la lutte contre la pénétration culturelle américaine ne semble pas avoir pris le chemin de la victoire.
Les funérailles d’un rockeur
C’est dans ce contexte ingrat pour les contempteurs de l’American way of life qu’est venu s’ajouter le spectacle des funérailles de Johnny Halliday. C’en fut trop pour l’un des gardiens les plus zélés du patrimoine culturel français face à l’américanisation du monde et de la France. Il s’agit de Régis Debray, qui vient de faire paraître un article sur l’événement en question.
Sur un ton cynique et (il faut le reconnaître) élégant en même temps, les complaintes de Régis Debray – dans la lignée du réquisitoire de Georges Duhamel mentionné ci-dessus – reflètent le malaise créé, chez une certaine intelligentsia française, par des funérailles en honneur d’un « simple » rockeur, des funérailles qui prirent des dimensions nationales et qui firent chuter l’audimat du Téléthon et rassembler le chef de l’État et d’anciens présidents de la République aux côtés des personnalités du showbiz.
Or, ce que les gardiens du temple de la culture française (depuis Georges Duhamel jusqu’à Régis Debray) peinent à comprendre, c’est qu’ils livrent un combat d’arrière-garde.
Les lois contre le changement -et l’américanisation- ne servent à rien
De même que les changements technologiques, les mutations culturelles ne peuvent pas être bloquées par des lois ridicules, pas plus qu’elles ne peuvent être imposées. Elles échappent au bon vouloir des bienpensants de l’époque et des autorités de l’État. Ce sont et l’inventivité humaine et les goûts du public (et partant le marché, oui, le marché) qui décident qu’il en soit ainsi.
L’imprimerie de Gutenberg sonna le glas des manuscrits copiés par des moines dans le silence des monastères, ouvrant les portes à la popularisation de la lecture. Aujourd’hui, c’est au tour de la culture basée sur le papier imprimé d’être concurrencée, et ô combien, par l’audiovisuel, la tablette et le smartphone – et par l’échelle des valeurs qui s’ensuit. Et aucune mise en garde, aucune jérémiade, ne saurait renverser la tendance.
La culture américaine toujours vivante
Qu’on se le dise : les États-Unis vont mal, très mal, ayant élu un président clownesque qui ne fait que tourner le dos aux valeurs de son pays, bousiller le leadership de ce dernier et gouverner sans cap. Mais ce n’est pas pour autant que la culture américaine cessera de marquer le monde du sceau de sa vitalité.
Toute lamentation autour du caractère apothéotique et consensuel des funérailles de Johnny – au nom de la lutte contre l’américanisation de l’Europe et de la France – est d’autant plus discutable que lui, Johnny Halliday, ne s’était pas contenté d’amener en France un rythme créé aux États-Unis : il parvint à franciser le rock’n’roll. Bel exploit, qui vaut bien davantage que de tenter de ressusciter vainement le bal musette ou autres reliques du passé.



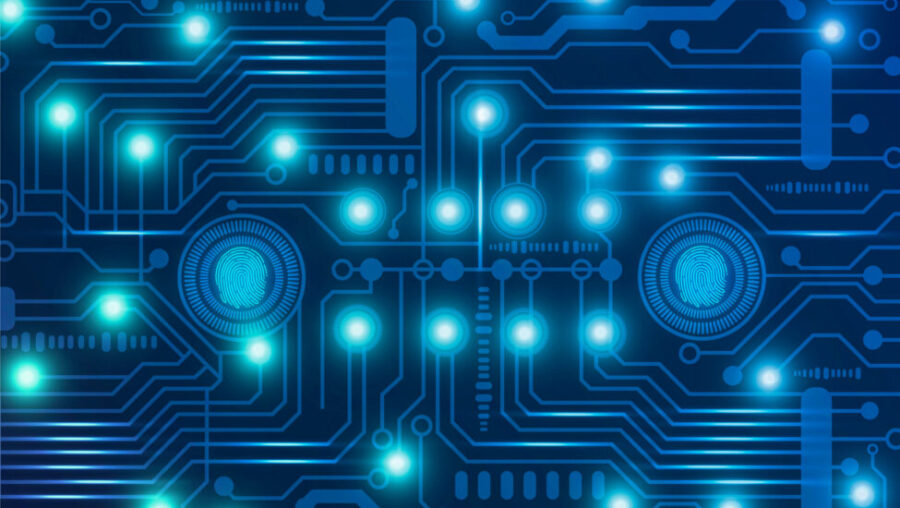

L’américanisation n’est juste qu’un prétexte pour critiquer un talent et une réussite. Juste une excuse.
Ces gens là n’aiment tout simplement pas que d’autres réussissent bien mieux qu’eux sans avoir leur “culture”.
Ils ont une haute prétention a mépriser toutes les réussites qui ne viennent pas des intello-bobos.
Ils jugent tous les autres qui n’ont pas fait des études littéraires et sociales comme des “beaufs ” et “ringards”.
Alors un artiste qui au départ avait moins de cartes en main qu’eux, n’importe quel excuse bidonnée diabolisante fait l’affaire…
Le fond comme la forme ne sont que gesticulations de gens aigris et frustré de n’être plus petit dans les magasines et les affiches.
Johnny a vendu 100 millions de disque, certe, les Beatles en ont vendu 20 fois plus en 15 ans de carrières, de même, ad/dc, rolling stones, led zeppelin, Bowie, Dylan, Morrison… ils sont tous anglo saxon (2/3 sont anglais), mais surtout, au delà des textes, ce sont des musiciens, compositeur, et pas de simples interprètes.
Retirez les textes à la plupart des artistes français, et il ne reste plus rien, ce n’est pas étonnant si c’est Gainsbourg et daft punk qui ont vendu le plus de disque à l’étranger.