Par Jean-Baptiste Boone.
Un article de l’Iref-Europe
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche disposait en 2016 de 93,3 milliards d’euros soit 30,1 % du budget de l’État et 4,2 % du PIB. 67,1 milliards d’euros sont spécifiquement consacrés à l’Éducation nationale sur laquelle cet article portera plus précisément (c’est-à-dire hors enseignement supérieur et recherche).
Pour assurer cet enseignement primaire et secondaire, qui concerne 12 258 000 élèves, le ministère emploie 1 052 757 personnes dont 855 028 enseignants. Il s’agit donc de 19,3 % des fonctionnaires français qui sont embauchés par l’Éducation nationale. Ils représentent presque la moitié de la fonction publique d’État.
L’enseignement en France se caractérise par la partition entre public et privé ; et même privé hors contrat, filière dans laquelle 50 000 enfant sont instruits.
Avec cinq fois moins d’élèves scolarisés, l’enseignement privé reste très minoritaire en France, quoiqu’il soit réputé meilleur. Pourtant, le taux d’encadrement est plus important dans ces établissements, que ce soit en premier ou second degré. Les syndicats de l’éducation ont tendance à prétendre que de ce taux dépend la qualité de l’enseignement.

Source : ministère de l’Éducation nationale (chiffres 2014 et 2015 publiés en 2016)
Ce taux ne doit pas être confondu avec la taille des classes qui, selon une étude de l’OCDE de 2014, varie en France de 23 à 26 élèves. Or, pour 12 258 000 élèves répartis dans des classes de 23, il faudrait 532 730 professeurs, soit 322 300 de moins qu’actuellement.
Sauf qu’élèves et enseignant n’ont pas les mêmes horaires : dans le second degré, les enseignants sont tenus d’effectuer 18 heures de cours alors que les élèves ont 26 heures de cours au moins (voire plus de 38 heures en lycée).
Taille des classes, temps d’enseignement et nombre d’heures de cours, voilà les trois variables à prendre en compte pour établir les effectifs nécessaires. Nous vous présentons ci-dessous le nombre d’enseignants nécessaires selon trois hypothèses :
En France, écart entre le nombre d’enseignants actuels (855 025) et le nombre d’enseignants nécessaires, selon l’hypothèse retenue, pour accueillir 12 252 800 élèves.
• Le choix coréen, 7e du classement PISA 2015 : 31 élèves par classe en moyenne selon l’OCDE.
 • L’option américaine, 23e à 40e dans le classement PISA selon les disciplines : 27 heures de cours à donner en secondaire, selon l’OCDE.
• L’option américaine, 23e à 40e dans le classement PISA selon les disciplines : 27 heures de cours à donner en secondaire, selon l’OCDE.
 • Au Japon, les élèves étudient en moyenne 22 heures par semaine selon l’OCDE. Le pays est classé entre la deuxième et la huitième place, selon les matières dans le classement PISA.
• Au Japon, les élèves étudient en moyenne 22 heures par semaine selon l’OCDE. Le pays est classé entre la deuxième et la huitième place, selon les matières dans le classement PISA.
 Selon les données retenues, correspondant à des manières de faire différentes observées dans divers pays étrangers, l’on observe des variations extrêmes allant de -70 % à + 40 % !
Selon les données retenues, correspondant à des manières de faire différentes observées dans divers pays étrangers, l’on observe des variations extrêmes allant de -70 % à + 40 % !
 Bien sûr, ces extrêmes vont de pair avec des variables presque contradictoires : temps d’enseignement très importants face à des horaires de cours réduits pour les élèves, ou très petites classes pour un temps d’enseignement lui aussi restreint.
Bien sûr, ces extrêmes vont de pair avec des variables presque contradictoires : temps d’enseignement très importants face à des horaires de cours réduits pour les élèves, ou très petites classes pour un temps d’enseignement lui aussi restreint.
Néanmoins, le plus souvent, la différence est négative : c’est qu’en France, le rapport entre temps d’enseignement exigé et nombre d’heures de cours des élèves peut aller du simple au double (18 h contre 36 h voire plus).
Finalement, face à la diversité des situations imaginables, pourquoi ne pas mettre chaque établissement face à ses responsabilités, pédagogiques d’abord, budgétaires ensuite ? C’est ce qui serait possible avec l’introduction du chèque éducation.
—


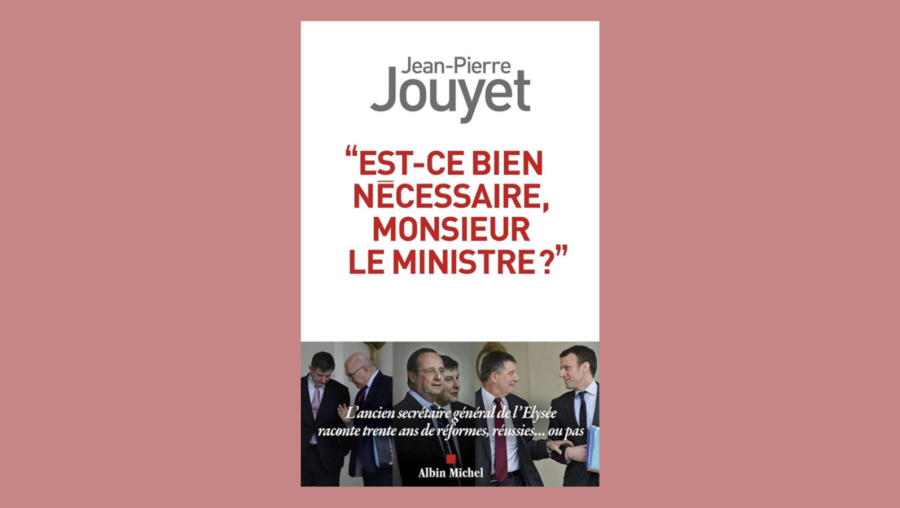


Laisser un commentaire
Créer un compte