Il y a vingt ans, 50,6 % des Québécois répondaient « Non » à la question référendaire. Cet anniversaire a remis l’Indépendance du Québec à l’avant-scène de l’actualité et les commentaires, qui fusent de toutes parts, oscillent entre la nostalgie et la rancœur, la résignation et la persévérance. Mais une question hante tous les souverainistes convaincus : « La prochaine fois sera-t-elle la bonne ? »
Par Nathalie Elgrably-Lévy.

Dans une déclaration fracassante dont le mouvement souverainiste porte encore les séquelles, Jacques Parizeau avait attribué la défaite référendaire à l’argent et au vote ethnique. Du point de vue strictement statistique, cette affirmation est évidemment fausse. De nombreux Québécois «de souche» et non fortunés avaient également décliné l’invitation du PQ.
Or, qu’ont fait le PQ et le mouvement souverainiste depuis vingt ans pour gagner la confiance et le soutien de ceux qui ont du succès ?
Mais du point de vue idéologique, voire philosophique, elle est fondée. L’«argent» et les nouveaux immigrants étaient effectivement hermétiques au projet souverainiste. Jacques Parizeau a peut-être manqué d’élégance dans sa formulation, et il a certainement mal choisi son moment, mais son diagnostic était avéré.
Face au constat, il aurait été logique que le PQ s’adonne à un examen de conscience. Quand un pan de la société rejette une option, lui faire tout simplement porter le blâme est stérile, voire contre-productif. Pour espérer que la prochaine fois soit la bonne, le mouvement souverainiste aurait donc dû s’ingénier à comprendre pourquoi certains ont résisté à l’appel du PQ, et à identifier ce qu’il avait à accomplir pour rallier les récalcitrants. Cela a-t-il été fait ?
Prenons le cas de l’«argent». Par ce terme, M. Parizeau visait les «riches». La richesse étant l’expression matérielle du succès professionnel, il admettait implicitement que le projet indépendantiste rebutait les Québécois les plus productifs, ceux qui réussissent ce qu’ils entreprennent.
Fardeaux plus lourds
Or, qu’ont fait le PQ et le mouvement souverainiste depuis vingt ans pour gagner la confiance et le soutien de ceux qui ont du succès ? L’effort et la prise de risque sont-ils mieux récompensés ? Les fardeaux fiscal et bureaucratique ont-ils été allégés ? Pas du tout ! Ils se sont même alourdis.
Selon les statistiques les plus récentes du ministère des Finances du Québec, qui datent de 2012 !, les contribuables appartenant au quintile supérieur, soit les 20 % des plus riches, ont touché 51,3 % des revenus et ont payé 70,2 % des impôts. Quelques mois avant le référendum de 1995, ce quintile payait 64,6 % des impôts.
En matière de fiscalité des entreprises, le portrait est similaire. Les entreprises québécoises assument les coûts fiscaux les plus élevés au pays avec 5,1 % de la valeur de la production brute, contre 4,1 % au Canada. Elles doivent également composer avec le poids de la paperasse, la multiplication des réglementations et un environnement économique hostile aux affaires.
Des vaches à traire
Au lieu de respecter ceux qui gagnent, de valoriser la réussite et d’encourager l’initiative, l’État québécois voit les riches et les entrepreneurs comme des vaches à traire. Faut-il être surpris qu’ils refusent de lui donner plus de pouvoir ?
Le référendum de 1995 a été perdu à cause de l’argent. Mais les souverainistes en ont-ils tiré une leçon ? Ont-ils compris que tant que l’État restera accroché aux mamelles de la classe productive, celle-ci craindra l’indépendance ? On ne donne pas les coudées franches à celui qui veut s’approprier le fruit de notre travail !
—


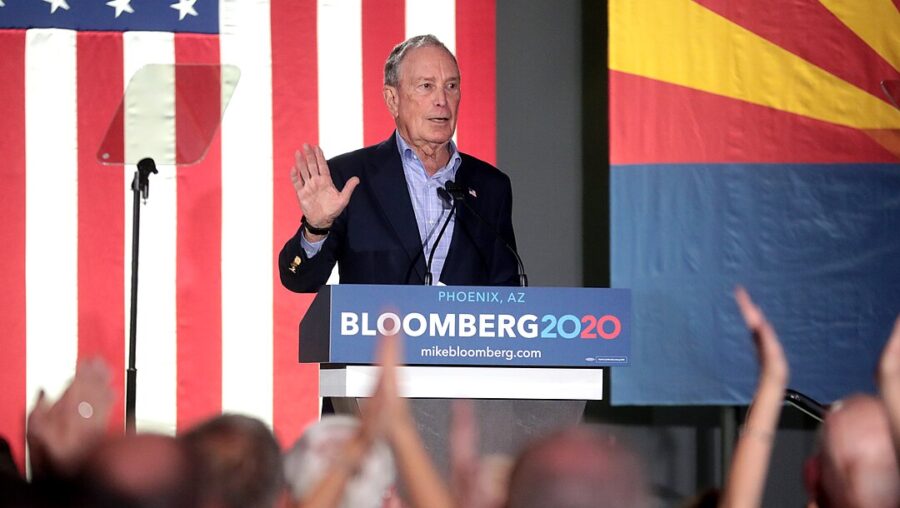


Nathalie Elgrably-Lévy est une néolibérale. Elle est affligée d’un double standard qui rend incohérent le principe de non-agression et de libre marché. Pour elle, quand on prend de force aux riches pour donner aux pauvres, c’est illégitime. Jusque là, c’est cohérent.
Le problème, c’est que pour elle, si vous êtes capables de corrompre les politiciens, les juges, que vous manipules les médias et l’opinion public, que vous mentez pour aboutir à vos fins et que vous tirez profit directement ou indirectement d’actes d’agression, des guerres à l’étranger ou des manipulations des prix à travers la géopolitique d’interventionnisme étatique, tout ce que vous faites est très bien. Aucun problème.
Nathalie Elgrably-Lévy ne connait probablement rien au sujet du système Bretton-Woods, du “Nixon Shock” et n’a certainement jamais remis en perspective la notion de “libre marché” dans le contexte d’une banque centrale qui émet en monopole des devises fiduciaires à cours forcé. Donc elle ne tient aucunement compte de l’échelle macro: tout l’aspect des marchés internationaux, des guerres de ressources, du pétrodollar, des manipulations des changes flottants, etc…
D’où sa fixation presque compulsive sur les dettes d’état et sur la fiscalité à petite échelle. Puis sa vénération aveugle des “grands entrepreneurs” qui sont des modèles de réussite, peu importe si leur succès repose de manière directe ou indirecte sur du “corporate welfare”.
@rlaroche
Pouvez vous étayez vos vomissures avec des faits? Personnellement je crois qu’elle a plus de crédibilité qu’un rlaroche.
De quel «argent» parlait Jacques Parizeau? Je ne pense pas que c’était celui des «riches», mais plutôt celui du gouvernement fédéral que celui-ci a déversé illégalement et allègrement dans le Comité du Non, au mépris de la loi référendaire québécoise (voir le rapport Grenier). Mais où était donc Nathalie Elgrably-Lévy en 1995?