Par Anthony Vegat.
Derrière les idéologies, les valeurs, les soi-disant choix de société, la politique est avant tout un espace où se heurtent les groupes d’intérêts dans l’espoir d’imposer à tous, par la force, leur propre projet.
Qu’est-ce que la politique ? C’est un rapport de force dans lequel chaque groupe a pour objectif de défendre des intérêts personnels, les intérêts de son clan. Quelle grandeur à cela ? Aucune. Au contraire, le procédé est assez lâche : pour imposer un fonctionnement qui leur serait bénéfique, ces groupes d’individus font appel à la puissance coercitive de l’État. En somme, ils utilisent les ressources de l’État et sa force de répression pour imposer à tous des fonctionnements qui leur sont personnellement profitables.
Qu’est-ce que cherche un électeur qui vote pour une politique conservatrice ? Il cherche à imposer à tous, les valeurs, les croyances, le mode de vie qui sont ceux de ses aïeux et à garder pour lui-même le maximum de ce qu’il a hérité de ses parents.
Qu’est-ce que cherche un électeur qui vote pour une politique socialiste ? Il cherche à ponctionner davantage certains groupes d’individus au bénéfice du groupe auquel il appartient.
Le jeu de l’élection fera qu’une mesure favorable à 51% d’une population s’imposera aux 49% restants. La démocratie est avant tout une dictature d’une majorité.
Dans certains modes de scrutin, il n’est même pas nécessaire de rassembler 50% des voix pour imposer une politique. C’est le cas par exemple du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours utilisé pour les élections législatives en France. Avec ce mode de scrutin, le parti majoritaire obtenait en 2002 63% des sièges à l’assemblée avec seulement 34% des voix au premier tour. Mais il faut savoir que la participation au premier tour était de 64%.
Il est donc possible d’avoir la majorité absolue à une assemblée et donc d’avoir les mains totalement libres pour diriger un pays « démocratique », en obtenant seulement 22% des voix de ses habitants… Il faudrait dès lors plutôt parler d’une dictature d’une minorité.
Derrière les idéologies, les valeurs, les soi-disant choix de société, la politique est donc avant tout un espace où se heurtent les groupes d’intérêts dans l’espoir d’imposer à tous leur propre vue, de l’imposer par la force, celle de l’État.
Les individus qui font de la politique leur métier surfent sur cette foire d’empoigne en tentant d’être ceux qui seront portés au pouvoir. L’enjeu des stratégies politiques est simplement de définir quel assemblage de réformes, ficelé dans un programme, permettra d’agglomérer suffisamment de catégories d’électeurs pour gagner. Et pour constituer une majorité, quoi de plus efficace que de distribuer des avantages catégoriels ? On accordera une baisse de la TVA pour tel corps de métier pour s’assurer son vote, un crédit d’impôt pour telle catégorie d’individus, une allocation pour telle autre catégorie, quitte à créer à chaque fois des injustices sans fondement. Les électeurs sont sensibles aux avantages catégoriels qu’on peut leur attribuer et oublient les injustices qu’ils subissent vis-à-vis des mesures qui concernent les autres catégories que la leur.
Ce petit jeu de distribution catégorielle conduit en France à un empilement incroyables d’allocations de toutes sortes, fruit de l’histoire des élections et de la drague des électeurs : allocation de présence parentale, allocation de rentrée scolaire, allocation de logement familiale, allocation de logement social, allocation spécifique de reclassement, allocation de solidarité spécifique, aide personnalisée au logement, allocation temporaire d’attente, allocation de soutien familial, prestation d’accueil du jeune enfant, complément de libre choix de mode de garde, etc.
Cela se traduit aussi par une liste non moins étendue de réductions d’impôts, crédits d’impôts, et autres déductions, résultat de la drague de telle ou telle catégorie d’électeurs : intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs, emploi d’un salarié à domicile, investissements réalisés dans les DOM-TOM et outre-mer, intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale, frais de garde des jeunes enfants, dépenses liées à la dépendance ou frais d’hébergement, aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise, souscription de parts de FCPI, souscriptions en faveur du cinéma ou de l’audiovisuel, investissements forestiers, etc.
À chaque élection, de nouvelles allocations ou de nouvelles réductions d’impôts sont inventées pour obtenir les votes des uns ou des autres en fonctions des stratégies du moment. D’où cet empilement invraisemblable.
Ainsi, que ce soit par la perception d’allocation ou l’obtention de réduction d’impôt, chaque français reçoit un subside et a ainsi le sentiment de bénéficier d’avantages. Ce maquis a aussi l’avantage de brouiller les pistes et de faire oublier les sommes gigantesques qui sont gaspillées dans la gestion du denier public.
—
Extrait de l’ouvrage de l’auteur, Émancipation.

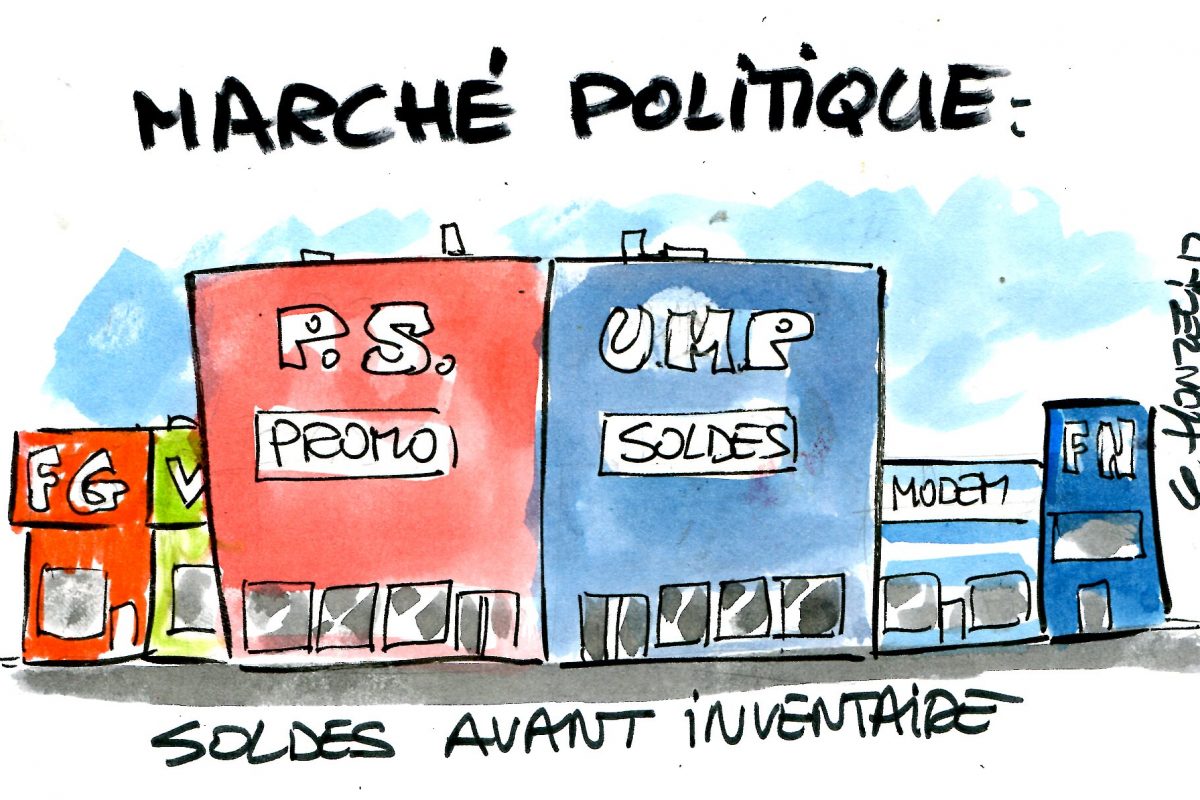



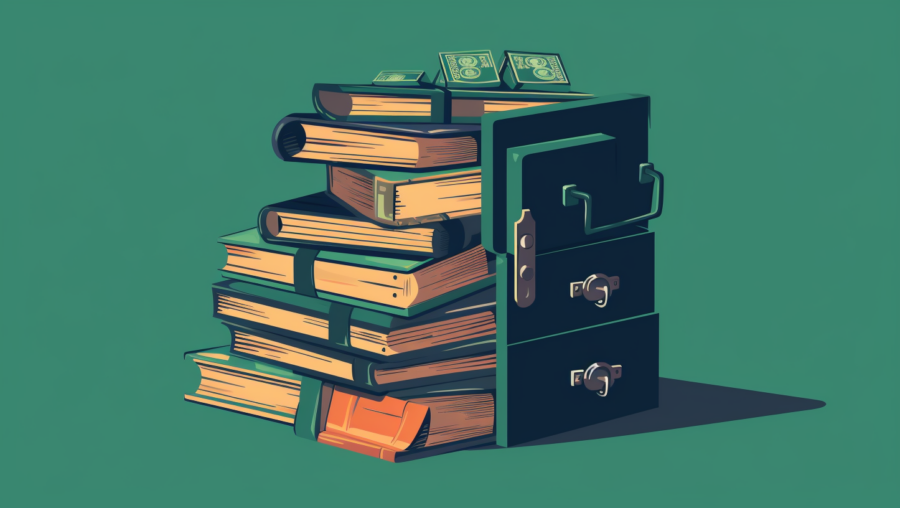
je partage cette opinion. Mais qu’est-ce que parler d’économie ?
Ce n’est pas le PIB !
Parler de capitalisme vert c’est quoi ?
Que representent les élus du local ?
j’oubliais et la politique de la ville :
cette politique est en opposition a celle de la campagne ?
Ce sont juste des slogans. Chacun peut y mettre ce qu’il veut dedans. Au plus c’est flou, au plus ça a de chance de “rassembler”. Slogan creux après slogan creux, le candidat agrège des plus en plus de catégories sociales et se donne les chances de gagner. Bienvenue dans l’époque des conseillers en com ou spin doctor.
Je pensais que l’article allait évoquer ce qu’il me semble être les deux principaux facteurs de compromissions en plus des luttes au sein des partis: Le budget de campagne et le temps d’antenne (sans contradicteur trop féroce en bonus), c’est à dire du pur marketing. C’est triste mais les électeurs se comportent plus comme des consommateurs que comme des citoyens.
“Et pour constituer une majorité, quoi de plus efficace que de distribuer des avantages catégoriels ?” Présenter les “privilèges” catégorielles comme moteur principale du vote me semble bien trop simpliste. Si demain par exemple, je me présentais en proposant des avantages pour tout le monde, je ne suis pas sur que cela suffise.