Par Johan Rivalland
À l’heure où le Mondial de football suscite l’engouement, l’enthousiasme, l’émotion ou tout une autre palette de sentiments parfaitement respectables auxquels je ne manque pas d’ailleurs de m’associer pour certains d’entre eux, avec parfois aussi son lot d’excès en tous genres, de démesure, voire de violences, quand ce n’est pas de délires quant à son impact, la question de la place des loisirs dans notre société se pose.
Il n’est pas inintéressant de l’aborder, surtout en ce début d’été et d’aspiration à des vacances que l’on espère bien méritées.
Pour autant, y a-t-il un bonheur obligatoire ? La distraction, l’amusement, la fête, la civilisation des loisirs constituent-elles un aboutissement, une fin en soi, l’apogée de l’humanité ? Doit-on l’ériger en but ultime de notre existence ?
Se distraire à en mourir
 Il s’agit du titre d’un ouvrage de Neil Postman écrit en 1985.
Il s’agit du titre d’un ouvrage de Neil Postman écrit en 1985.
C’est le point de départ de ce livre qui m’a attiré : la référence à deux romans majeurs, 1984 de George Orwell et Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley.
« Orwell craignait ceux qui interdisaient les livres. Huxley redoutait qu’il n’y ait même plus besoin d’interdire les livres car plus personne n’aurait envie d’en lire… Orwell craignait qu’on nous cache la vérité, Huxley redoutait que la vérité ne soit noyée dans un océan d’insignifiances ».
Si le point de départ du livre est fort séduisant, je n’adhère cependant pas tout à fait à cette opposition entre les deux auteurs. Neil Postman semblant donner tort au premier, pour présenter le second comme celui qui avait vu juste. De mon point de vue, les deux ont vu juste. Et aujourd’hui encore, les deux visions coexistent dans des réalités avérées. Neil Potsdam y fait d’ailleurs lui-même référence (pp. 207-208), lorsqu’il rappelle comment les livres étaient déjà l’objet de la censure (et parfois brûlés) dans la Chine ancienne, à Athènes dans la Grèce antique, etc. Mais il semble considérer que cela est le passé et n’est plus d’actualité, affirmant même qu’Orwell se trompait en y voyant une menace pour la démocratie. Ce que je conteste.
Même en France, où l’on pourrait penser qu’en 2014 la liberté de parole et d’écriture est de mise, on s’aperçoit que la censure est là, que certains bien-pensants veillent au grain (voir par exemple La Tyrannie des Bien-Pensants : Débat pour en finir ! sous la direction de Jean-Marc Chardon ; Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours de Jean Sévillia ; Les Maîtres censeurs d’Élisabeth Lévy ; Petite histoire de la désinformation de Vladimir Volkoff ; Les contre-réactionnaires : Le progressisme entre illusion et imposture de Pierre-André Taguieff, pour ne citer que quelques titres qui me viennent en tête). Et que dire de “l’affaire” Zemmour, dont beaucoup avaient alors demandé la tête, même s’il ne devait finalement sa survivance professionnelle qu’à sa popularité médiatique ?
En réalité on pourrait surtout ajouter aux deux auteurs de Neil Postman une référence à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui réconcilie les deux dans un univers où à la fois on brûle les livres (rôle des pompiers), tout en privilégiant un monde de distraction où l’écran captive le peuple, pour mieux l’anesthésier et le rendre modelable et sans volonté.
Finalement, ce qui est le plus intéressant dans l’ouvrage de Postman est… la préface.
Signée Michel Rocard (et quoi que l’on puisse penser de l’homme politique par ailleurs), elle met parfaitement en appétit, donnant envie de dévorer ce livre, qu’il présente comme un ouvrage majeur, le distinguant des centaines de livres déjà écrits au sujet des méfaits de la télévision notamment. Pour le reste, je regrette que Postman exploite trop peu ces références littéraires qu’il réserve à l’introduction du livre pour n’y revenir que tardivement et brièvement ensuite, vers la fin de l’ouvrage.
Une brève histoire de la transmission des savoirs
Notre auteur développe donc essentiellement l’idée selon laquelle « la vérité toute nue n’existe pas et n’a jamais existé ». Elle « est intimement liée aux préjugés concernant les formes d’expression ».
Se défendant donc de toute nostalgie, Postman nous rappelle le temps où la transmission des savoirs et de la mémoire passait par la voie orale. Il nous remémore le temps de la rhétorique, des raisonnements approfondis, de la réflexion et où on était bien loin de la légèreté contemporaine. Il nous renvoie en particulier à l’époque de l’avènement des États-Unis, du Mayflower et de l’incroyable culture et puissance du livre des premiers Américains, pour qui lire et débattre était normal et tout à fait habituel, quelle que soit sa catégorie sociale.
Puis il nous entraîne sur les pas du télégraphe et ensuite de la photographie, qui auraient débuté le processus de détérioration de la pensée, achevé par la télévision plus tard, qui fait l’objet de la seconde partie de l’ouvrage.
L’idée qu’il défend est « que l’essor d’un nouveau moyen de transmission de l’information modifie la structure du discours ; ceci en encourageant certaines utilisations de l’intellect, en favorisant certaines définitions de l’intelligence et de la sagesse et en exigeant une certaine forme de contenu – bref en créant de nouveaux modes d’expression de la vérité ».
Il pose ensuite de manière tout à fait opportune la question de la surabondance d’information, de la distanciation qu’on en subit par rapport aux réalités et aux événements proches, ainsi que de l’atteinte portée à notre sensibilité, qui s’émousse. Et finalement, il pose les questions fondamentales suivantes : que retient-on réellement ? Et à quoi nous servent ces informations, que fait-on réellement ensuite, en termes d’actes ? (ce qui me fait penser étrangement à ce fameux débat au sujet du très court livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous ! : d’un côté, oui il n’a pas tort en tentant d’inciter les gens à sortir de leur léthargie, mais d’un autre il n’est pas certain que sa démarche soit la plus efficace ; s’indigner comment, pourquoi exactement, et surtout en faisant quoi, à part simplement s’indigner de manière stérile, ce que d’aucuns semblent trouver déjà pas mal).
Une parodie de démocratie ?
Tout au plus Postman parodie-t-il notre rôle en le limitant aux bulletins de vote que l’on peut de temps en temps utiliser. Je suis à la fois d’accord sur une partie de ce qui est dit ici mais ne partage pas complètement les analyses pessimistes et restrictives de l’auteur, ce qui mériterait des développements, mais dépasserait le cadre de la synthèse des idées développées par l’écrivain.
Autre reproche à l’auteur : certes, il affirme que la télévision a supplanté le livre et même l’éducation, le déplorant profondément tout en sachant reconnaître aussi les bons côtés de la télévision. Mais lorsqu’il accuse injustement George Orwell de ne pas avoir su anticiper ce que la télévision allait devenir et changer dans nos sociétés, contrairement à la vision huxleyienne, ne peut-on lui rétorquer que lui-même a sous-évalué l’importance qu’allaient revêtir l’internet ou même les jeux vidéo aujourd’hui ? (cet ouvrage est paru aux États-Unis en 1985). Or, il minore d’avance l’importance dont pourra jouer ce média à l’avenir, érigeant la télévision comme le média essentiel cause de tous les vices.
Plus fondamentalement, et l’auteur me semble voir tout à fait juste sur ce point, Neil Postman relève que tous ces modes de transmission modernes ont accru la quantité de choses dont on a entendu parler sans que l’on puisse dire que nous les connaissions. La connaissance est autre chose. Et là encore la surabondance ne favorise sans doute pas la connaissance. Celle-ci peut même devenir La connaissance inutile, pour paraphraser le titre d’un ouvrage de Jean-François Revel que j’ai déjà eu l’occasion de présenter ici.
Pour finir, et cela symbolisera parfaitement bien aussi le contenu essentiel du livre, l’auteur développe une idée qui m’est chère, comme à beaucoup : l’idée que nous sommes davantage dans une société d’émotions plutôt que d’opinions. Et c’est cela qui est dangereux.
Sachant cela, la désinformation règne en maître et les médias comme les politiques savent en jouer, reléguant les grands penseurs ou les analyses de fond au second plan. Ce qui constitue toujours une menace pour la démocratie. Et ce n’est pas la moindre qualité de ce livre que de nous mettre en garde.
— Neil Postdam, Se distraire à en mourir, Nova éditions, septembre 2010, 254 pages.

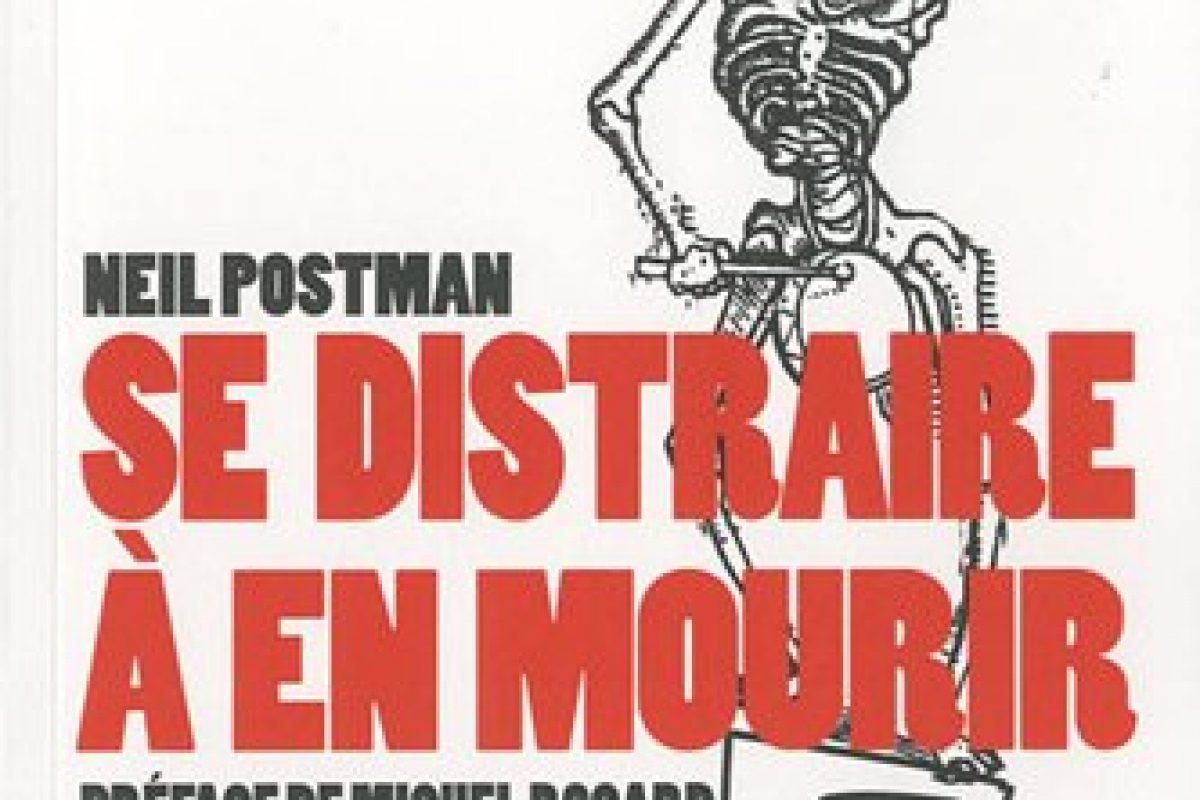


Moi je dirais que nous sommes dans une société du faux, fausses opinions, fausses émotions.
Euh, ben je crois que j’ai pas compris, on s’éclate où dans se livre? On se distrait uniquement avec la télé?
… Ce n’est pas le titre que j’avais choisi. Il semble que la série de trois articles ait été rebaptisée lors de la relecture.
Ah d’accord, ça ne m’a pas empêcher de le lire, peut être est-ce plus en rapport avec le 2 et le 3/3 😉
Je pense que le bonheur est le seul but légitime de l’existence, mais que beaucoup se trompent sur ce qui le leur apporte réellement. Il faut faire un travail sur soi-même pour voir, au-delà de la satisfaction immédiate, ce qui peut rendre heureux sur le long terme.
Prenons mon cas (parce que je le connais bien). J’ai toujours été un grand fan de jeux vidéos. Jeune, j’ai joué des semaines entières, 16 heures par jour, en m’arrêtant seulement pour manger et dormir. Mais j’ai réfléchi, en me disant que cela ne me servirait à rien sur le long terme, et qu’il viendrait forcément un moment ou cela me lasserait. J’ai donc examiné d’autres sources possibles de bonheur :
– luxe : impact négatif. Un bien a pour moi une valeur par son utilité. Je suis aussi heureux dans 25 m2 avec une vieille clio, que dans 300 m2 avec une audi flambant neuve, et le surplus de prix peut être utilisé pour beaucoup d’autres choses.
– connaissance : très efficace. Je sors plus ma carte de bibliothèque que ma carte bleue.
– aider les autres : faire un chèque aux restos du coeur. Pas mal du tout. Valeur bonheur retiré supérieur à l’investissement en argent. A refaire. Le seul problème est qu’on ne sait pas si la personne qui reçoit l’aide est vertueuse ou non, ni si cela lui permet de s’en sortir, ou au contraire de végéter. Bonheur maximal si le bénéficiaire est vertueux et si cela lui permet de mieux réussir dans sa vie.
– voyager : bonheur faible, toujours inférieur au cas précédent. Non rentable.
– défi intellectuel : j’adore un bon casse-tête, ou trouver la solution optimale à un jeu très complexe.
– etc.
Et, après tout ca, j’ai choisi un travail où la connaissance est importante, qui ne me fait pas voyager, qui présente une complexité importante et où le but est d’aider certaines personnes, choisies par moi, à réussir dans leur vie.
Je suis donc devenu expert-comptable. Et depuis onze ans, je n’ai jamais échoué. Aucun de mes clients n’a jamais déposé le bilan, ou n’est parti de mon cabinet. En fait, sans aucune publicité ou capacité en commercial, je gagne exponentiellement plus de clients chaque année. Pourquoi ? Je ne suis pas plus intelligent que les autres. J’adore juste mon travail.
Post inspirant, merci 😉
Cher Jeff, le bonheur est un chemin, à mon sens, donc oui au long terme mais oui aussi au court terme, tout les petits moments de bonheur, simples, jour après jour. Le travail qui devient un jeu, le plaisir pris à travailler, à être avec les autres, à rire, à résoudre des problèmes…Mes clients aiment me regarder travailler, on ne doit pas s’ennuyer avec moi, ça doit être mieux que la télé!
Vous nous parlez de votre projet professionnel, pour moi le professionnel et le familial forme un ensemble et j’ai beau adorer le travail, j’aime autant les personnes avec qui je vis et travaille!
Mais j’aime bien la manière dont vous avez fait votre choix.
PS: une petite partie de LOL, de temps à autres?…
Oh, mais comme je suis d’accord avec vous ! Cela n’empêche en rien les petits bonheurs qui remontent le moral au quotidien, ou une bonne vie de famille, ou quoi que ce soit d’autre ! Je marche aussi à ca, d’ailleurs.
PS : J’aime bien LOL, mais j’ai beaucoup de défauts, dont un temps de réaction incroyablement long, et aucune dextérité manuelle. Me faire traiter d’incapable à longueur de partie m’en a un peu dégouté…
Le bonheur est une doctrine de guillotineurs.