Par Guy Sorman.
L’Europe décline. Çà et là subsistent des enclaves de prospérité relative, en Allemagne, en Suisse, mais ce sont des îlots perdus dans un ensemble orienté à la baisse. Les statistiques font illusion car les taux de croissance globaux affichés ne prennent pas en compte la démographie. Raisonner par nation ne fait donc plus sens, tant les économies sont enchevêtrées : la crise des finances publiques du Sud a fait le bonheur des banques du Nord. Les Européens, s’ils en sont peu conscients, sont interdépendants comme jamais ils ne le furent. Il est superficiel d’accuser tel ou tel gouvernement d’être la cause unique d’un déclin national. Certains furent et restent plus mauvais gestionnaires que d’autres, mais les écarts de gestion n’expliquent pas à eux seuls l’affaissement continental. Le déclin ne se mesure pas aisément : il faudrait disposer d’un indice synthétique qui incorporerait, outre la stagnation, la baisse de l’innovation et le moral des populations. Le propre du déclin est d’être si lent et imperceptible qu’on ne le constate unanimement qu’au terme de sa courbe.
Les Romains qui déclinaient n’en prirent acte qu’après la disparition de leur Empire. Repérer les causes du déclin de l’Europe est aussi complexe que de comprendre celles de l’Empire romain ; le maître du sujet, Edward Gibbon, l’attribua – pour des raisons qui lui étaient personnelles plus qu’historiques – au travail de sape de la nouvelle Église chrétienne : celle-ci aurait détruit l’Empire. En notre temps, au lieu de disputer du caractère nuisible ou salvateur de l’Euro ou des déficits, pourrait-on isoler une cause dominante du déclin européen qui surpasserait les raisons secondaires ? Deux journalistes de l’hebdomadaire britannique The Economist, John Micklethwait et Adrian Wooldridge, nous proposent leur explication et aussi leur solution pour enrayer ce déclin. Il leur paraît (The Fourth revolution, Penguin Press) que, des origines à nos jours, l’Europe est passée par trois Révolutions positives mais qu’elle est en passe de rater la quatrième. La première Révolution a conduit à la constitution des États-nations qui ont résolu la question de la sécurité : à la guerre civile, les États ont substitué une relative paix intérieure, derrière des frontières reconnues. La deuxième Révolution, qui commença au XVIIIe siècle, a fondé la liberté, relative, des citoyens qui ont cessé d’être des sujets pour acquérir des droits. La troisième Révolution, au début du XXe siècle, a instauré une solidarité relative, entre les citoyens.
Nous voici à l’aube d’une quatrième Révolution, à l’état d’esquisse, qui serait la modernisation de l’État. Ces deux auteurs rappellent que, dès les années 1970, les penseurs libéraux avaient attiré l’attention sur l’épuisement de l’État-providence : ses excès n’amélioraient plus la justice sociale et ils étouffaient la créativité économique. Ces intellectuels libéraux ont gagné la bataille des idées, observent John Micklethwait et Adrian Wooldridge, mais ils semblent avoir perdu la bataille politique : même Margaret Thatcher et Ronald Reagan, en leur temps, léguèrent à leurs successeurs un État plus lourd et dépensier que celui dont ils avaient hérité. La quatrième Révolution s’égare en Europe et elle semble en panne aux États-Unis, sans doute parce que ni les citoyens ni les politiciens n’en perçoivent la nécessité immédiate : en démocratie, le court terme gouverne les choix électoraux plus que la réflexion historique. En revanche, certains pays dits “émergents”, Singapour, quelques provinces chinoises, Taïwan, mais aussi la Suède, ont engagé cette quatrième Révolution de l’État, sur un modèle encore expérimental, en améliorant la productivité des services publics et de la fonction publique. La Suède parvient à distinguer radicalement ce que l’État garantit aux citoyens (l’école, la santé) et qui gère ces garanties. Cette distinction entre l’État “garant” et l’État “gérant” me semble la clé de cette quatrième Révolution, la gestion des services publics pouvant parfaitement être assurée par des entreprises privées sur un marché concurrentiel.
Échapper au déclin que nos auteurs attribuent à l’écrasement de la société civile par la bureaucratie, exigerait que nos États rejoignent notre époque : il est étonnant, par exemple, que les rythmes scolaires en Europe restent dictés par celui des saisons, et que les enseignants et les élèves partent encore en vacances au temps des semailles et des moissons. Il est aussi étonnant que l’informatisation et internet ont révolutionné le secteur privé mais que cette productivité nouvelle n’a pas réduit les effectifs des administrations publiques.
On pressent les critiques ! Cette quatrième Révolution est calquée sur la théorie dite néo-libérale. Mais nul n’en propose une autre. Et nul ne conteste que ce discours académique n’a toujours pas été transformé en réformes institutionnelles. L’imperceptible déclin se poursuit donc : il conduit à de périlleuses conséquences qui ne sont pas qu’économiques. À mesure de la paralysie occidentale, les régimes autocratiques paraissent comme plus efficaces – socialement, économiquement, stratégiquement – que la démocratie. Si nos démocraties ne retrouvent pas le chemin de l’efficacité qui passe par la transformation de l’État, nous autres citoyens, nous y perdrons d’abord en pouvoir d’achat, en capacité d’emploi et, à terme, en liberté. Par-delà le débat sur la croissance et l’État, nous courons le risque réel de régresser de l’état de citoyen à celui de sujet de seconde zone. Mais ce pire n’est pas certain.
—
Sur le web.


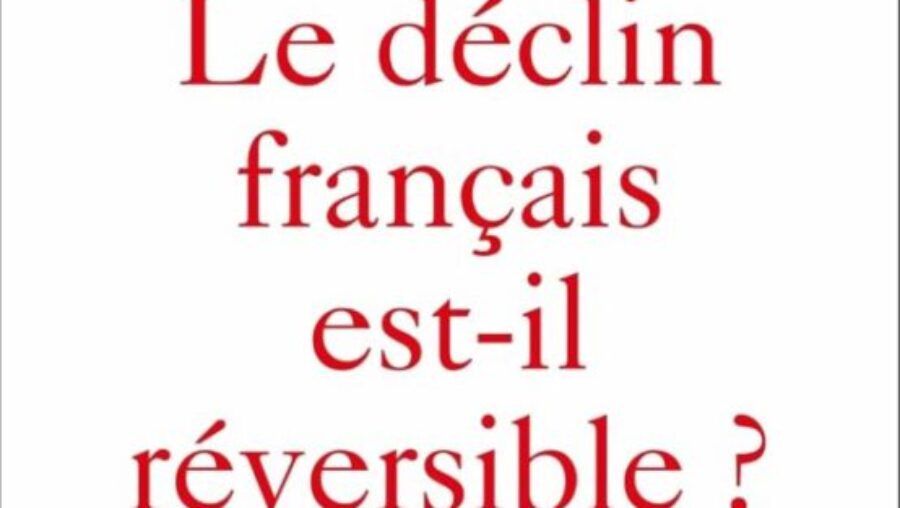
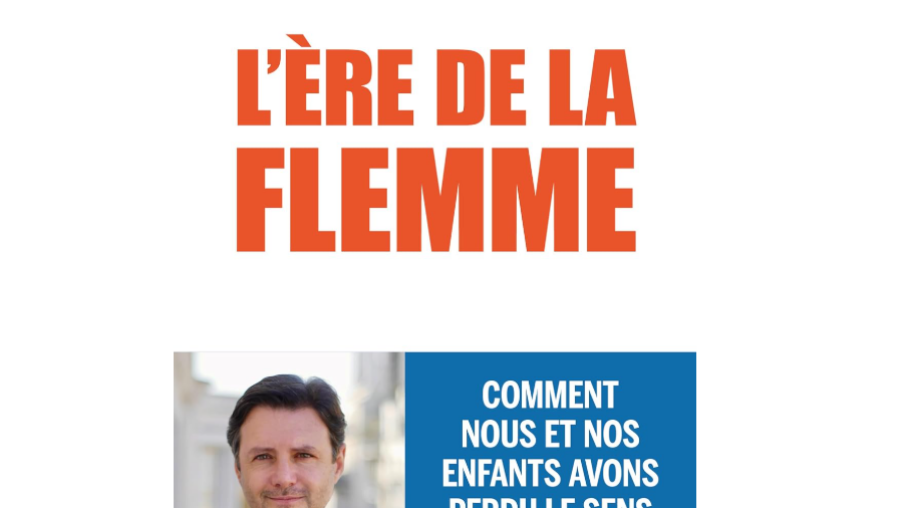

“La troisième Révolution, au début du XXe siècle, a instauré une solidarité relative, entre les citoyens.”
“même Margaret Thatcher et Ronald Reagan, en leur temps, léguèrent à leurs successeurs un État plus lourd et dépensier que celui dont ils avaient hérité”
“Cette quatrième Révolution est calquée sur la théorie dite néo-libérale. Mais nul n’en propose une autre.”
Très partagé sur cet article, sorte d’apologie du socialisme planquée sous un discours vaguement libéral…
Avec ce genre de réflexions m’est avis qu’on est pas sorti de l’auberge.
Pour Thatcher et Reagan, c’est malheureusement vrai. Ils ont freiné la croissance de l’Etat, mais n’ont pas pu la renverser.
Par contre, la première m’a aussi fait grincer des dents.
“les enseignants et les élèves partent encore en vacances au temps des semailles et des moissons”.
En premier, ce qui choque, c’est que le temps de vacances des enseignants, adultes, soit le même que celui des élèves, tous ages confondus. Ce temps supplémentaire, hors cours, pourrait être consacré aux préparation, correction, formation, voire soutien scolaire.
Le temps des semailles et moissons est aussi le temps du soleil, enfin en théorie, et du tourisme, secteur économique très important.
Suppression de l’Éducation Nationale, liberté totale de créer des écoles.
Chaque école aura alors la liberté de décider des dates de congé.
c’est bien la burocratie qui est en train de ronger l’europe :
alors que les états nations avaient relativement réussi à maintenir leurs administration dans un périmètres restreint avec le tryptique communes – département – état , depuis 40 ans, tout les 10 ans, un nouvel échelon administratif apparait sans qu’aucun ne soit enlevé. on administre, on administre … alors que bientot, il n’y aura plus que des chomuers et de la friche à administrer !
la révolution internet a été trés mal accepté dans l’administration car en augmentant la productivité, elle était une grande licencieuse potentielle, et ça, les syndicats ne l’acceptent pas.
s’il y a une période symbolique de l’inquapacité des états occidentaux à se réformer, c’est bien l’automne 95, ou le ” dure ” juppé, rècement élu au suffrage universel , c’est déculoté face à blondel, qui devait bien représenter 1% des citoyens français.
il aurait fallu margaret thatcher ou pire , deng xiao ping …
Je suis d’accord sur la chute. Droit dans ses bottes, il s’est chié dedans !
Pour une fois, monsieur Sorman, votre analyse est totalement juste.
Tant que les gens penseront que la solution est l’état, alors que l’état est le problème, il n’y aura pas d’espoir de stopper le déclin.
Les romains prirent acte de leur déclin bien avant la chute de leur empire.
En réalité ils étaient tellement obsédé par la notion de déclin qu’ils prirent acte de leur déclin… des siècles avant même d’être réellement en déclin.
L’Europe ne décline pas, il faudrait encore qu’elle ait avancé pour celà … Les pays déclinent sous le poids de la corruption d’un pouvoir Européen illégal !