Dans “Le Chien Lodok”, Aleksej Meshkov renouvelle la tradition de l’apologue. Cette fable ludique et angoissante est une image plus que réussie de l’éradication de la singularité individuelle au milieu d’un collectivisme égalisateur.
Par Thierry Guinhut.
 Aleksej Meshkov : sous ce nom à consonance slave, évident pseudonyme, se cache un écrivain italien que l’on dit être né dans les années soixante-dix et qui tient à rester fort discret. Comme sous le pelage du chien Lodok se cache un être humain, décidé à fuir ses congénères. Le thème fantastique de la métamorphose, depuis Ovide jusqu’à Kafka, trouve ici un reprise originale grâce à son alliance avec l’apologue politique.
Aleksej Meshkov : sous ce nom à consonance slave, évident pseudonyme, se cache un écrivain italien que l’on dit être né dans les années soixante-dix et qui tient à rester fort discret. Comme sous le pelage du chien Lodok se cache un être humain, décidé à fuir ses congénères. Le thème fantastique de la métamorphose, depuis Ovide jusqu’à Kafka, trouve ici un reprise originale grâce à son alliance avec l’apologue politique.
On a beau être heureux sous son poil et sous les caresses de son maître, le directeur d’une clinique vétérinaire Lyudov, on n’est guère protégé de l’intrusion de la tyrannie humaine. La ruse qui consiste à devenir animal n’a pas suffi à notre pauvre “renégat du troupeau” pour vivre en paix. Son irréductible différence le fera poursuivre sous toutes ses apparences. Le récit à la première personne, d’abord serein, puis de plus en plus inquiet, rend compte de l’avancée inéluctable de l’organisation du “Zoo”, métaphore du pouvoir totalitaire, décidée à incarcérer dans le rang quiconque ferait mine de s’en écarter : “Quand je suis rentré dans cette fourrure, j’avais d’autres projets. Je croyais qu’un homme travesti en chien serait libre de flairer et de chercher partout, mais je me trompais. Il n’y a plus d’espace pour la liberté dans notre nation.” Ce canidé, très humain en son for intérieur, au point d’éprouver de tendres sentiments envers la belle Véra, dénonçant “les faux idéaux de la meute humaine”, sera finalement encerclé, victime d’un coup monté, puis annihilé. En cette féroce et mordante anti-utopie, reste-t-il quelque part la possibilité d’imaginer, sinon dans une lointaine et inatteignable constellation, la liberté ?
Que l’aventure se passe à Moscou, et convoque des procès absurdes, n’empêche en rien l’universalité du conte et sa charge satirique. À la lisière de Cœur de chien de Boulgakov et de Rhinocéros de Ionesco (car les séides de l’organisation sont coiffés de têtes de rhinocéros), mais aussi de La Ferme des animaux d’Orwell, Aleksej Meshkov renouvelle la tradition de l’apologue. “Je me sers d’animaux pour instruire les hommes”, disait La Fontaine. Cette fable ludique et angoissante, parue chez un éditeur éclectique, fureteur et passionné, est une image plus que réussie de l’éradication de la singularité individuelle au milieu d’un collectivisme égalisateur, ou de tout ordre social passé, contemporain ou à venir.
— Aleksej Meshkov : Le Chien Lodok, traduit de l’italien par Lise Chapuis, L’Arbre vengeur, 192 p, 13 €.
—-
Sur le web.

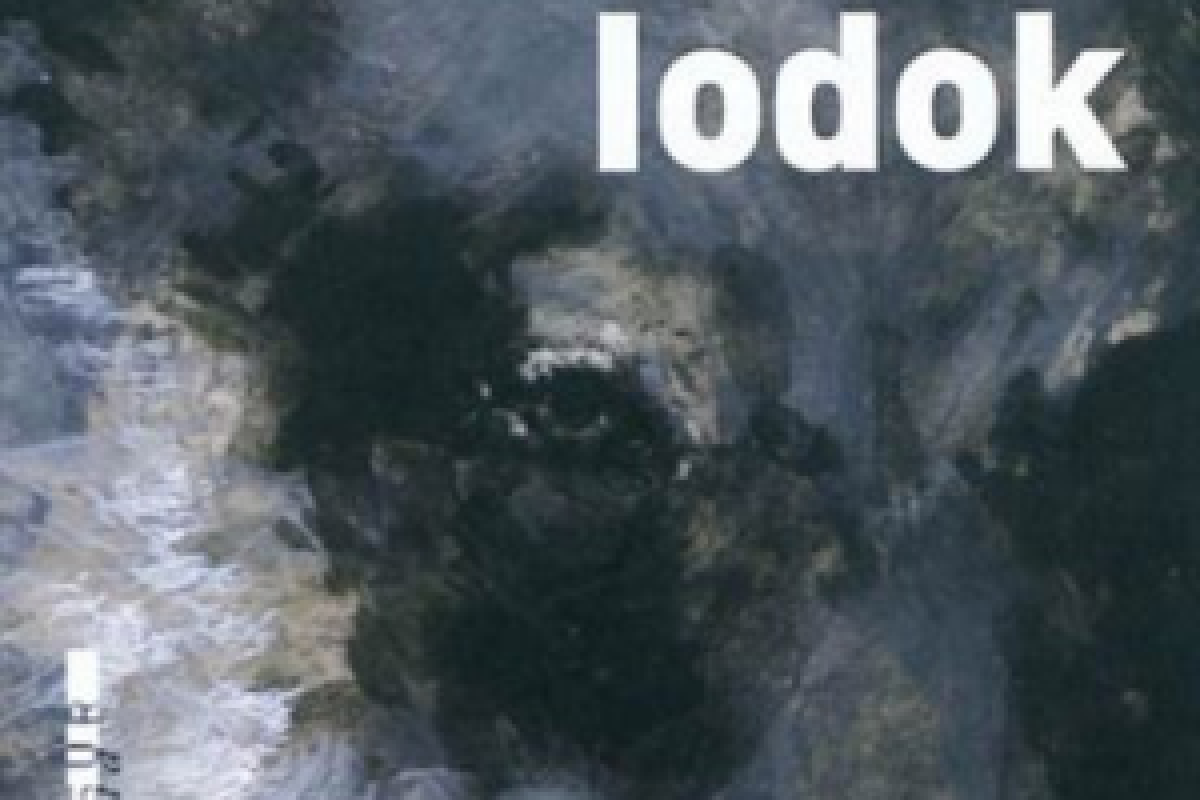
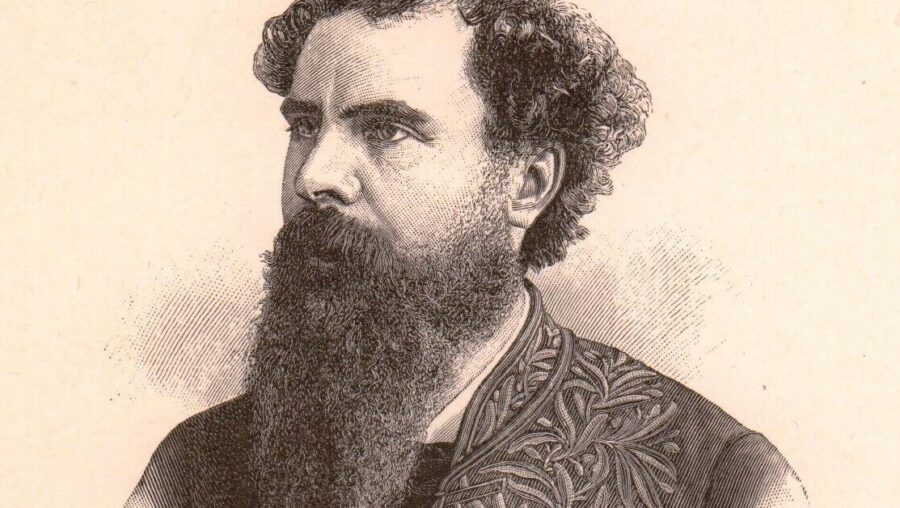


Le Chien Lodok, ou de l’humaine tyrannie: Dans « Le Chien Lodok », Aleksej Meshkov renouvelle la tradition de l’… http://t.co/OK3MDpCZ
Le Chien Lodok, ou de l’humaine tyrannie: Dans « Le Chien Lodok », Aleksej Meshkov renouvelle la tradition de l’… http://t.co/EKhdPJ8o
Le Chien Lodok, ou de l’humaine tyrannie http://t.co/R7vbD5Gc via @Contrepoints
Le Chien Lodok, ou de l’humaine tyrannie: Dans « Le Chien Lodok », Aleksej Meshkov renouvelle la tradition de l’… http://t.co/a9p08SLn