L’hypothèse d’une intervention militaire internationale semble possible, mais aurait-elle du sens dans une situation chaotique comme celle du nord-Mali ?
Par Giuliano Luongo
Publié en collaboration avec UnMondeLibre
Même après l’annulation de l’embargo par la Cedeao et le transfert de pouvoir à Dionocounda Traroré, le Mali se trouve toujours dans un scénario très difficile, vue la situation au nord et la nécessité de restaurer la paix dans la perspective de nouvelles élections. L’hypothèse d’une intervention militaire internationale semble possible, mais aurait-elle du sens dans une situation chaotique comme celle du nord-Mali ?
Les séparatistes… séparés
La situation du nord Mali est d’une lecture difficile, avec deux forces séparatistes, le MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad) et le mouvement salafiste d’Ansar Dine. Ces deux factions ont été alliées jusqu’à la déclaration d’indépendance, mais n’ont pas exactement de bons rapports.
Il faut donc rappeler « qui est qui ». Le MNLA est un mouvement de formation relativement récente, fondé à novembre 2010 et réunissant différent groupes touaregs [1] et se définissant au moment de sa naissance comme [2] “une organisation politique de l’Azawad qui défend et valorise la politique pacifique pour atteindre les objectifs légitimes pour recouvrer tous les droits historiques spoliés du peuple de l’Azawad”. Probablement insatisfait des résultats d’une politique pacifique, le mouvement a commencé la lutte armée en janvier 2012 : la capture de la ville de Ménaka à été le premier fait d’armes significatif, suivi de nombreuses victoires et l’arrivée à Tombouctou le 1er avril dernier.
Leur idéologie est simple et directe : ils veulent la libération de leur territoire, pour sortir de “l’anarchie” et former des nouvelles institutions démocratiques, en respectant les anciennes frontières coloniales. Leur porte-parole Moussa Ag Attaher a encore affirmé cette position au moment de leur déclaration d’indépendance du 6 avril – que personne dans le monde n’a acceptée comme légitime. Mais ils n’ont pas mis la religion en haut de leurs priorités, et c’est ici qu’entrent en jeu leurs (ex) alliés, les salafistes d’Ansar Dine.
Sans eux, le MNLA n’aurait pas connu un succès si rapide. Mais aujourd’hui il est clair que les salafistes ont simplement profité de la “charge des touaregs” pour gagner en pouvoir. Il faut rappeler qu’Ansar Dine, à coté de sa matrice salafiste, est très près de l’Aqmi, la frange du Maghreb d’Al-Qaïda. Officiellement actif depuis mars 2012 et mené par l’ex-militant touareg des révoltes des années 90 Iyad Ag Ghaly, Ansar Dine a été connu du grand public grâce à son soutien au MNLA : mais très tôt les rapports de force ont changé, les salafistes se substituant rapidement au MNLA dans le contrôle des villes principales. Les salafistes n’ont pas démenti leur réputation, en imposant déjà leur version extrémiste de la charia dans les zones occupées.
La fracture définitive entre les deux factions a été confirmé par le porte-parole du MNLA, disant que son mouvement a l’intention de travailler avec le gouvernement pour supprimer la menace salafiste et défendre ses gens. De leurs coté, les salafistes se sont déclarés “sans soucis particuliers” contre le MNLA, mais ils soutiennent aussi que “Ansar Dine ne connait que le Mali [pas divisé, NdR] et la charia”.
Le gouvernement du Mali se trouve donc à affronter des séparatistes s’opposant aux extrémismes et des extrémistes unitaristes mais heureux d’imposer leur régime au pays. Et dans ce scénario, il ne faut aussi oublier la crise humanitaire, avec l’UNHCR qui compte au 4 avril déjà plus de 200.000 réfugiés échappés au Burkina Faso et à la Mauritanie.
Enfin, il faut rappeler la détection au 10 avril d’activités de la secte Boko Haram au nord du pays, souligné par le député du Nord Abdou Sidibé : une source sécuritaire malienne confirme “plus de 100” terroristes actifs déjà depuis l’attaque au consulat algérien du 5 avril [3].
Quelle réponse militaire ? Contre qui ?
Sur ces bases, on comprend les préoccupations du gouvernement malien et de la Cedeao, mais comment ramener la paix au Mali ?
Les autres pays africains veulent que le Mali reste uni sous le contrôle du gouvernement essentiellement pour deux raisons : il faut éviter que le pays ne se transforme en un “centre islamique extrémiste” – qui ouvrirait la porte à l’expansion du terrorisme et à la déstabilisation de la région – et il faut éviter aussi qu’une hypothétique victoire permanente des touaregs “inspire” des velléités séparatistes similaires dans les pays limitrophes.
La Cedeao a déjà déclaré avoir mis en stand-by une force d’interposition de 2000 ou 3000 soldats environ. Les pays frontaliers maintiennent des positions mixtes : l’Algérie défend “l’intégrité” territoriale du Mali mais pousse pour une solution principalement politique, tandis que le Niger se déclare favorable à une intervention militaire [4] – de toute façon, la séquestration des diplomates algériens par un commando extrémistes de l’Aqmi hors contrôle sur le territoire malien ne peut que contribuer à augmenter la tension envers les séparatistes. L’activité de Boko Haram est un nouvel élément d’instabilité : connaissant les risques dérivants de la présence de cette organisation, les autorités pourront se sentir encore plus poussées à utiliser la force.
Il faudra donc voir quelle faction deviendra la cible principale de cette opération militaire (à coté des ses modalités et règles d’engagement, pas encore claires), et quelles seront les nouvelles alliances au sein du territoire du Mali. Le scenario du pire se concrétiserait dans un conflit à trois, dans lequel le gouvernement chercherait de reprendre le nord Mali en traitant MNLA et Ansar Dine comme le même ennemi, en créant les conditions pour un chaos majeur et de possibles représailles sur les populations civiles. Vu que le vrai élément d’instabilité se concrétise dans la présence d’Ansar Dine, le “bon sens” suggérerait de former une alliance entre les forces “démocratiques” (autorités et MNLA) pour interdire aux salafistes de renforcer leur pouvoir sur le territoire, et utiliser cette entente momentanée pour construire les bases de négociations sur le futur du nord Mali.
Les autorités et les touaregs doivent accepter ce défi : très difficile, sans doute, vu les événements récents et lointains, mais à tenter – aussi avec la communauté internationale, qui doit comprendre que son soutien doit s’étendre au cadre politique et ne pas se limiter au cadre militaire. Une intervention ne se peut se limiter à ce domaine : en suivant cette route, les autorités et la Cedeao risquent de donner raison aux analystes et aux simples observateurs selon qui le Mali pourrait devenir un nouvel Afghanistan.
—-
Sur le web.
Notes :
- Il y a des membres du Mouvement Touareg du Nord Mali, ex-combattants touaregs libyens (alliés avec les rebelles et la Jamahiriya aussi) plus des ex-membres des vieux mouvements pour la libération de l’Azawad, actifs dans les années 90 entre 2006 et 2009. ↩
- Cfr. http://www.tunisie-berbere.com/d%C3%A9claration-fondatrice-mouvement-national-de-l%E2%80%99azawad-300-111110.html ↩
- http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120410090958/mali-enlevement-aqmi-cedeaomali-investiture-de-dioncounda-traore-attendue-boko-haram-au-nord.html ↩
- http://www.algeria-isp.com/actualites/politique-algerie/201204-A9880/algerie-different-algero-nigerien-sur-liberation-nord-mali-des-combattants.html ↩



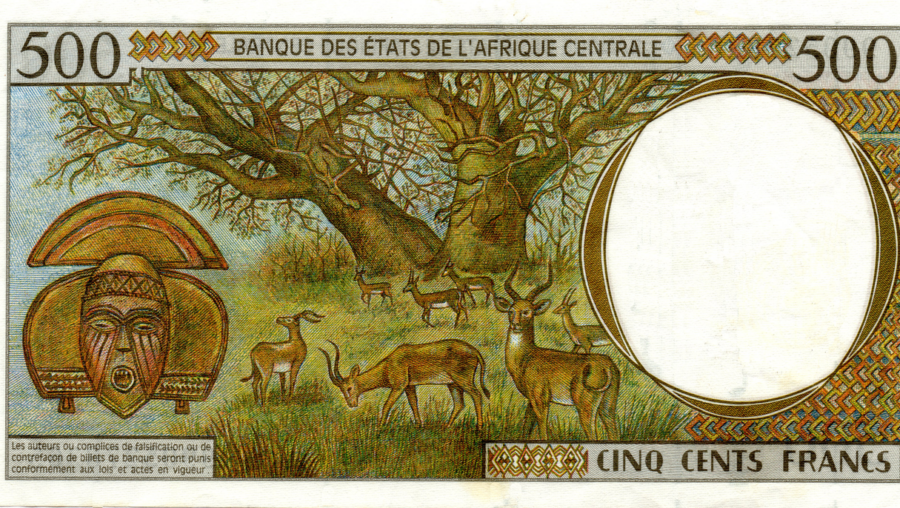

A lire : Quelle voie de sortie au Mali ? – L’hypothèse d’une intervention militaire internationale semble possible, … http://t.co/ZyPmDn3b