Le lien peut-être le moins connu et le plus important pour les sciences humaines est celui qui unit la philosophie de Husserl et les économistes “autrichiens”, principalement Mises et Hayek. On trouve au cœur de leur théorie la même idée de l’articulation entre actions personnelles et phénomènes sociaux.
Un article de l’aleps
 Bien que le mot phénoménologie soit plus ancien, et bien que sa philosophie ait été fortement influencée par son maître Franz Brentano, on attribue habituellement à Husserl la paternité de la philosophie phénoménologique.
Bien que le mot phénoménologie soit plus ancien, et bien que sa philosophie ait été fortement influencée par son maître Franz Brentano, on attribue habituellement à Husserl la paternité de la philosophie phénoménologique.
Mais en quoi consiste-t-elle ? Elle est la prise en compte de l’expérience vécue par les individus dans leur recherche de la vérité scientifique. La question de la vérité scientifique avait déjà hanté l’esprit de Descartes, et de ce point de vue Husserl est cartésien : le projet du philosophe est de comprendre l’homme et le monde. Mais, comme Kant, il doute que la solution soit dans le rationalisme cartésien. Dans la lignée de Kant et surtout de St Thomas d’Aquin, Husserl cherche la solution dans le vécu, dans l’expérience qui sollicite la conscience personnelle. Donc il n’y a rien de figé dans la science. Elle s’aperçoit et s’affirme parce que l’homme a conscience de l’expérience qu’il vit. C’est cette conscience qui donne un sens à la réalité observée. Et donner un sens est le propre de l’homme, en quête permanente de vérité.
La théorie de la connaissance
Le message de Husserl a été bien reçu en début de ce vingtième siècle qui traverse une crise de conscience : où nous mène la science ? Y a-t-il seulement une science ? Y a-t-il une vérité ?
Bien que novateur, Husserl n’est pas un révolutionnaire. Pour lui, le progrès de la connaissance est le fruit d’une dynamique, mais les leçons du passé ne sont pas perdues : ce sont des sédiments successifs qui nous permettent d’aller plus loin. La connaissance est donc tension, elle est dans l’être humain (esprit et corps mêlés dans la conscience), et elle est finalement subjective, puisque la conscience s’applique à des vécus personnels. Ici, une différence importante se produira dans la pensée phénoménologique entre Husserl et son disciple Max Scheler. Husserl nous propose un être humain en quête de la vérité, de la connaissance. Scheler pense que la tension de l’être humain est vers le bien, donnant ainsi le départ à une phénoménologie éthique qui inspirera des philosophes comme les personnalistes (Mounier et la revue Esprit), ou les néo-thomistes comme Karol Wojtila (Jean Paul II), Maritain ou Levinas.
Subjectivisme ou Objectivisme ?
La difficulté de l’approche phénoménologique est de comprendre comment la conscience individuelle, sollicitée par des expériences personnelles, peut déboucher sur une connaissance à vocation universelle au point d’être scientifique. Husserl, à la différence du thomisme, ne donne pas une réponse ontologique : la vérité n’est pas un appel à l’au-delà, elle n’est ni éclairée ni guidée par une volonté divine. Mais elle est transcendantale, elle débouche sur un savoir collectif qui échappe à ceux qui l’ont forgé. C’est sa résistance au test permanent de l’expérience qui permet de considérer la vérité comme objective, en dépit de sa source subjective.
Les thomistes ont du mal à l’admettre, et estiment que la subjectivité de Husserl est trop radicale, et conduit en fait au relativisme, qui exclut donc toute vérité, puisque si toutes les vérités sont bonnes, il n’y a pas de vérité.
La nécessaire dispersion du savoir
Beaucoup de philosophes du XXème siècle emprunteront à Husserl, sans partager pour autant l’approche de la phénoménologie : de Heidegger à Derrida ou Sartre. Pourtant le lien peut-être le moins connu et le plus important pour les sciences humaines est celui qui unit la philosophie de Husserl et les économistes « autrichiens », principalement Mises et Hayek.
On trouve au cœur de leur théorie la même idée de l’articulation entre actions personnelles et phénomènes sociaux : les phénomènes sociaux sont « le résultat non désiré (undesigned) de l’action volontaire des hommes » (L. von Mises). De même, le progrès naît-il d’un processus d’essais et d’erreurs ; l’histoire ne se renouvelle pas, puisqu’elle est écrite par des hommes qui ont eux-mêmes leur propre histoire, fruit des expériences qu’ils ont vécues.
Le savoir concret n’existe qu’à travers la forme […]dans laquelle il apparaît dans un grand nombre d’esprits, et la dispersion et l’imperfection de tout savoir [sont les deux bases] des sciences sociales.
— Hayek.
—-
Sur le web

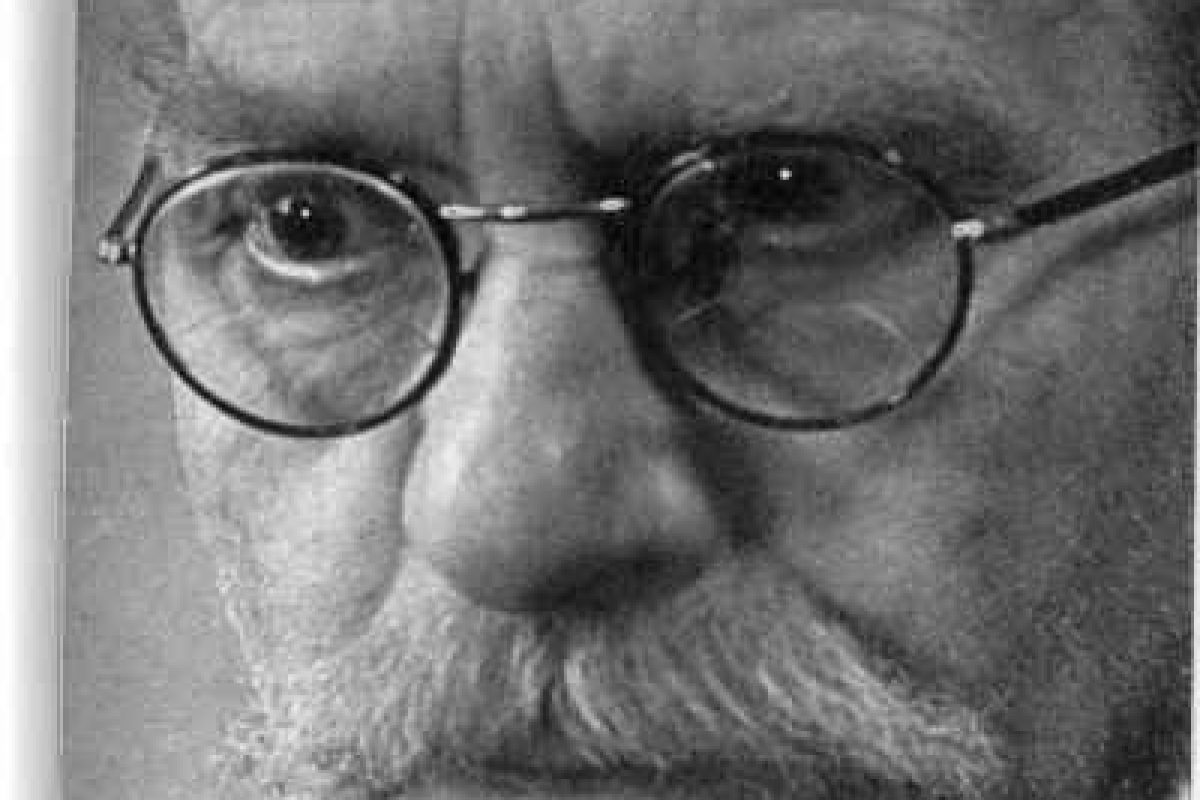

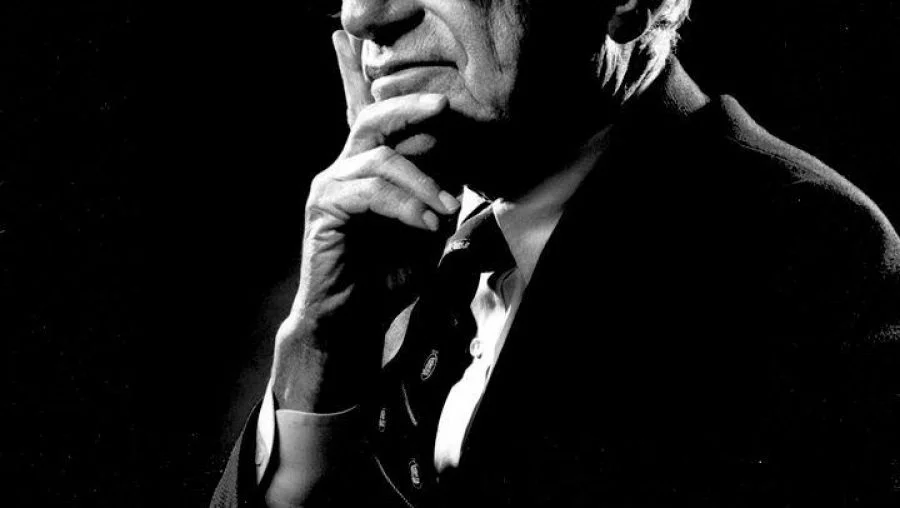

RT @Contrepoints: Edmund Husserl et la phénoménologie: http://t.co/FJiT7xht
Edmund Husserl et la phénoménologie http://t.co/CUsfwqMZ
Bonjour,
Cet article est affligeant de bout. Il ne comprend manifestement rien à la phénoménologie et commet des erreurs que ne feraient pas un étudiant en DEUG. Je ne sais plus comment je suis tombé dessus mais j’espère bien ne jamais recroiser le chemin de cet auteur, s’il est vrai que “mal parler fait du mal aux âmes”.
Bien cordialement,
TP
Et voila qu’en plus on ne peut pas corriger ses posts. Merci de rectifier “de bout en bout” et “ferait”.
“le progrès naît d’un processus d’essais et d’erreurs ; l’histoire ne se renouvelle pas” http://t.co/NX9aF2Ky #philo #Husserl
“le progrès naît d’un processus d’essais et d’erreurs ; l’histoire ne se renouvelle pas” http://t.co/SYHprIOf #philo #Husserl
RT @Johnny_Picknell: Edmund Husserl et la phénoménologie : http://t.co/bMOUoWIT