On est avec Pascal aux antipodes de la raison absolue cartésienne, dans la mesure où il condamne par avance la philosophie des Lumières.
Un article de l’aleps
 On s’accorde à comparer le génie de Pascal (1623-1662) à celui de Leonard de Vinci. Physicien (lois de la pression atmosphérique), mécanicien (peut-être le premier ordinateur mécanique), et surtout mathématicien (participant au développement de la théorie des probabilités et des jeux, où s’illustrent à la même période Fermat, Bernoulli et Thomas Bayes).
On s’accorde à comparer le génie de Pascal (1623-1662) à celui de Leonard de Vinci. Physicien (lois de la pression atmosphérique), mécanicien (peut-être le premier ordinateur mécanique), et surtout mathématicien (participant au développement de la théorie des probabilités et des jeux, où s’illustrent à la même période Fermat, Bernoulli et Thomas Bayes).
Mais il n’était ni peintre ni sculpteur. Son talent artistique à lui, ce sera la théologie, à laquelle il consacrera la deuxième moitié de sa vie, ayant sans doute fait le tour des connaissances scientifiques de son temps. Il associe alors « l’esprit de géométrie » qui règne dans la science, à base d’ordre et d’organisation, et « l’esprit de finesse » qui fait appel à la fois au cœur et aux sens. C’est dire qu’il refuse le « dualisme » de Descartes, qu’il n’aime pas et dont il n’accepte pas le primat de la raison.
Foi et raison : la recherche de la vérité
« Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison. »
Descartes pensait que l’Homme est capable par la raison d’accéder à la vérité infinie, et de découvrir Dieu.
« Orgueil », dit Pascal : notre raison nous commande de rechercher Dieu, mais non pas de le comprendre. L’Homme dispose d’une raison limitée et doit s’accommoder de l’incertain.
Tel est le sens du fameux pari de Pascal : on ne risque rien à croire en Dieu, alors que l’on risque à rester dans l’impiété car on se condamne alors à vivre dans un état de misère. Le sort de l’Homme, c’est la connaissance limitée. Mais en même temps, il est en recherche de vérité absolue.
Cette démarche, dite des « contraires », est caractéristique de la pensée de Pascal : c’est au milieu de deux contraires que se trouve la vérité. Ainsi l’Homme est-il à la fois crédule et incrédule, timide et téméraire, vaniteux et modeste, etc. L’anthropologie de Pascal se situe ainsi au confluent du pessimisme de Hobbes (l’homme condamné à la peur et à la violence) et de l’optimisme de Locke (l’homme à la recherche de la concorde et de l’harmonie).
La connaissance résulte de l’étude de ces contraires.
« La connaissance de Dieu sans celle de notre misère nous pousserait à l’orgueil, et la connaissance de notre misère sans celle de Dieu nous conduirait au désespoir. »
L’homme est-il libre ?
Si la recherche de Dieu et de la vérité procède à la fois de la raison et de la révélation, l’Homme est-il assez raisonnable pour accepter la révélation ?
Pascal est janséniste, et la doctrine de Jansen est au catholicisme ce que celle de Calvin est au protestantisme : c’est Dieu lui-même qui fait aux Hommes la grâce de les mettre sur le chemin de la vérité. À la différence de ce que professent les jésuites, adversaires des jansénistes, la liberté ne réside pas dans le choix individuel et volontaire du bien (Molina), mais dans la grâce de Dieu, qui appelle personnellement chaque individu vers le bien, libre à chacun de choisir le mal.
On trouve ici l’écho de saint Augustin avec l’idée de la « grâce efficace ». La liberté individuelle est celle de pêcher, et seule la grâce divine peut remettre l’individu dans le chemin de Dieu. Voltaire dira à ce propos que Pascal est un « misanthrope sublime » : ce que l’Homme peut faire de bien, il le doit à la seule grâce de Dieu.
On est ainsi avec Pascal aux antipodes de la raison absolue cartésienne, et il condamne par avance la philosophie des Lumières :
« Toutes vos lumières ne peuvent arriver qu’à connaître que ce n’est pas en vous-même que vous trouverez ni la vérité ni le bien ».
La misère d’une humanité déchue
Pascal évoque souvent « notre misère », héritée du péché originel, et ne voit de salut pour l’Homme que dans l’amour infini que porte Dieu à ses créatures élues. Par là même, il tourne le dos à l’humanisme qui depuis le Moyen Âge a dominé la pensée chrétienne, notamment à travers saint Thomas d’Aquin.
Sans doute Pascal peut-il faire partager sa conception de l’Homme à des personnes animées d’une foi intense – des élus de Dieu, si on comprend bien. Mais il écarte du chemin du salut tous ceux qui pensent que l’Homme, créé à l’image de Dieu, peut s’en rapprocher en faisant usage de sa liberté pour créer, servir et aimer. Si la vision pascalienne est bien celle d’un Homme soumis et médiocre, qui ne pourrait se grandir que par l’obéissance et le mysticisme, elle peut paraître décalée à la veille d’un siècle de révolutions politiques et économiques.
—-
Sur le web



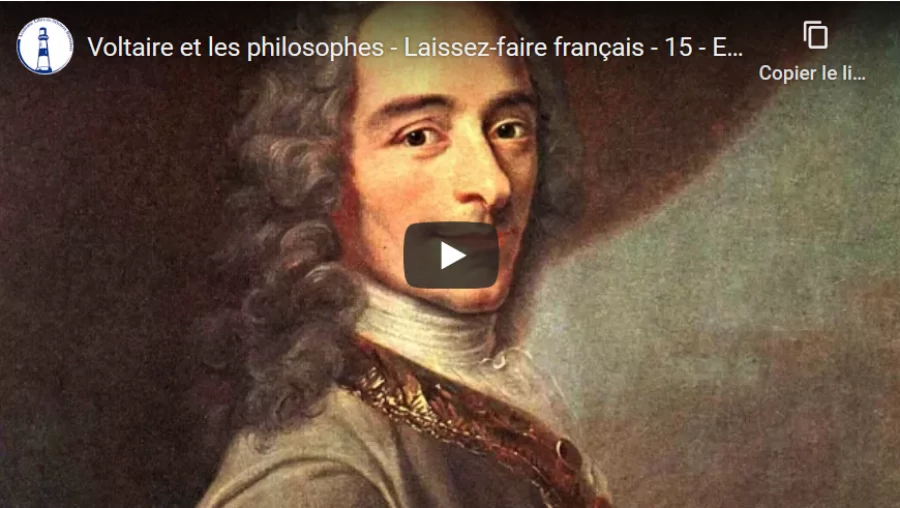

On peut gloser à propos de théologie concernant Pascal…
Il était aussi un des derniers mathématiciens dont les travaux sont accessibles aux profanes.
Et sa biographie personnelle est interressante (accident de la route, rencontre désicive avec deux médecins qui semblent avoir décuplé la ferveur de sa foi) pour qui veut se donner la peine de la resituer dans le contexte de l’époque (dernières épidémies de pestes).
Maintenant, peut être faut il d’autres modèles mathématiques et autre que ceux de B.Pascal pour construire la société.
Cependant, je ne connais pas d’esprit universel comme il le fut, capable d’exposer sa théorie aussi bien en mathématiques, qu’en prose, et de rester accessible au plus grand nombre d’hommes instruits.
Il a inventé machines a calculer, étudié de facon exhaustive le son (une onde comme la lumière, mais aussi une variation de pression, c’est d’ailleurs ce qui fait la différence entre le mot écrit et oral …), a été pionnier dans la formalisation des suites et des phénomènes de récurrences qui restent des piliers des théories les plus modernes (probabilités, chaos, etc…)
Aujourd’hui il faudrait trois bonshommes ( spécialistes), un pour les maths un pour le discours, et un pour les mises à jours/actualisations.
M’enfin peut être que finalement c’est comme aux échecs, l’ordinateur bat l’humain, et peut être qu’un jour un programme générant des discours en prose aléatoire pondra des vérités plus utiles aux hommes que les Pensées de Pascal, Mais même dans ce cas il aurait encore raison, lui qui affirmait
“Ils ont compris que le vrai bien devait être tel que tous pussent le posséder à la fois, sans diminution et sans envie, et que personne ne le put perdre contre son gré. Et leur raison est que ce désir étant naturel à l’homme, puisqu’il est nécessairement dans tous, et qu’il ne peut pas ne le pas avoir, ils en concluent.”
B.Pascal était un personnage austère, et qui recommandait une morale de vie sans doute trop encline à la pénitence pour des esprits contemporains.
Il a néammoins une facon singulière de manier la langue française, une façon franche, sans ambivalence ni faux semblants, il invite comme peu d’écrivain savent le faire à prendre position, et c’est peut être cela qui pose problème à notre époque, prendre position est il compatible avec la liberté ?
Sans doute que B.Pascal ne s’était pas embarassé de ce dilemme cornélien, sous couvert de théologie de la grâce. Après tout comme le disait un poète du XX siècle (Claude Gavreau)
Drozolmazdrozolzomoni
La liberté est une chienne qu’on attrape par les nichons
C’est l’opinion d’un songeur fatigué
La liberté est le bien
Le positif
Le définitif
Le certain
L’inchangeable
Le bon
Il faut
Les épaves je les regarde.
Théologie ou poésie, Pascal peut être démodé, mais si un jour une machine discoure mieux qu’un être de chair, alors il aura eu raison dans le fond de son obscurantisme mystique et si ce n’est pas le cas il aura su mieux qu’un autre faire discuter les hommes sur les problèmes de son temps plus ou moins révolu ….
La lecture de B.Pascal garde donc un interet ontologique.
Concernant une critique moderne des positions philosophiques de Descartes ou Pascal, il faut lire Maurice Merleau Ponty qui aborde cela sous l’aspect de la phénoménologie et des sens/perception, il n’enferme pas le problème de l’intelligibilité du monde dans ou en dehors du corps humain, ni même dans un langage préexistant, mais dans le fonctionnement brut du phénomène de perception, avant toutes étapes de traitement secondaire.
M.M.Ponty dans “L’union de l’ame et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson”.
“Le sujet cartésien ne peut viser un objet ouvert, c’est à dire inépuisable. En passant à la réflexion cartésienne, on perd l’objet ouvert et inachevé. Descartes répondra évidement que cet objet ouvert et inadéquat. Mais nous cherchons à voir de quoi on se prive en adoptant l’attitude décisive de la réflexion.Les sens, ce serait cette pensée non en possession de son objet, cette pensée non totalisable.
A quelle position se rallier ? L’Onus Probandi incombe plutot ici à l’entendement puisque toute l’histoire du savoir depuis Descartes nous montre peut être qu’il n’y a pas d’idée adéquates. Une analyse serait possible, qui définirait la pensée, non par la plénitude de sa saisie de l’objet, mais par cette sorte d’arret d’activité de l’esprit qui constitue des certitudes dont on sait qu’elles seront à reviser, mais qui ne sont pas rien.
Il faudrait introduire dès le principe une inadéquation de la pensée à soi même, sans laquelle on ne peut comprendre l’erreur, l’illusion, l’historicité du savoir.
De même il faut reconnaitre dès l’origine un principe de passivité dans la liberté, sinon on ne comprendra pas les difficultés de la liberté, ni qu’elle puisse être sollicitée.”
La pensée libérale en politique au fond, sait solliciter la liberté, mais a du mal à s’accommoder de cet hypothétique principe de passivité au sein de la liberté, principe qui n’est en soit que philosophique mais non démenti par ailleurs.
La faute sans doute à une vision trop restrictive de la définition des objets selon Descartes, d’ou des libertés inadéquates nécessairement ou fatalement c’est selon votre humeur du jour …
Bien sur la philosophie de M.M.Ponty est inadéquate aussi, l’histoire de la main droite qui touche la main gauche, qui d’objet touché devient objet touchant à un petit coté onaniste, mais cela vient rappeler que parler de liberté c’est aussi parler du corps humain dans sa grandeur (“on a marché sur la lune”) et dans sa misère (cf Pascal “que l’homme sans la foi ne peut connaitre le vrai bien”).
on apprend des choses importants concernant la pensée pascalienne. Il n’en demeurre pas moins que dans la demarche scientifique,la foi comme outil d’analyse n’est pas omise.