Qu’est-ce que l’homme ? – Qu’est ce que le Droit naturel ? – La vie en société fonde-t-elle des droits innés ? – Comment passe-t-on de la prédation à l’échange ? – Quels sont les principes d’un droit humain ? – Qu’est ce qu’une économie de services mutuels ?
 Cette idée fausse relève du « romantisme de la brutalité ». Faire la guerre, c’est prétendre imposer à l’adversaire le choix entre asservissement et destruction. Concurrence et compétition ont au contraire, sur un marché où la contrainte n’intervient pas, des conséquences bienfaisantes : les rivalités aboutissent à des méthodes de production améliorées, et à une liberté accrue tant pour les consommateurs que pour les salariés. Comme toute activité humaine, l’économie comporte des éléments passionnels, liés à la vanité, au goût de l’ascendant, à la jalousie, mais ces éléments sont moins nocifs en économie que dans tous les autres domaines. En effet, les données objectives y sont chiffrables, et les alternatives de solution nombreuses.
Cette idée fausse relève du « romantisme de la brutalité ». Faire la guerre, c’est prétendre imposer à l’adversaire le choix entre asservissement et destruction. Concurrence et compétition ont au contraire, sur un marché où la contrainte n’intervient pas, des conséquences bienfaisantes : les rivalités aboutissent à des méthodes de production améliorées, et à une liberté accrue tant pour les consommateurs que pour les salariés. Comme toute activité humaine, l’économie comporte des éléments passionnels, liés à la vanité, au goût de l’ascendant, à la jalousie, mais ces éléments sont moins nocifs en économie que dans tous les autres domaines. En effet, les données objectives y sont chiffrables, et les alternatives de solution nombreuses.
Les intérêts sont aussi divers que les hommes, c’est pourquoi les objectifs sont souvent complémentaires, et les oppositions rarement irréductibles. Cette complémentarité est le facteur d’intégration des unités économiques où s’organise la collaboration. La diversité mouvante des objectifs particuliers parvient à un degré élevé d’harmonisation au moyen de la liberté des échanges. Le caractère commun à la collaboration d’une part, et aux échanges d’autre part, réside dans leur principe contractuel. Le réseau de ces transactions n’a pas de frontières. C’est lui qui constitue le milieu économique.
Une économie de libres transactions n’est pas anarchique puisque, précisément, l’anarchie est marquée par l’absence d’ordre économique. Or cet ordre s’édifie sur deux structures spontanées : le commandement à l’intérieur des unités économiques et l’observation de règles de conduite dans le milieu économique.
Le commandement est nécessaire pour atteindre rationnellement à travers la spécialisation des tâches, un objectif de production dont on se partage le fruit. La règle de conduite fondamentale du milieu économique réside dans le respect des engagements pris. Elle est indispensable à un niveau satisfaisant de confiance mutuelle soit pour collaborer à la réalisation d’un objectif commun, soit pour échanger si les objectifs sont différents.
L’étymologie grecque du mot économie, qui repose sur oikos (la maison) et sur nomos (la règle) évoque la « tenue du ménage » autrement dit, l’art de régler l’activité de la famille de sorte que ses ressources suffisent à ses besoins. Mais, à quelque stade de complexité que ce soit, l’essence de l’activité économique consiste toujours à opérer un double choix, dans l’ordre des priorités quant aux besoins à satisfaire et dans celui de l’affectation des ressources (les biens du groupe et les services de ses membres) selon leur rareté et selon leur efficacité.
À l’intérieur de l’entreprise, il ne s’agit pas d’un pouvoir, mais d’une fonction de responsabilité : choisir pour l’avantage de l’unité de production. La responsabilité de ces choix incombe forcément, en dernier ressort, à un seul individu : patron pêcheur, gérant de coopérative, intendant de domaine agricole, chef d’entreprise industrielle ou commerciale…
Lorsque l’exclusion de la contrainte est assurée par les institutions politiques, il est nécessaire d’établir par accord mutuel, tant le commandement à l’intérieur de l’unité économique, que la contrepartie des services demandés à l’extérieur. C’est ce qui rend la hiérarchie interne pleinement compatible avec le principe de liberté du milieu économique.
(À suivre : L’homme est il captif des phénomènes économiques ?)

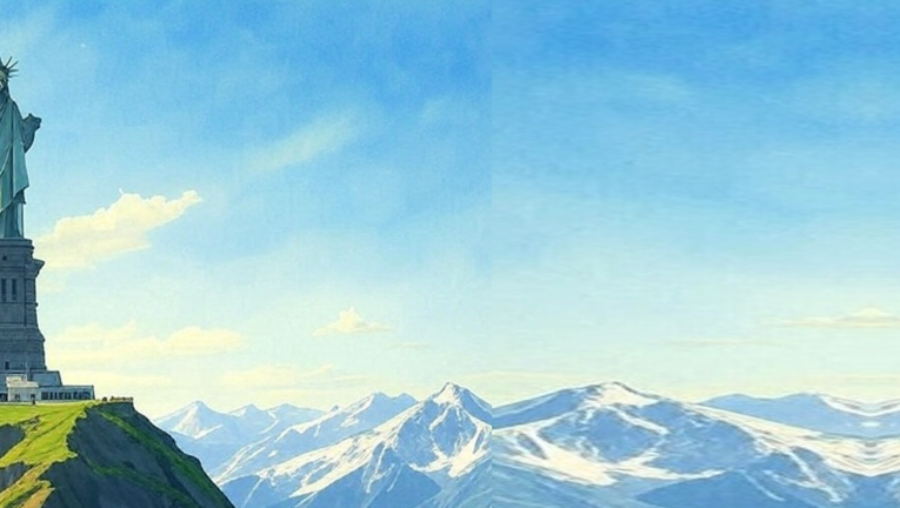


La compétition sur le marché est un formidable moteur de l’innovation, néanmoins je pense qu’il ne faut pas présenter que cet aspect, car le libre marché, c’est d’abord une coopération volontaire entre de nombreux acteurs (“cooperation without coercion” comme disait Milton Friedman).
Merci Raoul pour cet article très intéressant et vraiment bien détaillé. Je reste toutefois d’accord avec leonidas qu’il y a que cet aspect à voir.