Par Pascal Salin.

Une société libre est une société où tout individu a le droit d’agir comme il l’entend, sans subir aucune contrainte, à condition qu’il respecte les droits légitimes des autres. C’est dire qu’une société libre est fondée sur la reconnaissance et la défense des droits de propriété. Ces principes sont-ils utiles pour définir une politique d’immigration ? Bien entendu et c’est même parce qu’ils ont été oubliés qu’il existe un grave problème d’immigration.
Dans ce domaine comme dans les autres, la véritable vision libérale consiste à rechercher les conséquences logiques des principes au lieu de vouloir agir directement sur les résultats d’une situation donnée. Mais encore faut-il que les principes soient correctement compris et les concepts soigneusement définis.
La liberté d’immigrer, un droit fondamental
Le point de départ d’une réflexion libérale sur l’immigration consiste à reconnaître la liberté d’émigrer et la liberté d’immigrer comme un droit de l’Homme fondamental. Comment pourrait-on défendre le libre-échange, c’est-à-dire la libre circulation des marchandises et s’opposer par la force au libre mouvement des hommes ? Ainsi, les barrières à l’entrée dans un pays – les interdictions d’entrée, les quotas d’immigration, ou même la simple obligation de détenir un passeport et un visa – constituent une atteinte aux droits légitimes des gens.
Par conséquent, aucun argument ne peut permettre de justifier les politiques d’immigration pas plus, bien sûr, que les politiques de limitation de l’émigration mises en place par tant de régimes totalitaires. La meilleure politique d’immigration consiste donc à ne pas en avoir.
Mais, dira-t-on, si l’on renonçait à toute politique d’immigration, si l’on supprimait tout contrôle aux frontières, notre pays ne risquerait-il pas d’être submergé par des hordes d’immigrants ? Certainement pas, à condition que les droits de propriété légitimes des uns et des autres soient respectés.
Reprenons en effet la comparaison entre la liberté d’immigrer et la liberté des échanges. Comment définir la liberté des échanges ? Elle signifie simplement que la puissance publique ne doit pas utiliser son monopole de contrainte légale pour opposer des obstacles à un échange désiré par les partenaires concernés. Elle constitue donc en quelque sorte une liberté négative.
La liberté des échanges ne signifie pas qu’on peut m’obliger à acheter ou à lire un livre que je ne veux pas lire (même si une majorité « démocratiquement élue » considère que j’ai tort…). Elle consiste à dire qu’on est libre de me le vendre (ou de refuser de me le vendre) et que je suis libre de l’acheter (ou de le refuser). Il en est de même pour ce livre vivant qu’est un immigrant : il doit être libre d’offrir ses services de travail, s’il le souhaite, n’importe où dans le monde ; et les autres doivent être libres de les accepter ou de les refuser, quelles qu’en soient les raisons.
La liberté de migration ne signifie donc pas qu’un « étranger » a le droit d’aller là où il veut, mais qu’il peut aller librement là où on veut bien le recevoir. Ce qui n’a pas de sens, c’est le critère de nationalité : il constitue une discrimination d’origine publique, de même que le protectionnisme traite différemment les produits nationaux et les produits étrangers. C’est cette discrimination légale qu’il convient de contester. Le refus de vente ou le refus d’acheter, le refus d’émigrer ou le refus d’accepter un migrant relèvent de la perception du monde par chacun et de sa propre morale. On ne peut pas imposer aux autres une morale de résultat. La morale c’est précisément de respecter les droits de chacun, y compris, par conséquent, les droits de celui qui refuse l’échange avec un « étranger ».
Dans un système de propriété privée, les droits de chacun sont conditionnels : on entre dans la propriété d’autrui à condition d’en respecter les règles et de payer le prix éventuellement demandé. Ainsi que nous l’avons vu, le droit de propriété se définit comme la liberté d’exclure autrui de l’usage du bien que l’on possède, quelles que soient les motivations de l’exclusion.
Si le propriétaire d’une maison refuse de la louer à quelqu’un qu’il considère comme un « étranger » (parce qu’il vient d’un autre pays, qu’il a une couleur de peau différente, une autre culture ou une autre religion), si le propriétaire d’une entreprise refuse d’embaucher pour les mêmes motifs, cela peut nous choquer, mais nous devons reconnaître qu’ils en ont le droit. Ayons en effet l’honnêteté de l’admettre, nous passons notre vie quotidienne à définir des exclusions, car personne ne possède de droits illimités sur nos biens, notre personnalité et notre temps. Il faut donc accepter le droit d’un individu à refuser certains individus dans sa maison, dans son entreprise, dans sa copropriété, quelles qu’en soient les raisons, même si le refus tient à ce que ces individus sont perçus comme « étrangers ».
C’est un fait : les êtres humains sont tous différents, et chacun a ses préférences en fonction de critères impénétrables. C’est bien pourquoi nous avons des amis : avoir un ami c’est avoir quelque chose en commun avec autrui, mais c’est aussi exclure les autres des relations d’amitié. Si la loi était cohérente, elle devrait punir le fait d’avoir des amis – c’est-à-dire d’exclure les autres des relations d’amitié – puisqu’elle condamne ce qu’on appelle la « discrimination raciale ».
L’utopie libertarienne constitue à cet égard un modèle de référence indispensable. Il serait certes naïf de penser qu’elle est réalisable, tout au moins à court terme, du fait des résistances qu’elle rencontrerait de la part des pouvoirs établis, mais elle apporte à la réflexion les bornes utiles dont elle a besoin.
Elle consiste à imaginer un monde structuré en un nombre immense de copropriétés que l’on peut appeler des « nations ». Chacune d’entre elles, différente des autres, exerce ses droits d’exclusion d’une manière qui lui est propre, mais entre aussi avec les autres dans divers rapports de coopération. On peut imaginer que certaines soient fondées sur un principe xénophobe en ce sens que leurs habitants interdisent l’entrée sur leur territoire de tous ceux qui appartiennent à d’autres « nations », que certaines mêmes soient racistes, mais que d’autres, au contraire, soient plus ouvertes, mais n’en exercent pas moins et nécessairement leurs droits d’exclusion (que ce soit à l’égard des voleurs, des braillards ou des extrémistes de toutes sortes).
Le concept de nation et son étatisation
La théorie libérale est fondée sur une conception réaliste de l’homme. Contrairement aux caricatures qu’on se complaît à en donner, et selon lesquelles les êtres humains seraient vus comme des atomes séparés et même hostiles les uns aux autres, elle reconnaît donc comme un fait d’observation que l’homme est fondamentalement un être social.
Tout être humain appartient à des sociétés plus ou moins grandes, et il a un sentiment d’appartenance à ces groupes. La nation est l’un d’entre eux. Elle représente un ensemble de liens sociaux nés de l’histoire et qui s’expriment dans une culture, une langue le plus souvent, parfois une religion commune.
La nation relève donc de l’ordre spontané, elle est multiforme, évolutive et difficile à cerner. Elle est surtout le résultat de perceptions multiples, elles-mêmes différentes selon ses membres. C’est pourquoi il est erroné d’assimiler la nation à l’État qui est au contraire une réalité précise, institutionnalisée et même dans une large mesure extérieure à la nation.
N’est-il d’ailleurs pas frappant de constater que c’est précisément à l’ère de l’étatisme triomphant – c’est-à-dire le XXe siècle – que l’on a vu ressurgir ce qu’on appelle les nationalismes. C’est bien le signe que les États ont imposé la création d’ensembles sociaux qui n’étaient pas spontanément perçus comme des « nations », mais auxquels ils se sont permis de donner ce nom.
La nation, nous l’avons dit, résulte d’un sentiment d’appartenance à une communauté et c’est pourquoi l’État-nation est une aberration : on ne peut pas étatiser des sentiments. Il se passe alors ce qui se passe chaque fois qu’il y a étatisation, l’État crée un monopole à son profit et le défend. Il lutte donc contre les particularismes régionaux, c’est-à-dire que l’État-nation détruit les nations spontanées. En témoignent, par exemple, les efforts faits en France, au nom de l’égalité républicaine, pour détruire les langues régionales au XIXe siècle.
L’État-nation est alors personnifié, ce qui facilite l’assimilation entre la nation et l’État. On dira par exemple que « la France décide » ou que « la France exporte ».
Dans le premier cas, on laisse implicitement supposer que l’État français décide légitimement au nom de tous les Français et qu’il existe une sorte d’esprit collectif capable de penser et d’agir.
Dans le deuxième cas, on laisse implicitement supposer que l’exportation serait un acte collectif, qu’elle exprimerait même un intérêt collectif et donc que l’État – expression de cet intérêt commun – serait habilité à la déterminer.
Ce serait une saine habitude de pensée que de s’astreindre définitivement à éviter d’utiliser ces abstractions flottantes – la France, l’Allemagne, le Japon, l’Europe – et donc à indiquer explicitement quels sont les acteurs qui pensent et agissent. Il convient donc de dire non pas que « la France décide », mais que « le gouvernement français décide », non pas que « la France exporte », mais que des producteurs français exportent. Il apparaîtrait alors plus clairement, dans le langage même, qu’il existe non pas un intérêt collectif mythique, mais des intérêts bien particuliers, par exemple les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir, ou les intérêts de ceux des producteurs qui exportent.
Mais l’usage de ces abstractions flottantes a un rôle bien précis. Il finit par induire l’idée, non seulement qu’il y a assimilation entre l’État et la nation, mais même que la nation « appartient » à l’État, qui possède donc tout naturellement le droit de gérer le territoire national. À partir de là naît alors le mythe des biens publics, que nous dénonçons par ailleurs. La légitimation intellectuelle des biens publics consiste évidemment à dire qu’il existe par nature des biens et services qui peuvent être produits de manière « optimale » par l’État, alors qu’ils ne pourraient pas l’être par le secteur privé.
Mais la réalité est toute différente : une fois que le territoire national a été étatisé, il apparaît comme naturel que le propriétaire de ce territoire ait la charge de son aménagement. Entre autres choses, c’est parce que le territoire national appartient, non pas à la nation, mais à l’État que les principes d’exclusion sont définis par l’État. On n’hésitera alors pas à penser que seul l’État peut faire procéder à des « expropriations pour cause d’utilité publique » afin de faire construire routes et aéroports, ou à considérer que la définition d’une politique d’immigration – c’est-à-dire des droits d’exclure les étrangers – constitue un service public qu’il est seul capable de produire de manière efficace, et qu’il est même seul à pouvoir exercer légitimement en tant que propriétaire.
Les droits de propriété gérés par l’État ne se limitent pas à ce que les juristes appellent le domaine public, mais ils incluent une large partie des droits qui sont censés être laissés aux mains des citoyens. L’État, en effet, peut procéder à des expropriations, définir les droits de construire, installer les réseaux des prétendus « services publics » (distribution de l’eau, de l’électricité, du gaz, des télécommunications), construire des logements, prélever des impôts sur les propriétés, etc.
Il en résulte que l’on peut parfaitement vivre en permanence sur un territoire presque totalement public d’où la définition de droits de propriété privés est pratiquement absente. À partir de ce moment-là, l’État devient très naturellement celui qui définit les droits d’exclusion à l’égard d’un territoire qui a été préalablement largement étatisé. Mais si la définition d’une politique d’immigration paraît être une responsabilité étatique – à supposer que l’on puisse admettre cette contradiction dans les termes que représente la juxtaposition des mots « responsabilité » et « étatique » – ce n’est pas parce que cela serait naturel, mais parce que c’est une conséquence difficile à éviter d’une politique artificielle d’étatisation de la nation, de son territoire et, finalement, des citoyens.
Nous le verrons ultérieurement, l’idée selon laquelle les services d’éducation ou de santé, les services en réseaux (eau, gaz, électricité, télécommunications, transports) sont par nature des « biens publics », est une idée erronée. Mais elle est indispensable pour fournir des alibis et une sorte de légitimation intellectuelle à l’appropriation de la nation par l’État. C’est d’elle que vient le problème de l’immigration.
En effet, tous ces biens publics sont produits de manière collectiviste, c’est-à-dire que leur véritable coût est caché. Ils sont fournis de manière gratuite ou tout au moins à prix réduit – par exemple du fait de la péréquation – à tous ceux qui se trouvent sur le territoire national, c’est-à-dire en réalité sur le territoire étatisé.
De là vient en grande partie le problème de l’immigration. En effet, dans un univers où les rapports humains reposeraient totalement sur une base contractuelle, un étranger – pour autant qu’une telle notion ait alors un sens – ne viendrait sur le territoire de l’une de ces petites nations libertariennes que nous avons déjà évoquées que dans la mesure où ce serait mutuellement profitable aux parties en cause. L’immigrant potentiel devrait payer le véritable coût des biens et services qu’il utiliserait et il aurait donc à comparer le coût de son installation dans une autre nation à l’avantage qu’il en retirerait. Symétriquement, ses partenaires potentiels dans l’échange pourraient exercer leurs droits d’exclusion si l’échange envisagé ne leur paraissait pas souhaitable, qu’il s’agisse de vendre des biens, de signer un contrat de travail ou d’effectuer une location.
Par contraste, lorsque le territoire est étatisé, il est intéressant de venir bénéficier de tout ce qui est fourni à coût faible ou nul et de contribuer le moins possible au financement des biens publics en question.
L’étatisation du territoire a donc une double conséquence : non seulement elle crée une incitation à immigrer qui, sinon, n’existerait pas, mais cette incitation joue uniquement pour les moins productifs, ceux qui reçoivent plus qu’ils ne fournissent, alors qu’elle décourage les immigrants productifs, ceux qui paieraient plus d’impôts qu’ils ne recevraient en biens publics.
Comme toute politique publique, elle crée donc un effet-boomerang. En effet, elle fait naître des sentiments de frustration de la part de ceux qui supportent les transferts au profit des immigrés, et elle est donc à l’origine de réactions de rejet : le racisme vient de ce que l’État impose aux citoyens non pas les étrangers qu’ils voudraient, mais ceux qui obtiennent arbitrairement le droit de vivre à leurs dépens.
À titre d’exemple, un article du Wall Street Journal de 1993 s’interrogeait sur le fait que l’immigration en provenance du Mexique était trois fois plus importante en Californie qu’au Texas en dépit d’une frontière commune avec le Mexique beaucoup moins longue et plus difficile à franchir illégalement. La raison de cette différence tient en partie au fait que le système de protection sociale est beaucoup plus développé en Californie qu’au Texas.
Comme l’a déclaré un fonctionnaire du bureau de l’immigration et des affaires des réfugiés du Texas :
« Il n’est pas possible ici de vivre de l’assistance. Les gens viennent ici pour travailler, et non pour bénéficier de la protection sociale. Et ceci affecte l’attitude de nos résidents à l’égard des immigrants. Ils sont généralement considérés comme des travailleurs, et non comme des bénéficiaires d’assistance. »
L’étatisation du droit d’exclure
Nous passons notre temps à discriminer, pour des motifs que les autres peuvent considérer comme bons ou mauvais, selon leurs perceptions et leur morale. Or, le problème posé par l’immigration vient tout simplement du fait que l’État enlève arbitrairement aux individus le droit à la discrimination à l’égard de ceux qu’il définit lui-même comme des étrangers (à partir du critère de nationalité), mais qu’il s’attribue ce droit de discrimination, sous le nom de politique d’immigration.
Établir des quotas d’immigration, des interdictions d’entrée sur le territoire national, n’est-ce pas définir des exclusions, n’est-ce pas du racisme public ? De quel droit l’État se permet-il de décider de ce qui concerne mes relations privées ? Si je souhaite, par exemple, recevoir chez moi tel intellectuel africain dont je me sens proche et si je ne désire avoir aucun contact avec tel Français qui défend des thèses inadmissibles pour moi et qui est pour moi un étranger, pourquoi l’État français serait-il chargé d’exclure le premier et de tolérer le second ?
C’est l’étatisation du droit d’exclusion qui crée le problème de l’immigration : l’État s’est approprié des droits fondamentaux qui appartiennent aux individus et qui ne peuvent appartenir qu’à eux, le droit de choisir et le droit d’exclure. C’est aux individus de définir jusqu’à quel point ils désirent vivre quotidiennement, au bureau, dans leur immeuble, dans leur famille, avec des hommes et des femmes qu’ils perçoivent comme des étrangers, l’étranger pouvant d’ailleurs être aussi bien celui qui vient d’un village voisin que d’un pays éloigné, celui qui possède une éducation différente, celui qui appartient à une autre religion ou celui qui fait partie d’une autre profession.
Le droit d’exclure ne peut résulter que du droit de propriété : mais qui est propriétaire, par exemple, de la France ? En agissant comme les monopoleurs de l’exclusion, les autorités françaises s’affirment arbitrairement propriétaires de ce pays – et donc de ses habitants – alors qu’en réalité, il existe sur le territoire national des millions de personnes qui possèdent – ou devraient posséder – un nombre considérable de droits de propriété variés. Le problème de l’immigration n’est donc que le reflet du caractère flou de la définition des droits de propriété à notre époque, et de la substitution de pouvoirs de décision publics à des pouvoirs de décision privés.
Dans le contexte actuel où le niveau d’immigration est défini globalement pour l’ensemble de la nation par le pouvoir politique, et où, par ailleurs, la « politique sociale » aboutit à subventionner l’immigration des moins productifs, certains, qui se disent favorables à l’immigration et proclament leur générosité par des discours contre le racisme, ne sont pas touchés directement par le phénomène ; d’autres lui sont opposés, parce qu’ils voient leur environnement culturel et religieux se modifier profondément. N’ayant pas le moyen de décider eux-mêmes, ils en appellent à l’État pour résoudre leurs problèmes personnels qui deviennent ainsi des problèmes de société.
Mais aucun compromis ne pourra jamais être trouvé entre les tenants de la « préférence nationale » et les chantres de la lutte contre le racisme. Seul est enrichi le fonds de commerce des politiciens et des animateurs de télévision populaires qui trouvent ainsi matière à d’inépuisables débats.
Lorsque l’État devient le seul habilité à prononcer des mesures d’exclusion à l’égard de certaines catégories de personnes que l’on appelle des étrangers, il est soumis à des pressions contradictoires de la part de groupes organisés – éventuellement sous forme de partis politiques – dont certains demandent un renforcement des exclusions et d’autres demandent au contraire davantage de laxisme.
Parce qu’on interdit à chaque citoyen de décider lui-même des exclusions éventuelles qu’il désire en ce qui le concerne, dans son habitat, dans son travail, dans sa famille, le problème devient un problème global, et chacun ressent qu’il ne peut le résoudre qu’en en faisant un problème global. Bien évidemment, le « degré optimal d’immigration » n’étant pas le même pour tous, il ne peut pas y avoir de consensus sur le problème de l’immigration. Et comme cette question touche la vie quotidienne des gens, ces oppositions deviennent des problèmes politiques aussi sensibles qu’insolubles.
La définition d’une politique nationale d’immigration ne peut pas répondre aux vœux extrêmement subtils et diversifiés qu’exprimerait spontanément la population si elle était libre de le faire.
Ainsi, il y a dans nos pays une distorsion de la structure de l’immigration par rapport à celle qui prendrait place dans une hypothèse de liberté individuelle. L’immigration « de mauvaise qualité » est encouragée parce que les immigrants peu formés ont d’autant plus intérêt à immigrer qu’ils bénéficient dans les pays développés de ce que l’on appelle les avantages sociaux. Ceux-ci consistent à prélever par la contrainte (l’impôt et les cotisations sociales) des sommes qui permettent de réaliser des transferts. Il en résulte qu’en venant en France, un immigrant peu formé reçoit un ensemble de ressources, sous la forme de son salaire direct et de son salaire indirect, très supérieur à sa productivité, c’est-à-dire à ce qu’il produit.
Lorsque l’immigration est généralement considérée comme excessive, l’État prend alors des mesures restrictives à l’entrée, sous la pression d’une partie de l’opinion. Mais ces mesures ne peuvent être le plus souvent que générales. Elles aboutissent alors à refuser ou à limiter l’entrée de tous les immigrants, quels que soient leurs talents ou leur valeur humaine.
Ainsi, un grand artiste, un intellectuel renommé ou un entrepreneur performant seront empêchés d’immigrer au nom d’un quelconque quota d’immigration ou d’une quelconque interdiction, même si leur entrée n’aurait pu rencontrer l’hostilité de personne ! Certes, on connaît des exemples d’États qui ont défini des quotas d’immigration diversifiés par nationalité d’origine ou par profession, mais ces mesures sont généralement considérées comme discriminatoires et l’on préfère donc – comme cela est le cas en France – des mesures d’ordre général. Ainsi, l’immigration y est généralement interdite, mais certains – pas forcément les meilleurs – arrivent, comme toujours, à contourner la loi, en faisant officialiser une situation illégale, en se faisant passer pour des réfugiés politiques ou, tout simplement, en se faisant fabriquer de faux papiers d’identité.
Si l’immigration était totalement libre, au sens où nous l’avons précisé, mais si les individus avaient le droit d’exprimer librement leurs désirs d’exclusion et si l’État ne subventionnait pas indirectement l’immigration « de mauvaise qualité », l’immigration correspondrait exactement aux vœux des migrants, aussi bien qu’aux vœux de ceux qui les accueillent. C’est en ce sens que l’on peut dire que la liberté d’immigrer n’aboutirait pas au déferlement de hordes non désirées. Immigrer n’est pas facile et rarement souhaité par celui qui doit ainsi quitter sa famille, son village, sa culture et ses habitudes. Il le fait parce que la différence de niveau de vie est trop importante entre son pays d’origine et son pays d’accueil – probablement parce que l’État étouffe toute initiative dans son pays d’origine – et parce que, par ailleurs, il est « surpayé » dans le pays d’accueil du fait de la politique sociale.
Ainsi, l’émigration et l’immigration devraient être totalement libres car on ne peut pas parler de liberté individuelle si la liberté de se déplacer n’existe pas. Mais la liberté de se déplacer n’implique pas que n’importe qui a le droit d’aller où bon lui semble. Les droits de chacun trouvent en effet pour limites les droits légitimes des autres.
Imaginons en effet à nouveau ce monde hypothétique où l’intégralité de la surface de la Terre serait privativement appropriée (ce qui n’empêcherait évidemment pas les individus de constituer différents types d’organisations volontaires, par exemple des entreprises et associations, qui seraient propriétaires de certaines parties de l’espace). Dans cette hypothèse, seule serait exclue l’existence d’un domaine public, de telle sorte que toutes les voies de communication, par exemple, appartiendraient à des propriétaires privés qui pourraient en faire payer l’usage par des procédés variés.
La liberté de circulation n’impliquerait donc pas que n’importe qui aurait le droit d’entrer sur la propriété d’autrui sans son consentement, mais seulement qu’aucune autorité ne pourrait user de la contrainte pour empêcher un individu d’entrer sur la propriété d’autrui, s’il existe un accord mutuel entre lui et le propriétaire. Si par exemple, un natif d’une région du monde appelée Mali, souhaite vivre et travailler dans une ville qui s’appelle Paris et s’il trouve un propriétaire qui veut bien lui louer un logement, un entrepreneur qui souhaite signer un contrat de travail avec lui, des propriétaires de routes qui lui accordent le droit de circulation (gratuitement ou contre paiement), des épiciers qui lui vendent leurs produits, rien ne pourrait justifier qu’une quelconque autorité vienne interdire ces échanges mutuellement profitables.
Cette idée a des conséquences immédiates pour évaluer la situation actuelle, où il existe des nations et des autorités nationales. Au nom de quel principe une autorité légale française peut-elle légitimement interdire le territoire français au Malien que nous venons d’évoquer, alors même que tout le monde est d’accord pour entrer dans des arrangements contractuels avec lui ? Il y a certes une différence entre la situation hypothétique précédente et la situation concrète de notre monde actuel, à savoir qu’une partie du territoire français – comme de tout autre pays – est censée appartenir au « domaine public ».
Pourquoi en est-il ainsi ? Comme nous l’avons déjà rappelé, on justifie généralement l’existence de ce domaine public par l’idée qu’il existe des « biens publics », c’est-à-dire des biens et services produits en quantité « optimale » s’ils font l’objet d’une fourniture par la contrainte (prélèvement obligatoire d’impôts et fourniture obligatoire) plutôt que par les procédures de l’échange.
On pourrait alors dire que, le domaine public constituant « par nature » un bien public, l’État en est le propriétaire naturel, et qu’il peut se comporter comme n’importe quel propriétaire, c’est-à-dire exclure qui bon lui semble de l’usage de ces biens. Pourtant, dans la théorie des biens publics rien ne permet d’expliquer pourquoi un bien auquel on accorde le label de « bien public » (une rue par exemple) pourrait être ouvert à certains et pas à tous, en fonction d’un critère qui peut être, par exemple, la race, la nationalité, la religion ou la culture.
Certes, le droit de propriété implique nécessairement le droit d’exclusion.
Mais précisément, la théorie des biens publics enseigne que, dans certaines circonstances, il ne serait pas optimal de définir des droits de propriété privés et de produire des biens privés, c’est-à-dire des biens pour lesquels l’exclusion est possible. La justification même des « biens publics » – tout au moins pour ceux qui admettent que ces biens existent – consiste précisément à souligner que certains biens doivent être offerts à tous sans que l’on puisse individualiser l’usage qu’en fait chacun et le paiement correspondant et sans, par conséquent, que l’on puisse exclure quiconque de leur usage.
Il y a donc contradiction entre le fait de légitimer le domaine public par l’existence des biens publics, c’est-à-dire par l’impossibilité de l’exclusion, et le fait d’accorder un monopole à l’État pour la définition d’un droit d’exclusion sur le domaine public et même, d’ailleurs, le domaine censé rester privé. Certes, le coût de la fourniture de ce bien est supporté – au moyen d’impôts – par l’ensemble des membres de la collectivité qui bénéficie de ce bien public. Mais un immigrant qui travaille et vit au sein de cette communauté paie des impôts comme les autres. Aucun principe de théorie économique, ni, bien sûr, aucun principe éthique n’autorisent alors à l’exclure de l’usage de ce qu’on prétend être un « bien public ».
Il faut donc réinterpréter la réalité du monde moderne. En prétendant que les biens publics existent et qu’il faut les produire par une procédure de contrainte publique, les hommes de l’État donnent une légitimation à l’exercice de leur pouvoir. En prétendant qu’ils produisent des « biens libres », c’est-à-dire disponibles pour tous, ils produisent en fait des biens dont ils s’accaparent la propriété, puisqu’ils s’accordent le droit d’énoncer les exclusions qui sont inhérentes au droit de propriété.
Si, véritablement, ils se contentaient de produire des biens considérés comme des « biens publics », ils devraient les rendre disponibles à tous, sans distinction de nationalité, de race ou de religion et laisser les citoyens décider dans quelle mesure ils souhaitent établir des contrats avec des individus d’autres nationalités. Si certains individus désirent exclure d’autres individus parce qu’ils les perçoivent comme étrangers, cela relève uniquement de leur éthique personnelle et aucune autorité n’a le droit de leur imposer un comportement conforme à une autre éthique.
Comme nous l’avons déjà souligné, il faut avoir le courage de reconnaître que nous passons notre temps à faire des exclusions, mais ces exclusions ne sont légitimes que dans la mesure où elles sont la conséquence logique des droits de propriété.
La théorie des biens publics repose sur l’idée qu’il n’est pas toujours possible ou souhaitable de définir des droits de propriété. Mais, comme nous venons de le voir à propos de la politique d’immigration, cette théorie constitue purement et simplement un moyen de monopoliser les droits de propriété dans les mains d’un groupe d’hommes particuliers, les hommes de l’État. Ces derniers ont alors le moyen de substituer leurs propres exclusions à celles que les citoyens, dans leur immense diversité, souhaiteraient mettre en œuvre. On imposera donc aux citoyens la présence de tel indésirable, sous prétexte qu’il est un réfugié politique, mais on les empêchera d’entrer en relations avec un être plein de sagesse et d’intelligence sous prétexte qu’il est un étranger.
On se rend compte alors qu’en tant que propriétaires effectifs du domaine public, les hommes de l’État se rendent en réalité propriétaires de l’ensemble du territoire national : décider des exclusions, c’est être propriétaire.
Tout cela signifie évidemment que les problèmes d’immigration ne trouveront pas de solution aussi longtemps qu’on continuera à les traiter comme des problèmes collectifs. Toute décision publique concernant l’immigration sera en effet insatisfaisante, en ce sens qu’elle ne pourra pas se conformer aux vœux de ceux qui sont concernés. L’unique solution, conforme aux principes d’une société libre, consisterait évidemment à reconnaître la liberté d’immigration, à supprimer les encouragements indirects à l’immigration que provoque la « politique sociale » et à rendre aux individus la liberté de leurs sentiments et de leurs actes.
L’optimum de population
Pour exercer leur monopole d’exclusion, les hommes de l’État trouvent le soutien d’experts qui forgent des concepts fictifs.
Tel est le cas de la théorie des biens publics, ainsi que nous venons de le voir. Mais tel est aussi le cas de la notion d’optimum de population. En fait, l’optimum de population étant défini de manière globale, il relève en un sens également de la catégorie des biens publics : de manière à ce que les habitants d’un pays puissent vivre dans une population dont la taille est « optimale », il faudrait évidemment que l’État exerce une fonction de régulation dans l’intérêt de tous, en particulier en pratiquant une politique familiale et en maîtrisant la politique d’immigration. Personne, individuellement, ne pourrait maîtriser ces phénomènes et tout le monde aurait donc intérêt à ce que l’État les prenne en charge.
Il devrait pourtant être généralement admis que l’optimum ne peut être défini que du point de vue d’un individu. Si, pour reprendre la situation hypothétique évoquée ci-dessus, les pays n’existaient pas et le monde était structuré en millions de propriétés et de petites copropriétés constituées sur une base volontaire et respectant évidemment la liberté d’entrée et de sortie, le phénomène de migration aurait un tout autre sens.
Ainsi, il y aurait des copropriétés pratiquant l’exclusion à l’égard de certaines catégories raciales, religieuses, culturelles, d’autres qui ne pratiqueraient pas d’exclusion ou qui pratiqueraient la ségrégation sur d’autres critères. La densité de population serait forte dans certaines copropriétés, faible dans d’autres, en fonction de la perception individuelle de ce qu’est l’optimum. Dans une copropriété librement formée, on peut déterminer un optimum de population. Ce n’est évidemment pas le cas des nations actuelles.
On ne peut pas dire a priori qu’un pays quelconque est actuellement au-dessus ou en dessous de son « optimum de population ». Aucun critère, en effet, ne permet de définir un optimum collectif. Ainsi, on peut certes penser qu’une population plus importante facilite l’innovation et la spécialisation des tâches, mais on peut aussi penser qu’elle est à l’origine d’encombrements et de nuisances diverses. Qui peut arbitrer entre ces effets de sens contraire ?
Le concept d’optimum de population n’a de sens que si on le conçoit comme un concept subjectif. Dans une société libre, les individus se déplacent vers les zones où la densité, d’une part, la diversité, d’autre part, de la population correspondent le mieux à leurs désirs et à leurs besoins. Une île déserte constitue le lieu de séjour rêvé d’un misanthrope et, pour lui, l’optimum de population est égal à un. Mais le Chinois qui émigre à Hong-Kong pour faire du commerce considérera sans doute que l’optimum correspond à une densité très élevée.
Un raisonnement « collectiviste » semblable à celui qui inspire la notion d’optimum de population inspire aussi la politique de contrôle des naissances dans certains pays pauvres. On considère qu’il y a un gâteau à partager et que le bien-être de chaque individu est d’autant plus grand qu’il y a moins de personnes pour le partager. Et pourtant ce gâteau est créé par l’activité des hommes.
Des hommes plus nombreux peuvent produire un gâteau plus grand. Il convient, pour cela, de s’en remettre à la sagesse des parents, seuls aptes à décider de l’optimum de population de leur famille. Les millions de décisions prises par les parents sont interdépendantes, les gains et les coûts dus à la croissance de la population se reflétant en particulier dans les systèmes de prix (rémunération du travail, coût du logement, etc.). De ces processus spontanés résulte, dans une population libre, une certaine densité de population dont on ne peut pas dire qu’elle constitue un optimum collectif, mais qu’elle est le résultat de la recherche permanente de leur propre optimum par un très grand nombre de parents.
La politique de restriction à l’immigration (ou à l’émigration), comme la politique de contrôle des naissances, constituent des restrictions de la liberté individuelle au nom d’un prétendu intérêt général. C’est pourquoi il est important de débusquer tous les faux concepts collectivistes, y compris le taux de croissance national, le revenu national, l’optimum de population, la politique familiale, de même bien sûr que la notion de biens publics.
Ces concepts sont en fait inspirés par une vision mécaniciste et arbitrairement quantitativiste, malheureusement trop fréquente dans le domaine de la macroéconomie. Elle conduit à des propositions erronées, comme celles que nous venons de rencontrer. Cette vision conduit aussi, par exemple, à l’idée que l’immigration serait une cause de chômage, comme s’il existait un nombre limité d’emplois dans un pays, de telle sorte que tout nouvel immigrant prendrait un emploi existant et mettrait un national au chômage.
De même est erronée – en tant que proposition générale – l’idée souvent exprimée selon laquelle la liberté d’immigration entraînerait une baisse du salaire réel. Ceci serait vrai si les processus de production étaient donnés et s’il existait un stock fixe de capital. On substituerait alors du travail au capital et la productivité marginale du travail diminuerait, donc sa rémunération. Mais l’immigration modifie les processus de production pour différentes raisons
Tout d’abord, les immigrants épargnent et créent donc du capital qui accroît la productivité du travail. Si l’on suppose que les immigrants épargnent exactement dans la même proportion que les nationaux, il y a simplement élargissement de la production. On peut même imaginer que le désir d’amélioration matérielle qui les a poussés à émigrer les pousse aussi à épargner davantage. Mais ceci est certainement plus vrai dans une situation où l’immigration n’est pas subventionnée – cas de l’immigration aux États-Unis au XIXe siècle où les immigrants voulaient prendre en main leur propre destin – que dans une situation où l’immigration résulte précisément du désir de vivre aux dépens des autres.
En deuxième lieu, les conséquences de l’immigration dépendent de la structure de l’immigration. Divisons les hommes en deux catégories : les innovateurs et les autres. S’il y a la même proportion des deux catégories dans la population des immigrants et dans la population d’accueil, l’immigration se traduit par un simple élargissement de la production, toutes choses restant égales par ailleurs, en particulier la productivité du travail et le salaire réel.
Mais supposons qu’il y ait plus d’innovateurs parmi les migrants, parce que, normalement, les plus courageux et les plus imaginatifs prennent le risque d’émigrer (comme cela a probablement été le cas aux États-Unis) : il y a alors accroissement de la productivité du travail et du salaire réel.
Les règles actuelles de l’immigration créent un problème spécifique de ce point de vue. En effet, l’immigration est en principe interdite, mais on laisse passer une immigration de mauvaise qualité, composée en majorité de personnes qui ne sont pas des innovateurs. Cela résulte évidemment du système de subventions dites sociales qui modifie la rémunération relative entre les deux catégories, mais aussi du fait que les critères de la politique d’immigration n’ont rien à voir avec les capacités des hommes : on favorise le regroupement familial, l’installation de vrais ou de faux exilés politiques, on régularise la situation de clandestins. Un innovateur, pour sa part, ne cherche pas à vivre de subsides et il ne peut pas se contenter de vivre en clandestin. La politique d’immigration le décourage de tenter sa chance.
C’est donc dans la situation actuelle d’encouragement à l’immigration des moins productifs et de contrôle de l’immigration – et non dans le cas où il y aurait liberté d’immigration et moindre étatisation de la société – que l’immigration pèse sur les salaires réels. Et c’est donc dans cette situation que les migrants sont perçus à juste titre comme des concurrents sur un marché du travail où les conditions ne s’améliorent pas rapidement. Mais au lieu d’imputer la baisse du salaire réel à l’immigration, il conviendrait de l’imputer à la politique d’immigration et à la politique sociale.
Portée du principe de liberté dans le contexte actuel
La liberté totale d’immigration serait donc justifiée dans un monde qui ne serait pas étatisé. Cela implique que la meilleure politique d’immigration consisterait à désétatiser la société. Mais si l’on s’y refuse, comme c’est malheureusement le cas pour le moment, le principe de la liberté d’immigration peut-il être maintenu ? Nous avons sans doute instinctivement peur de cette liberté et de ses conséquences.
Comme l’a souligné avec force Michel Massenet, il existe un risque considérable que des masses affamées spéculent sur le sens moral des plus riches et déferlent dans leurs pays. On le constate donc une fois de plus, lorsque l’interventionnisme étatique produit des effets pervers – ce qui est nécessairement le cas – on est tenté de les éliminer par une nouvelle intervention étatique qui fait naître de nouveaux effets pervers. Ainsi, la politique sociale fait apparaître une immigration perçue comme excessive et non désirable, ce qui conduit à la mise en place d’une politique d’immigration, dont nous avons vu les effets néfastes.
Par ailleurs, étant donné que la nation elle-même est largement étatisée, il est tout simplement impossible de recourir à la liberté contractuelle : l’État décide à la place des individus. Un système de liberté contractuelle généralisée conduirait à une autorégulation de l’immigration et la liberté d’immigrer n’a de sens que dans ce cadre. Instaurer une totale liberté d’immigrer dans le contexte institutionnel actuel ne serait évidemment pas viable ni désirable. Ceci reviendrait par exemple à attribuer à tout individu dans le monde le droit non pas de contracter avec des Français, mais le droit de vivre à leurs dépens, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Autrement dit, on ne peut pas reconnaître des droits de propriété étendus de l’État sur le territoire et sur les citoyens et ne pas accepter ce qui en est la conséquence logique, à savoir son droit à définir les exclusions sur le domaine dont il s’est rendu propriétaire. Et ce domaine inclut d’ailleurs les personnes mêmes des citoyens, puisqu’on admet à notre époque le droit illimité de l’État à s’approprier par l’impôt le produit de leur activité : de ce point de vue, l’État serait institutionnellement habilité à prélever des sommes illimitées au profit d’une immigration immense dans le cas où sa politique d’immigration serait très laxiste. Le problème de l’immigration est ainsi devenu purement et simplement un problème politique, soumis aux techniques de la décision politique.
Est-ce à dire qu’aucun changement n’est possible ? Ainsi, certains, en particulier à gauche, sont favorables à la répression des opinions racistes et à l’attribution du droit de vote aux immigrés. Pour notre part, nous sommes en désaccord sur le premier point, mais pas sur le second, à condition de le préciser.
Il faut supprimer le délit de racisme, tout simplement parce qu’on ne peut pas punir quelqu’un pour ce qu’il a dans la tête. Chacun d’entre nous doit avoir le droit de penser du mal de son voisin – donc de ceux qui sont plus éloignés – et de le dire, les seules limites étant données par les convenances sociales. Toute attitude raciste me paraît insupportable et stupide, mais je ne me reconnais pas le droit de la punir.
Plus généralement, toute attitude qui consiste à évaluer une personne humaine à partir de son appartenance à une catégorie arbitrairement définie me paraît insupportable et stupide, mais je ne me reconnais pas d’autre droit que celui de faire des efforts de persuasion. Ainsi, lorsqu’en 1996 le gouvernement Juppé a puni les médecins, par des sanctions financières, pour n’avoir pas limité davantage la croissance des dépenses de santé, il a bafoué les principes du Droit les plus élémentaires en introduisant un concept de responsabilité collective.
Si un individu A agresse un individu B, il doit en être puni car il a porté atteinte à ses droits légitimes, que l’agression soit motivée par des préjugés racistes ou par toute autre cause, par exemple le désir de voler. Mais si l’individu A pense du mal de l’individu B parce qu’il n’appartient pas à la même race que lui ou pour toute autre raison, il n’a pas à en être sanctionné. En effet, la sanction impliquerait que l’individu B a des droits sur l’esprit et la façon de penser de A, ce qui ne peut manifestement pas être vrai dans une société non esclavagiste.
Quant à la discussion sur le droit de vote des immigrés, elle est évidemment pleine d’arrière-pensées. La gauche en espère un nombre de voix plus important, tandis que d’autres s’inquiètent de l’augmentation des transferts qui pourraient en résulter, dans la mesure où les immigrés sont dans l’ensemble plutôt bénéficiaires de ces transferts que contributeurs. Or qu’est-ce qui détermine un droit de vote ? La réponse est tout à fait claire lorsque les droits de vote sont liés aux droits de propriété. Ainsi, dans une société anonyme, les droits de vote sont proportionnels aux droits de propriété des actionnaires, de même que dans une copropriété.
Dans le monde hypothétique de petites copropriétés qui nous sert de référence, un « étranger » qui serait admis dans une « nation » en tant que copropriétaire aurait évidemment les mêmes droits de vote que les autres (en proportion de ses droits de propriété). Les droits de propriété sont atténués dans un club ou dans une association, puisqu’ils ne sont pas individualisés. Si chacun bénéficie de droits de vote identiques, ce qu’il peut a priori retirer du club est également identique, de même que le montant de la cotisation (même s’il existe parfois des catégories différentes de membres, ayant d’ailleurs éventuellement des droits différents).
Le droit d’immigrer dans une nation ne peut pas être comparé à un droit de propriété dans une société anonyme ou dans une copropriété parce que personne n’est juridiquement propriétaire de la nation. La participation d’un citoyen est plutôt analogue à l’adhésion d’un membre à un club ou à une association. Comme dans celles-ci, chacun dispose dans l’État-nation d’un même droit de vote, mais, contrairement à elles, chacun contribue de manière différente. De là naît le problème pratique de l’immigration. Il n’y a pas de raison, en effet, de refuser le droit de vote à un immigré, c’est-à-dire le droit de participer aux décisions qui affectent sa communauté, à partir du moment où il a été admis dans celle-ci, c’est-à-dire que les membres de la communauté n’ont pas pratiqué l’exclusion à son égard.
C’est en ce sens que nous sommes favorables à l’idée d’accorder le droit de vote aux immigrés. Comment, en effet, peut-on justifier le fait de prélever des impôts sur les immigrés qui créent des richesses dans un pays, mais leur refuser un droit que l’on accorde aux autres producteurs, le droit de décider de l’affectation de ses impôts ?
Le véritable problème en réalité ne vient pas du fait que des immigrés puissent voter, mais du fait que les modalités pratiques du vote dans les démocraties modernes permettent aux électeurs d’imposer une redistribution des richesses entre catégories. Et c’est précisément la crainte qu’éprouvent ceux qui sont hostiles à l’attribution d’un droit de vote aux immigrés. Dans la mesure où chacun bénéficie d’une voix aux élections, quel que soit le montant d’impôts qu’il paie et quel que soit le montant de transferts qu’il reçoit, les électeurs ont intérêt à voter pour ceux qui pratiquent des transferts au profit de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Dans la mesure où les règles actuelles favorisent l’immigration de ceux qui sont des bénéficiaires nets, en leur accordant un droit de vote on risquerait de renforcer l’asymétrie du système, ces nouveaux électeurs votant pour les politiciens les plus favorables aux transferts, ce qui accélérerait l’immigration. On entrerait donc dans un cercle vicieux, dans lequel l’État deviendrait de plus en plus proche de la définition qu’en donnait Frédéric Bastiat, c’est-à-dire cette fiction par laquelle chacun s’efforce de vivre aux dépens des autres : un nombre croissant de personnes essaierait évidemment de vivre aux dépens des autres. Ceci étant naturellement intenable à terme, il en résulterait une démotivation des plus productifs, un appauvrissement général ou une stagnation définitive, et finalement bien sûr l’arrêt d’une immigration devenue non rentable.
Cela conduit à dire que le véritable problème n’est pas l’immigration ni l’attribution du droit de vote aux immigrés, mais le caractère inadéquat des procédures de décision. Le phénomène décrit provient de ce que le vote permet d’instaurer des transferts obligatoires entre catégories sans aucune limite et/ou du fait que le droit de vote est le même pour tous, alors que les contributions et les bénéfices sont très inégalement répartis. Il en résulte évidemment qu’il y a toujours possibilité pour une majorité d’individus d’essayer de spolier les autres des richesses qu’ils ont produites pour se les approprier. Il y a quelque chose de parfaitement immoral dans une procédure qui permet aux bénéficiaires d’un transfert de décider du montant de ce transfert, c’est-à-dire de ce que l’on va prendre aux autres.
Pour limiter le jeu de ces incitations, on pourrait adopter des dispositions – par exemple de nature constitutionnelle – établissant des limites strictes aussi bien aux montants de prélèvements subis par les contribuables qu’aux montants des prestations reçues. Mais on pourrait aussi modifier les procédures de vote, par exemple en décidant que les droits de vote seraient proportionnels aux impôts payés par chacun. Si l’on adoptait la conception selon laquelle l’État serait le gérant d’un club constitué par la nation, chacun aurait un droit de vote identique, mais la cotisation perçue serait également la même pour tous.
Ainsi disparaîtrait la tentation de prélever sur les uns pour transférer aux autres. Le droit de vote des immigrés paraîtrait parfaitement normal : ils seraient comme les autres contributeurs et bénéficiaires du « club ». En même temps la tentation de discriminer à leur encontre – donc la tentation « raciste » – disparaîtrait dans la mesure où leur appartenance à une catégorie spécifique – les « étrangers », les « immigrés » – ne serait d’aucune conséquence pratique pour les autres membres de la nation. Ici encore les discriminations dont peuvent être victimes les immigrés, aussi bien du point de vue de leurs droits de vote que de l’attitude des autres à leur égard, ne sont qu’une conséquence d’autres discriminations introduites par l’État, par exemple celle qui existe entre différents contribuables et celles qui existent entre différents bénéficiaires des transferts publics. Un État ainsi rééquilibré serait naturellement conduit à ne plus produire que des « biens publics », c’est-à-dire les services désirés par tous, pour autant qu’ils existent.
Bien sûr, une telle modification des règles de vote n’est pas acceptable pour tous ceux qui ont su ériger la démocratie absolue comme un tabou et un idéal moral intangible, c’est-à-dire tous ceux qui vivent des transferts qui en résultent, qu’ils en soient les bénéficiaires ou les distributeurs politiques, ou tous les intellectuels égarés qui légitiment le vol légal. Mais le fonctionnement de la démocratie absolue n’est, bien sûr, pas compatible avec l’attribution du droit de vote aux immigrés. Il faut choisir et reconnaître que la démocratie absolue est autodestructrice. Si on ne veut pas y renoncer, il est vain de croire que l’on pourra trouver des modes de régulation sociale acceptables. Nous le voyons à propos de l’immigration, nous l’avons vu et nous le verrons à propos d’autres « problèmes de société ».
Prenons, à titre d’exemple, le cas de l’école. Dans la situation actuelle d’un pays comme la France, l’école est gratuite, ouverte à tous et elle est censée favoriser l’intégration des nouveaux immigrés et de leurs enfants par apprentissage d’une culture commune. En fait, dans bien des cas, elle conduit à des situations de rejet, par exemple lorsque la proportion d’enfants appartenant à une culture différente est trop importante.
Que se passerait-il dans un système d’écoles privées et payantes, les parents – ou certains d’entre eux pouvant éventuellement payer les études de leurs enfants avec des bons d’éducation ? Dans des écoles véritablement privées – contrairement aux caricatures actuelles par lesquelles on appelle école privée une école qui participe en fait au monopole public de l’Éducation nationale – les propriétaires d’une école pourraient, en tant que tels, exercer un droit d’exclusion et celui-ci devrait leur être laissé. On rencontrerait donc probablement des écoles appliquant des quotas d’élèves étrangers, des écoles ouvertes à tous, des écoles réservées aux enfants d’une certaine origine nationale, religieuse, ethnique ou raciale et même peut-être des écoles racistes. Une fois de plus, on peut être choqué de l’existence de ces dernières, mais n’est-ce pas aux parents – responsables de la naissance de leurs enfants – de décider de leur environnement ?
Pourquoi l’État – au nom de la nation – devrait-il être le producteur unique d’une culture nationale ? Le mythe de l’intégration est en fait le mythe de l’intégration à une culture unique et contrôlée par l’État. L’école de la République est en réalité une machine à écraser les individualités, les langues, les traditions, à uniformiser les comportements. C’est l’intégration à un grand tout collectiviste et non la culture des spécificités d’où peut seul naître un véritable sentiment d’appartenance à la nation.
Nous soulignons par ailleurs la différence qu’il convient de faire entre l’intégration et l’unification (ou l’harmonisation). La tendance naturelle des gouvernants consiste à imposer des comportements, des attitudes, des règles identiques à tous les citoyens sous prétexte d’intégration sociale. Or celle-ci résulte de l’adaptation volontaire et continuellement changeante de tous les individus à leur société.
La différenciation des individus n’empêche pas leur intégration à une société. Ils sont d’ailleurs les premiers bénéficiaires de l’intégration si celle-ci est bénéfique. Il faut donc leur faire confiance pour ressentir ce besoin d’intégration et pour prendre les voies qui leur paraissent les meilleures à cet effet. Tous ne la réaliseront pas de la même manière et au même rythme. Certains essaieront de se protéger dans le cocon de leur culture d’origine, d’autres essaieront plus rapidement d’adopter la langue, les coutumes, les comportements de leur communauté d’adoption. Ce désir d’intégration sera d’ailleurs d’autant plus intense que l’immigration ne résultera pas du simple désir de bénéficier du système de transferts du pays d’accueil, mais d’une démarche où celui qui reçoit doit aussi donner, c’est-à-dire d’une démarche d’ordre contractuel.
On peut enfin se demander s’il n’existe pas des solutions de marché au problème de l’immigration puisque, nous le disons suffisamment dans le présent livre, il existe toujours des solutions de marché à un quelconque problème. En fait, nous le savons aussi, ce n’est pas tellement la solution de marché qui importe que ce qu’on pourrait appeler « la solution de droits de propriété » et c’est précisément ce que nous avons souligné précédemment. Dans la mesure où la situation actuelle est caractérisée par une définition floue et insuffisante des droits de propriété, il est a priori impossible de trouver des solutions de marché satisfaisantes sans mettre en cause l’étatisation de la nation par l’État. Puisqu’il n’y a pas de droits de propriété, il n’y a pas de marché des droits (si ce n’est les ventes sur le marché noir de fausses cartes d’identité… ).
Cela dit, on peut cependant trouver des formules qui rapprochent du marché.
C’est ce que fait Gary Becker lorsqu’il propose d’instaurer un marché des droits à immigrer (ou, éventuellement, des droits à acquérir une nationalité). Dans ce système, l’État annonce chaque année la vente d’une certaine quantité de droits et un prix d’équilibre s’établit sur le marché. Ceux qui obtiennent les droits sont évidemment ceux qui valorisent le plus ces droits d’immigrer, c’est-à-dire ceux qui se croient les plus aptes à produire des richesses dans la nation d’accueil. Plus le système de protection sociale est généreux, plus les droits en question sont chers. Mais ils sont également d’autant plus chers que les opportunités d’enrichissement sont plus grandes.
Ainsi, l’État s’étant approprié la nation, il en vendrait l’usage – dans la solution de Gary Becker – à des non-nationaux. Ce système est certes préférable au système réglementaire, administratif et arbitraire qui prévaut actuellement, mais il est inférieur à un système de définition des droits de propriété et de relations contractuelles. On peut aussi penser qu’il serait préférable que les décisions concernant la venue d’immigrés soient prises à l’échelon le plus petit possible, c’est-à-dire par des personnes qui soient aussi près que possible de ceux qui sont directement concernés par l’immigration. Autrement dit, au lieu d’avoir une politique nationale d’immigration, il serait préférable, par exemple, que l’autorisation de séjour soit donnée au niveau des municipalités. On se rapprocherait ainsi quelque peu du modèle de petites communautés que nous avons évoquées à plusieurs reprises.
Un libertarien américain, Edward Crane (président du Cato Institute), a pour sa part proposé que l’immigration soit libre, mais que les immigrants n’aient pas le droit aux « bénéfices de la protection sociale ».
Ainsi, d’après lui, étant donné que les immigrants seraient obligés de ne compter que sur eux-mêmes, il en résulterait que « dans l’espace d’une génération, les États-Unis auraient une culture d’immigration qui fournirait de meilleures écoles que celles de l’élève américain moyen, une plus forte proportion d’œuvres charitables, moins de pauvreté, une meilleure éthique du travail, plus d’esprit d’entreprise et un système de retraite florissant en comparaison de celui de la Sécurité sociale ».
Un autre libertarien, Hans-Hermann Hoppe, professeur à l’université de Las Vegas, pense pour sa part que les hommes politiques n’ont pas beaucoup d’incitations à changer le système actuel dans les démocraties modernes. En effet, il leur importe peu que le système national incite les plus productifs à s’expatrier puisque tous les citoyens ne disposent que d’une voix aux élections.
Par contre, « dans le court terme, le cossard qui vote pour des mesures égalitaristes aurait plus de valeur pour le leader démocratique que le génie productif qui, en tant que première victime de la politique d’égalitarisme, voterait plutôt contre lui ».
On le voit donc, l’immigration met en cause absolument tous les problèmes d’organisation sociale, parce qu’elle met en cause les relations de chacun avec autrui et par conséquent le système économique et politique. C’est pour nous une invitation supplémentaire à nous interroger sur ces questions. Comme les paragraphes précédents l’auront sans doute montré, ce n’est pas l’immigration, par elle-même, qui est le véritable problème. Le problème c’est l’État.
- Chapitre 11 du livre Libéralisme de Pascal Salin (Odile Jacob, Paris, 2000). Repris depuis l’Institut Coppet.





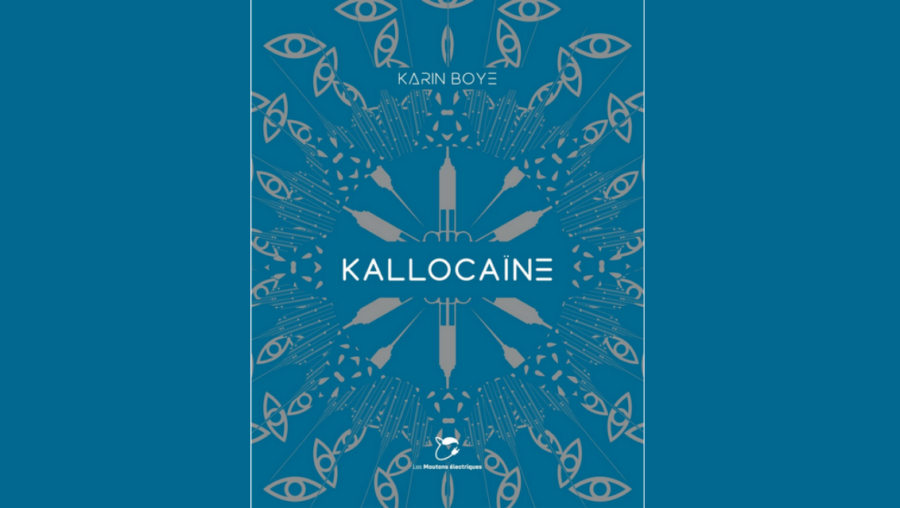
Un élément, de transition, que je ne comprends pas.
Comment concrètement gérer actuellement l’arrivée de migrants, d’un point de vue libéral ?
Ils sont à bout, n’ont pas forcément de compétences particulières (les fameux « ingénieurs » ont fait long feu). Ils sont sans ressources et souvent dans une situation critique.
Les autoriser à travailler ? Mais pour faire quoi ? Les travaux non qualifiés sont saturés. La création de nouvelles entreprises de leur fait ? Ils sont désargentés et n’ont plus de patrimoine.
Ne pas les aider au niveau des finances publiques ? Mais qui va les soigner, les loger ? Comment vont-ils pouvoir tenir sans entrer soit dans la délinquance soit dans le travail clandestin ?
On ne peut pas non plus les laisser mourrir dans une logique malthusienne.
Bonjour 13atg
Sortez de votre réflexe interventionniste, vive l’ordre spontané.
Le pb de l’immigration n’est pas un pb d’immigration mais un pb d’un état qui discrimine mal.
Le pb ce n’est pas les immigrés, c’est l’état providence.
Dans la réalité, laissons les étrangers travailler en france.. ou repartir chez eux s’ils ne trouvent pas leur place, les troubles éventuels seront pris en charge par un état régalien efficace.
Qui va les soigner, les loger? Eux mêmes comme les français qui peuvent s’assumer par eux-même.
« Mais qui va les soigner, les loger ? »
« On ne peut pas non plus les laisser mourrir dans une logique malthusienne. »
Si vous voulez les soigner, vous les soignez. Si vous voulez les loger, vous les logez. Si vous voulez les embaucher, vous les embauchez. Si vous ne voulez pas les laisser mourir, vous les nourrissez, etc.
Comme souvent l’État parvient à « résoudre » une situation sans problème en en créant deux d’un coup : m’interdire d’accueillir des gens que je veux accueillir, et m’obliger à accueillir des gens que je ne veux pas accueillir.
Zut, je suis bon pour le point Godwin…
Pendant la rafle du Vel d’Hiv et après, personne ne voulait accueillir, protéger, nourrir et soigner certaines personnes.
Le peu qui l’ont fait se sont heurté à l’Etat mais aussi aux autres concitoyens qui étaient assez libres en fait. Libres d’être hostiles ou indifférents.
On reconnait l’académicien avec un texte aussi long qui ratisse trop large pour .
Pourquoi ne pas simplifier tout ça?
La nation est une grande maison. L’état est le système de décisions collectives à l’intérieur de la maison.
La nation est l’assemblée des actionnaires, l’État est le conseil d’administration de la corporation. L’état peut s’approprier la nation comme les membres du conseil d’administration peuvent détourner la corporation à leur propre avantage au détriment des actionnaires.
Le problème c’est pas l’État. Le problème c’est la gouvernance de l’État. Dans une démocratie par représentation, comme dans une démocratie participative ou tout autre système de décisions collectives, pour toute forme de société, il s’agit toujours d’un problème principal-agent.
« La nation est une grande maison. L’état est le système de décisions collectives à l’intérieur de la maison. »
Non merci. Chez moi ce n’est pas chez vous!
Donc nos maisons sont séparées. Construisez la vôtre et faites-y régner les lois qui vous chantent.
Et soyez heureux si quelqu’un daigne de vivre volontairement avec vous.
Excellent exposé, fouilé et argumenté, qui mériterait une synthèse dans un second article.
Le problème des aides sociales de tous bords mises à disposition des migrants est délicat, vaste, et concerne également une part notable de notre propre population autochtone.
Encore une fois l’intervention idéologique de l’Etat dans un domaine dans lequel il n’est pas légitime (l’aide universelle contre toute la misère du monde) compromet l’avenir des habitants et de la société, et donc de la Nation.
C’est vicieux et insoluble.
Pour les migrants actuels, il semble que bon nombre ne souhaitent pas spécialement s’implanter en France, ce qui pose une nouvelle question : pourquoi, avec toute cette perfusion d’aide publique veulent-ils malgré tout aller en Angleterre ?
« Comment pourrait-on défendre le libre-échange, c’est-à-dire la libre circulation des marchandises et s’opposer par la force au libre mouvement des hommes ? »
L’auteur répond lui-même, longuement, dans l’article.
Il n’y a aucun rapport entre circulation des marchandises et des hommes.
Car les hommes circulent chez les autres à condition de leur demander la permission, alors que les marchandises sont livrées chez celui qui les a commandées à sa demande.
PS a tort de reprendre une formule qui amalgame ces deux réalités qui n’ont rien de commun.
Concrètement, cette permission serait demandée à qui exactement ?
Texte remarquable tant par sa forme, emprunte de l’esprit de tolérance du libéralisme, que sur le fond de l’argumentation, rigoureuse et cohérente. Enthousiasmant.
Les commentaires sont fermés.