Par Éric Verhaeghe.

Dans la grande œuvre entreprise en 1945, dont l’un des résultats majeurs fut d’uniformiser et de déresponsabiliser la société française, l’invention de la branche vieillesse constitue probablement l’exemple le plus remarquable de la spoliation et de la prolétarisation asymptotique dont les classes moyennes ont été victimes au nom de la solidarité, de la protection contre le risque et autres mots gorgés de bonnes inventions et pavés de mauvaises réalisations.
D’emblée (ou presque) déficitaire, rappelons-le, le régime général inventé en 1941 par le gouvernement de Vichy et élevé au pinacle par le Conseil National de la Résistance, défendu depuis avec acharnement par tout ce que la gauche de la gauche comporte d’idéologues de la Révolution en chambre ou en cabinet, s’est transformé en immense piège pour tous les salariés ou indépendants qui ont cherché à gravir les échelons de la société.
Cette affirmation est d’ailleurs un lieu commun bien connu dès 1945, contre lequel la bureaucratie étatiste de la Sécurité sociale et ses différents suppôts ne cessent de lutter à force d’embrouillaminis, d’usines à gaz et de confusions sur le fonctionnement du système lui-même.
Pour mémoire en effet, dès 1946, les syndicats de cadres en France avaient refusé l’absorption de leurs intérêts dans le magma du régime général. L’année suivante, en 1947, ils signaient une grande convention collective jamais dénoncée depuis cette date, créant le régime complémentaire des cadres, mieux connue sous le nom d’AGIRC. L’objectif de cette négociation visait, bien entendu, à assurer aux salariés percevant une rémunération supérieure au plafond de la Sécurité sociale une retraite plus confortable que celle proposée par le régime général.
C’était à peu près la seule chose que les cadres pouvaient sauver du dispositif qui avait existé avant la guerre. Ils étaient en effet désormais astreints à financer un régime général dont ils seraient les principaux perdants, au nom de la solidarité. Leur ambition était de s’assurer au moins une retraite d’un niveau correct dont ils seraient les seuls financeurs.
À l’époque, les cadres firent le choix d’une retraite par répartition et par points. Ce système original permettait à chaque cotisant de constituer une sorte de capital individuel équivalent à une somme de points acquis par les cotisations, sans rompre toutefois avec la logique de répartition. Car, et c’était tout l’enjeu de cette convention collective, le système continuait à être financé par les actifs. La ruine du système financier était de toute façon telle, en France, à cette époque qu’un système par capitalisation n’aurait semblé sérieux à personne.
Dès la création de la branche vieillesse, il était donc évident pour l’ensemble de la société française que le régime général avait vocation à assurer un socle minimal qui ne suffisait pas à assurer un revenu de remplacement acceptable pour les salariés disposant de revenus moyens ou supérieurs. Il aura fallu soixante-dix ans de combat idéologique larvé pour faire oublier cette donnée initiale du système et pour convaincre les Français que l’organisation des retraites constitue un optimum indépassable.
Retraite et spoliation des classes moyennes
Une étude de 2012 a analysé de façon très pertinente et précise les taux de remplacement, c’est-à-dire la proportion entre le montant de la retraite et le dernier salaire, pour la génération née en 1942. Elle confirme ce que les cadres savent depuis longtemps : le taux de remplacement à la retraite diminue d’autant plus fortement que le salaire était élevé. Autrement dit, plus la rémunération perçue par le salarié est élevée, moins la retraite est élevée comparativement à ce salaire.
L’intérêt de l’étude d’Andrieux et Chantel est d’avoir comparé la retraite versée à cette génération avec le dernier salaire, mais aussi avec le salaire durant les avant-dernières années ou à 50 ans. Au fil des années, les carrières se sont faites moins linéaires, en effet, et beaucoup de salariés de plus de 55 ans ont connu des « incidents de carrière » émaillés de fortes baisses de salaires, voire de périodes longues de chômage qui rendent la comparaison entre la retraite et la dernière rémunération d’activité perçue très aléatoire. Il est donc plus honnête et sérieux, pour estimer la perte de rémunération due au passage à la retraite, de se référer à « l’âge d’or » du salarié, connu vers 50 ans.
Andrieux et Chantel ont constitué un formidable « nuage de points » qui montre bien la dispersion des taux de remplacement selon la rémunération. En partant d’une moyenne de taux de remplacement dit « micro », c’est-à-dire calculé à partir des montants réellement perçus par les retraités (cette moyenne se situe à 74,3 % du salaire perçu deux ans avant de partir à la retraite), on peut estimer que les taux de remplacement varient de 44 % à 134 %. Autrement dit, certains retraités perçoivent une pension inférieure à la moitié du salaire qu’ils percevaient deux ans avant de partir à la retraite, alors que d’autres augmentent leurs revenus d’un bon tiers.
En étudiant les relations entre le taux de remplacement et la tranche de salaire perçu deux ans avant le départ à la retraite, Andrieux et Chantel montrent par exemple que les salariés hommes nés en 1942 ont bénéficié d’un taux moyen de remplacement de près de 90 % lorsqu’ils gagnaient moins de 1500 euros deux ans avant leur départ à la retraite, et de 61 % lorsqu’ils gagnaient plus de 4000 euros. Pour les femmes, la discrimination est encore plus forte. Celles qui, nées en 1942, gagnaient moins de 1000 euros touchaient une retraite égale à leur salaire, alors que celles qui gagnaient plus de 4000 euros percevaient une retraite seulement égale à la moitié de leur salaire. Il faut aller dans le secteur public (nous y reviendrons ultérieurement) pour trouver des scores plus favorables.
Autrement dit, pour un même euro cotisé par un salarié, le produit perçu à la retraite est très différent : il rapporte à peu près un euro pour les salaries inférieurs à 1500 euros, mais seulement cinquante centimes lorsque le salaire triple. Ce chiffre inclut, bien entendu, les pensions versées par les régimes complémentaires. Agirc ou pas, les cadres sont donc les grands perdants de la retraite par répartition telle qu’elle fut conçue au sortir de la guerre. Ils contribuent en effet à un système où leur cotisation ne vaut pas exactement celle des non-cadres.
Des raisons techniques expliquent ces discriminations. Elles sont l’héritage du système antérieur à la guerre qui avait initialement plafonné les rémunérations ouvrant droit au calcul de la retraite. Lorsque le brillant CNR a élargi ce système à toute la population, il s’est contenté de poser la règle d’obligation sans rebattre les cartes de la méthode de calcul. Les cadres ont donc commencé à cotiser à un système qui ne prenait en compte qu’une fraction limitée de leur salaire. Par la suite, les aménagements à la règle n’ont jamais été suffisamment ambitieux pour rendre le régime plus équitable.
Cette iniquité a bien entendu toujours correspondu à une volonté plus ou moins avouée : celle de limiter la retraite à une fonction de solidarité, sans s’ouvrir à une logique de remplacement équitable des revenus. On peut comprendre pour quoi, même si cet objectif propre au système mis en place en 1930 (et avant) mériterait sans doute d’être mieux exposé aux assurés et d’être discuté clairement. L’une des difficultés provient des évolutions successives du système qui ont aggravé cette inégalité, pour tourner à la spoliation en bonne et due forme.
L’allègement de charges ou la double peine des cadres
Dans les années 1990, les économistes ont constaté que la France subissait (et c’était sa spécificité dans le monde industrialisé) un chômage particulièrement intense pour les bas salaires. L’une des explications données au phénomène tenait au coût du travail non qualifié : le coin socio-fiscal comme on dit, c’est-à-dire en particulier les cotisations sociales, pénalisait la compétitivité des salariés français aux coûts les moins élevés, sachant que la mise en place d’un salaire minimal constituait une rigidité forte empêchant de diminuer les coûts. Les exemples analysés par ces experts sont devenus de véritables truismes : les pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon coûtant beaucoup plus cher que leurs voisins de Terre-Neuve, le plombier polonais, l’ouvrier agricole des Antilles comparé à celui de Saint-Domingue, etc.
Dans l’entourage des ministres successifs (de droite comme de gauche), une idée s’est alors peu à peu sédimentée pour forger le socle d’une politique durable : il faut baisser le coût des bas salaires par des allègements de cotisations pour diminuer le chômage en France. Les circonstances politiques de cette idée sont à relever : celle-ci est devenue une sorte de dogme dans la technostructure énarchique. Pour régler le problème de l’emploi propre aux salariés peu qualifiés, il ne fallait surtout pas poser à plat la question du bien-fondé des cotisations sociales ou des taxes diverses pesant sur le travail et sur leur utilité. Il fallait contourner l’obstacle en ne touchant pas aux dépenses sociales, mais en pratiquant des baisses ciblées de cotisations sur les bas salaires et en recourant à de nouveaux types de recettes pour compenser ces baisses.
Progressivement, s’est donc mise en branle une machine extrêmement complexe qui a connu des moments extraordinaires. Par exemple, dès 1995, le ministre du Travail Robien propose des allègements de cotisations aux entreprises qui procèdent à des recrutements en contrepartie d’une réduction de leur temps de travail. Ce mécanisme servira de modèle technique à Martine Aubry, quelques années plus tard, pour imposer une réduction du temps de travail appelant elle-même de nouveaux allègements de charges.
On le voit, de la loi Robien au pacte de responsabilité de François Hollande, la politique est la même, fondée sur la même certitude : il ne faut pas réformer l’offre sociale, il faut seulement bidouiller son financement en compensant des pertes de recettes sur le travail par de nouveaux circuits, regroupés sous le terme générique de « transferts de l’État ». Cette expression aseptisée désigne l’ensemble des mesures budgétaires qui permettent à la Sécurité sociale de vivre au-dessus de ses moyens malgré les baisses de cotisations rendues indispensables par le coût du travail en France. Avant la mise en place du pacte de responsabilité, le coût de ces mesures se chiffrait déjà, bon an mal an à 30 milliards d’euros. Comme le dispositif est extrêmement complexe, les auteurs ne sont d’ailleurs pas forcément d’accord sur le montant exact de cette politique.
Cette opération de maquillage permet de donner à certains Français, et singulièrement à ceux qui perçoivent le moins de revenus d’activité (et la part la plus importante de revenus sociaux), le sentiment que rien ne change pour eux, sans avouer clairement aux autres qu’ils paient beaucoup plus qu’ils ne le devraient si la Sécurité sociale respectait les règles du jeu. Mais, en sollicitant l’impôt, c’est-à-dire majoritairement les classes moyennes, l’État donne l’illusion que la Sécurité sociale est à l’abri du temps et de ses atteintes. C’est très bon pour la paix sociale.
À titre d’exemple, en 2015, pour le seul régime général de retraite (la fameuse CNAV créée en 1941…), sur un total de 90 milliards de recettes propres, l’État a pris en charge 1 milliard de cotisations, et a apporté près de 15 milliards de transferts divers. Parmi ceux-ci, on notera 3,6 milliards de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et des placements, et 7,5 milliards de taxes sur les salaires. Pour reformuler ces chiffres autrement, il faut donc dire qu’une retraite mensuelle de 1000 euros est aujourd’hui financée avec environ 200 euros provenant de ressources autres que les cotisations des salariés.
Il est intéressant de chercher l’origine de ces 200 euros. Là encore, techniquement, 150 euros proviennent d’une taxe sur les salaires (inventée par François Fillon en 2003), qui pèse essentiellement sur les professions libérales, les propriétaires fonciers, ou les sociétés immobilières. Les 50 euros restants proviennent de la CSG sur les revenus financiers des Français qui mettent de l’argent de côté pour préparer leur retraite. Dans les deux cas, ce sont majoritairement les classes moyennes qui financent, par la fiscalité, le prix de l’illusion sociale française.
Ces chiffres n’intègrent bien entendu pas le coût des retraites versées au titre du minimum vieillesse, c’est-à-dire de la solidarité. Ces retraites, qui pèsent sur le Fonds de Solidarité Vieillesse (et qui devaient être les seuls volumes proprement « solidaires » et non contributifs du régime général) coûtent chaque année un gros 20 milliards d’euros, dont les trois quarts seulement sont financés. Les 16 milliards d’euros de recettes du FSV proviennent essentiellement de la CSG, c’est-à-dire, là encore, des classes moyennes.
Au total, sur une dépense globale pour les seuls régime général et FSV de 110 milliards annuels, près du tiers des ressources provient aujourd’hui d’un impôt majoritairement acquitté par les classes moyennes. En ce sens, il y a bien double peine : non seulement les retraites perçues par celles-ci remplacent beaucoup moins efficacement les salaires perçus pendant la période d’activité, mais ces salaires servent aussi à financer les retraites les moins élevées, du fait des allègements de cotisations pratiqués sous 1,6 SMIC pour lutter (sans succès) contre le chômage des moins qualifiés.
Les compensations de l’État ou la triple peine des classes moyennes
Il y aurait long à dire, ligne par ligne, sur le sens politique et « sociétal » des mesures très techniques décidées par l’État pour compenser les pertes de recettes de la Sécurité sociale due à l’inopérante politique de réduction de cotisations sur les bas salaires. On retiendra ici une seule mesure emblématique : l’affectation du produit de la CSG sur les revenus du patrimoine à la caisse vieillesse.
Politiquement, il est toujours populaire et même populiste, en France, de désigner à la vindicte collective les horribles bénéficiaires de revenus du patrimoine. Prononcer le mot garantit déjà la popularité de la mesure punitive qui est prise, même si, en l’espèce, l’opération consiste à décourager les classes moyennes de se constituer un capital satisfaisant pour des jours rendus difficiles par une retraite défavorable. Chacun sait la vision sociale sous-jacente qui est portée dans ces discours : il faut punir ceux qui cherchent à sortir de leur condition en gagnant un peu d’argent. Entre l’aristocratie et le petit peuple, point de niveau intermédiaire.
Pourtant, l’affectation de ce produit pose un véritable problème quant au sens lui-même de la Sécurité sociale.
D’un côté, il est acquis aujourd’hui que la contribution sociale généralisée est « sanctuarisée » : elle doit servir à financer la Sécurité sociale, et rien d’autre. Ce choix est cohérent, même s’il soulève quelques questions de finances publiques, obscures pour les Français mais pourtant fondamentales dans notre histoire institutionnelle, sur la non-affectation des recettes. Mais supposons…
Il n’en reste pas moins que, lorsque le pharmacien, l’avocat, le dirigeant d’entreprise, le directeur commercial, liquide son portefeuille d’actions vers 45 ans pour acheter une maison ou un appartement, il paie une contribution sociale généralisée de 8,2 % (ce qui n’est pas rien). Le problème tient à la contrepartie de ce versement : elle est, en termes de droits, totalement nulle. S’acquitter d’une contribution en faveur du régime vieillesse n’ouvre aucun droit spécifique à la retraite.
Dans un système de Sécurité sociale entièrement fiscalisé, cette absence de contrepartie ne pose pas problème. La difficulté apparaît lorsque le système est mixte, c’est-à-dire lorsqu’il est aussi financé par des cotisations qui ouvrent des droits dits contributifs. Dans ce cas, en effet, le système introduit un fort élément d’iniquité qui, dans le cas français, illustre bien les ambiguïtés fondatrices de la Sécurité sociale.
Ainsi, lorsque l’assuré verse un euro de contribution au régime vieillesse, il ouvre droit à une contrepartie : le versement d’une retraite. En revanche, lorsqu’il le verse au titre de la contribution sociale généralisée ou de l’impôt (par exemple la taxe sur le tabac), il n’ouvre droit à aucune contrepartie. Cette asymétrie est particulièrement choquante lorsqu’elle concerne un impôt universel inventé pour financer la Sécurité sociale (la CSG) : pour quelle raison dans un cas l’assuré ouvre-t-il des droits, et dans un autre n’y ouvre-t-il pas droit ?
Si l’on admet l’hypothèse que la CSG pèse majoritairement sur les classes moyennes, cela signifie clairement que celles-ci ont vocation à payer sans contrepartie, simplement parce qu’elles ont « un peu d’argent », alors que ceux qui en ont moins peuvent bénéficier du système avec des droits pleins. Une fois de plus, on retrouve l’aversion française pour la réussite sociale, pour ceux qui, à la force du poignet, s’élèvent dans l’échelle sociale. Mais on voit mal comment, dans ce cas d’espèce, le consentement au système pourrait durer.
Pacte de responsabilité et spoliation des classes moyennes
Au passage, il serait évidemment naïf de limiter la spoliation des classes moyennes par la fiscalisation partielle des recettes (mais pas des droits) au seul régime vieillesse. L’ensemble des branches de la Sécurité sociale donne lieu à ce genre de truandages discrets qu’un imposant rideau de fumée législative permet de dissimuler au grand public. Le pacte de responsabilité, qui constitue le point d’orgue de cette logique politique à l’œuvre depuis plus de vingt ans, en produira encore quelques exemples.
Ainsi, pour financer la promesse (floue, car mêlant les économies réelles et les anticipations) de baisse de 50 milliards d’euros de charges, le gouvernement a déployé un arsenal de mesures tout à fait saisissantes. Pour la seule année 2015, l’État apportera aux régimes de Sécurité sociale la bagatelle de 9 milliards de transferts, selon une logique de saupoudrage qui rend le financement du système totalement opaque pour le commun des mortels. L’assurance maladie recevra par exemple 2,36 milliards de l’affectation au régime général du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital. L’assurance vieillesse recevra près de 600 millions du prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés. La caisse nationale des allocations familiales recevra près de 5 milliards du transfert au budget de l’État de la fraction d’APL qu’elle finançait auparavant.
Ces quelques exemples suffisent à montrer que la spoliation par l’impôt fait florès dans une organisation qui a tout de l’usine à gaz. Le degré de complexité auquel la machinerie sociale française est parvenue pose d’ailleurs une question de fond : le moment ne vient-il pas d’engager une réflexion sur son financement et sur son fonctionnement, plutôt que de multiplier les rustines de toutes parts dont la pertinence n’est plus claire pour personne ?
Dans tous les cas, on voit bien aujourd’hui que le respirateur artificiel sous lequel la Sécurité sociale est placée ne fonctionne plus que grâce au moteur d’urgence d’une fiscalité de plus en plus complexe où les classes moyennes sont les grandes contributrices nettes d’un modèle social dont elles tirent un profit très limité. En réalité, la Sécurité sociale s’est, au fil des ans, transformée en un puissant levier de transfert de richesses des classes moyennes vers les plus démunis, en évitant soigneusement, nous y reviendrons, de toucher aux intérêts supérieurs du dernier centile de revenus, et de cette noblesse nouvelle qu’on appelle la fonction publique.
Les classes moyennes prisonnières de la Sécurité sociale
Malgré les écrans de fumée multipliés depuis 20 ans devant le grand public pour dissimuler la complète perte de sens de la Sécurité sociale, une prise de conscience se produit peu à peu parmi ceux qui invoquent notamment la liberté de sortir de la Sécurité sociale. Si ce mouvement contrevient aux principes de fond posés par le droit européen en matière de protection sociale (qui sont forcément des systèmes obligatoires), il révèle l’ampleur du refus aujourd’hui, dans les classes moyennes, et notamment chez les entrepreneurs, face à un système coûteux, aux performances faibles, et surtout aux injustices criantes.
Dans le cas de la retraite des classes moyennes, le système est évidemment d’autant plus troublant que la technostructure étatique a transformé la Sécurité sociale en une sorte de bagne dont il est impossible de s’échapper, à moins d’un exil très précoce à l’étranger. Cette captivité est d’autant moins satisfaisante que nos voisins européens ont pour la plupart opté pour des systèmes beaucoup plus équilibrés, ou ont choisi de réformer en profondeur leur système lorsqu’il s’approchait du modèle français.
Face au problème bien connu du faible taux de remplacement de revenu pour les cadres, l’État, en France, a multiplié les couches de barbelés pour empêcher cette population d’améliorer son sort. Alors que l’Allemagne a, par exemple, au début des années 2000, mis en place un système d’épargne-retraite d’entreprise obligatoire pour compenser les défauts de son système général, la technostructure française dresse un important tir de barrage, que le Conseil d’Orientation des Retraites a bien résumé dans une note de 2013 :
L’encouragement à l’épargne salariale (en partie orientée vers l’épargne retraite) via des exonérations de cotisations mérite examen, car cette épargne peut se substituer en partie au salaire direct et peser ainsi à terme sur le financement des régimes de retraite obligatoires, notamment sur les cotisations aux régimes complémentaires assises sur les tranches supérieures au plafond de la Sécurité sociale.
La rédaction ne peut pas être plus claire : permettre aux classes moyennes de se constituer une épargne retraite risque de peser sur le financement du régime général, dont elles sont les principales contributrices nettes. Il faut donc, pour préserver le modèle actuel, empêcher les classes moyennes de compenser les déséquilibres actuels du système.
Face à ce risque, le législateur français préserve donc savamment l’étrange économie de notre système actuel. Celle-ci repose essentiellement sur une exonération fiscale pour l’assurance-vie, qui est un système individuel et bâtard d’épargne-retraite, dont les principaux bénéficiaires appartiennent au dernier centile de revenus. Ce choix, abandonné par l’Allemagne il y a dix ans, fait évidemment plaisir aux assureurs, qui thésaurisent l’équivalent de la dette publique en contrats d’assurance-vie. Pour l’ensemble de la protection sociale française, ce choix pose un problème politique essentiel : les classes moyennes peuvent-elles durablement accepter un système de Sécurité sociale qui contribue à leur prolétarisation?
Les esprits malicieux auront noté que le principal risque de l’épargne retraite obligatoire porte sur l’avenir du régime complémentaire né de la convention collective de 1947, et entièrement piloté par les partenaires sociaux. C’est le paradoxe de notre époque : pour sauver l’AGIRC, présidée à parité par le MEDEF et par la CFDT, il faut brimer les salariés qui ont échappé au SMIC et qui ont progressé dans l’échelle sociale.
Ce sont bien aujourd’hui deux France qui s’affrontent : celle qui veut préserver un amortisseur obsolète en imposant une étouffante égalité, et celle qui veut progresser en reconnaissant le principe de responsabilité.
Sarkozy ou l’occasion manquée de la liberté et de la responsabilité
Chacun conservera un souvenir cuisant, en matière de retraite, du passage de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, mal entouré par une cohorte de conseillers énarques dont la principale préoccupation a consisté à étouffer toute possibilité de rétablir une équité dans le système français de retraite. Certes, la crise de 2008 n’a pas créé les conditions optimales pour « renverser la vapeur », mais il n’a pas fallu beaucoup pousser l’entourage présidentiel pour faire le choix minimaliste d’un statu quo général du système qui a reporté d’autant toute possibilité de revenir sans heurt majeur à un dispositif plus respectueux des droits de chacun.
Rappelons ici que, lorsque Nicolas Sarkozy est élu, l’impossibilité de maintenir dans la durée le système existant en matière de retraites est connue de tous (et se reposera dans les mêmes termes à l’arrivée de François Hollande).
Deux problèmes majeurs sont soulevés :
- d’une part, l’impossibilité d’allonger l’espérance de vie sans allonger la période d’activité et de cotisation (problème de bon sens absurdement nié par la gauche de la gauche mais traité par la loi Fillon de 2003)
- d’autre part, la dégradation constante du niveau de retraite, spécialement pour les cadres dont le taux de remplacement devrait chuter à 40 % à l’horizon 2030.
Dans la pratique, la majorité de Nicolas Sarkozy fit le choix de ne traiter que le premier problème en imposant des mesures attendues, comme l’allongement de la durée de cotisation et le relèvement de fait de l’âge de la retraite. En revanche, le second problème est occulté, puisqu’aucune réforme systémique n’est menée.
Pourtant d’autres modèles existent, comme le modèle suédois qui cristallise les attentions à cette époque.
En Suède, l’État a fait le choix courageux de passer à un système notionnel qui rend à chacun la liberté de piloter comme il l’entend sa retraite. Intellectuellement, le système suédois n’est pas très éloigné du système français mis en place en 1947. Il consiste à cumuler, tout au long de la vie, des « points de retraite » qui sont comptabilisés individuellement. L’État peut imposer un seuil minimum de points pour avoir le droit de liquider sa retraite. Toutefois, c’est le salarié qui choisit le moment où il liquide son compte : libre à lui d’arbitrer, passé un certain âge (par exemple 55 ans) entre la conversion de son compte en une rente longue mais de faible montant, ou une rente plus courte (parce qu’il part à 65 ans au lieu de 55, par exemple) mais d’un niveau plus important.
L’intérêt de ce système est double :
- d’une part il repose sur la responsabilité de chacun. Certains veulent arrêter de travailler tôt, se retirer à la campagne et vivre une vie tranquille mais heureuse. Pourvu qu’ils disposent du minimum vital, le système leur convient. D’autres veulent arrêter plus tard mais voyager, profiter, consommer avant de mourir ou de devenir dépendants. Le système suédois permet de combiner les différents choix de vie. Il renvoie chacun à ses choix individuels, à l’opposé du système français qui oblige chacun à cotiser dès que possible et interdit à chacun de partir à l’âge qui lui convient.
- d’autre part il est extrêmement simple à comprendre. Chacun mesure la somme des points qu’il engrange en cotisant, et il ne perçoit que ce qu’il a épargné, sauf système de solidarité spécifique à certaines catégories bien entendu. Il répond parfaitement à l’objectif « d’éducation » que la Sécurité sociale a toujours poursuivi, officiellement en tout cas, depuis 1945.
Force est de constater que la responsabilité et la simplicité n’ont pas constitué des objectifs majeurs dans la politique qui fut menée depuis 2008…
—





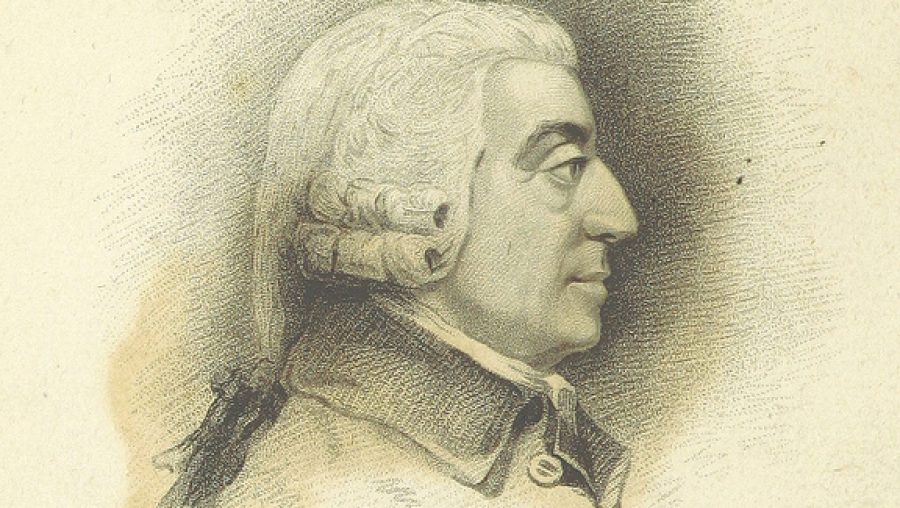
Belle analyse!
L Énarchie est une calamité pour notre pays!
La gauche, un parasite social
Les 35h, l obscurantisme avéré
L exception culturelle française, une tare indélébile !
65 millions d habitants face aux 7,2 milliards habitants pour la planète !
La déraison schizophrène !
FHOLLANDE la nullité
Comme tout système de gauche, c’est une forme cachée d’esclavagisme, où les personnes capables et entreprenantes sont au service des médiocres, et des larbins de l’Etat.
le problème de la retraite est dingue , on joue en permanence sur les durées au lieu de jouer sur la cotisation et on refuse la capitalisation sauf aux nantis . on est vraiment dans un pays de fous furieux ou d’escrocs car la retraite est une escroquerie d’état où par exemple , on considère que les cotisations retraites d’un couple ne donne pas droit au survivant à la retraite entière cotisée , séparer pour mieux voler
Une excellente synthèse des maux du modèle social français que personne, mais alors personne, ne nous envie.
On savait la SS au mieux inutile mais il apparaît qu’elle est surtout nuisible, le pire étant qu’elle a été bâtie patiemment dans ce but exclusif. Le caractère néfaste de la SS ne résulte pas d’une malencontreuse succession d’erreurs mais d’une entreprise volontaire de spoliation et d’appauvrissement de masse, planifiée sur plusieurs décennies, peu importe les élections, peu importe les décisions de la population, peu importe la démocratie. La SS est parfaitement contraire à la démocratie et aux valeurs de la République. Son démantèlement jusqu’au dernier centime volé est un impératif catégorique pour la Nation française.
Tres bel article. Imaginez donc ceux qui ont une retraite par taxation remettre en cause leur retraite dans une refonte générale?
Francois Hollande est champion du monde toutes catégories de cumuls de retraites de régimes spéciaux….Il touchera entre 5 et 10 retraites et aucune par répartition….N’imaginez pas que Hollande ou le vice champion du monde d’accaparation sociale Juppé changent les choses…
D’un point de vue mathématique, la distribution des revenus (bruts avant redistribution) suit fatalement une courbe de Gauss. Cela signifie que le gros des effectifs et donc l’essentiel des ressources et de la consommation (à ne pas confondre avec le capital immobilisé) se situe dans la classe moyenne. La redistribution va donc consister essentiellement à l’aplatissement de la courbe de Gauss. Mais du fait de l’impossibilité de ponctionner les vrais riches proches du pouvoir (même socialiste), et du fait des effets de bord sur l’économie je pense qu’on arrive inéluctablement à transformer une courbe de Gauss en exponentielle.
Cela montre que les socialistes sont balaises en mathématiques !
Sur la distribution des revenus, c’est typiquement une loi log-normale ou Pareto en fait, pas une normale (la positivité des revenus empêche l’utilisation de la gaussienne). Cet article pas très récent (1972) reste intéressant: http://www.ehess.fr/revue-msh/pdf/MSH_1972__39__37_0.pdf
Wikipedia donne deux autres références: notes 20 et 21 de http://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution
N’étant pas encore en retraite je manque de temps pour lire et comprendre cet article.
J’ai juste compris que pour ma future retraite le fait d’être fonctionnaire est une bonne nouvelle.
oui, pour l’instant, et jusqu’au dernier moment, sans doute.
mais après ?
je ferai tout ce qu’il faudra pour inciter mes 5 enfants à quitter la france, ils ne payeront pas pour vous. à un moment, ça ne se passera pas comme les politiciens vous le promettent.
Jabo, par contre le reste de la population doit payer l’éducation (7500€/enfant/an), la santé, les allocs…à vos enfants
et gnagnagna…
alors déjà, les allocations de mes enfants, c’est mon patron qui les paye, pas la caf.
quand au reste, c’est à croire que je n’ai jamais payé d’impôt ? non mais on croit rêver ?
si la population ne voit pas que le système est mauvais et qu’il faut en changer, tant pis pour elle , elle payera pour l’éducation de jeunes qui s’enfuiront hors de cette prison de guimauve et de vivrensemb kelemondentiénouzenvy sans en récolter les fruits.
Relativement, oui, comparé aux autres qui se font enfumer… Mais dans l’absolu, cela pourrait être aléatoire.
On ne gagne pas à tous les coups au casino…
Vous serez sûr(e) d’avoir une retraite mais la taille de votre part de gâteau n’est pas garantie, çà risque plutôt de ressembler à des miettes. Alors, vieux et miteux ? Avenir radieux ….
Cet article est très intéressant. Mais il passe à côté de l’essentiel, à savoir qu’il existe en tout et pour tout deux grands systèmes de retraite :
1) le système basé sur la propriété privée, qui est le seul système pacifique, et qu’on appelle aussi retraite par capitalisation libre, ou encore assurance vie;
2) le système basé sur l’extorsion de fonds suivie du partage du butin, qui est basé sur la violence, et qui a tous les défauts des systèmes basés sur la violence, et qui a notamment pour effet d’encourager la guerre de tous contre tous. Ce système prend différentes formes, comme la retraite par capitalisation obligatoire, la retraite par répartition à prestations définies, ou la retraite par répartition à cotisations définies. Souvent, malheureusement, on se perd dans des discussions byzantines pour étudier les mérites ou les défauts de ces trois formes de systèmes de retraite, sans voir que ces différences sont insignifiantes comparées à ce qui les sépare de la vraie retraite basée sur la propriété privée et la paix publique.
« […] une prise de conscience se produit peu à peu parmi ceux qui invoquent notamment la liberté de sortir de la Sécurité sociale. Si ce mouvement contrevient aux principes de fond posés par le droit européen en matière de protection sociale (qui sont forcément des systèmes obligatoires), […] »
Le mouvement en question ne contredit en rien le principe de fond posé par le droit européen en matière de protection sociale, il en réclame simplement l’application…
Les états membres sont libres d’organiser leur protection sociale (santé, retraite, prévoyance, chômage… ) comme ils l’entendent:
– soit sous la des régimes dits « légaux », c’est à dire s’appliquant à l’identique pour toute la population, pour lesquels le monopole est autorisé, forme dont le régime des allocations familiales était – jusqu’à la récente discrimination sur le revenu – le seul représentant dans notre pays, bien qu’il soit tout de même délivré – à l’identique – par au moins deux organismes: la CAF et la MSA.
– soit sous la forme de régimes dits « professionnels », forme qui constitue l’essentiel de la protection sociale à la française, auquel cas la concurrence est de mise. De plus les organismes fournissant ce type de prestations doivent être constitués sous forme de mutuelles, de société d’assurances, ou d’organismes de prévoyance (de mémoire).
Par ailleurs, la cour de justice de l’UE a clairement énoncé qu’un régime de sécurité sociale, quand bien même légal, n’en est pas moins soumis au droit de la consommation (donc contrat, absence de pratiques commerciales agressives, et in fine… concurrence), ce qui malgré les réfutations multiples des organismes français a été confirmé récemment par la cour de cassation.
L’autre question que l’on pourrait se poser est, dans l’hypothèse ou prendre une autre assurance serait illégal, pourquoi la principale société d’assurance fournissant une couverture maladie aux libérés de la sécu n’a donc jamais été inquiétée ?…
Excellent !
Les commentaires sont fermés.