Par Lawrence W. Reed.
Demandez à la plupart des Américains l’origine du slogan “Pas de taxation sans représentation !” et ils vous répondront probablement que les colons américains ont protesté contre la Grande-Bretagne dans les années 1760. Mais l’esprit, si ce n’est la lettre précise de cette phrase, remonte à plus d’un siècle. En outre, nous pouvons remercier les Britanniques eux-mêmes.
Tout a commencé avec ce que l’on appelle la “taxe sur les navires”.
Depuis le début du Moyen Âge, la coutume anglaise permettait au monarque d’imposer, en temps de guerre, une taxe spéciale aux citoyens vivant dans des localités côtières. Ceux-ci pouvaient satisfaire à cette exigence en fournissant des navires, des matériaux de construction navale ou de l’argent pour que la Couronne construise des navires (d’où le nom de “taxe sur les navires”). Les rois et les reines prélevaient cette taxe en tant que prérogative royale, ce qui signifiait qu’ils n’avaient pas à obtenir le consentement du Parlement, comme l’exigeait la Magna Carta de 1215.
Tant que l’impôt ne frappait qu’une petite partie de la population et uniquement en cas d'”urgence nationale”, la monarchie s’en est tirée à bon compte pendant des siècles.
Le roi Jacques Ier a provoqué un tollé en 1619 lorsqu’il a étendu la taxe sur les navires à Londres, mais c’est son successeur, Charles Ier, qui a déclenché un tollé bien plus important neuf ans plus tard. Il a fermé le Parlement et, en 1628, en temps de paix, il a imposé la taxe sur les navires à tous les comtés d’Angleterre. C’était une taxe pour tout le monde, et personne ne pouvait rien y faire. Les années suivantes, le roi la réaffirme et l’augmente face à une opposition féroce et croissante.
C’est le cas de John Hampden, un propriétaire terrien du Buckinghamshire élu pour la première fois au Parlement en 1621. Lorsqu’il refuse de payer le solde de la taxe sur les navires réclamée par le roi, l’affaire est portée devant les douze juges de la Cour de l’Échiquier. Hampden et ses avocats soutiennent que le roi n’a pas le droit de prélever la taxe sans l’approbation du Parlement.
Bien que Hampden perde l’affaire par 7 voix contre 5, Charles Ier est gêné que sa mince victoire. Lorsque la guerre civile anglaise commence en 1642, John Hampden est l’un des premiers que le roi tente d’arrêter, sans succès. La question pour laquelle il a pris le risque de défier le roi, à savoir l’imposition sans représentation, s’est révélée être l’une des principales causes de cette guerre.
Hampden est mort au combat en 1643, six ans avant la décapitation de Charles Ier. Près de quatre siècles plus tard, Hampden est considéré comme un martyr de la liberté et son nom est honoré de manière éponyme par de nombreuses villes et institutions. Le Hampden-Sydney College en Virginie en est l’un des nombreux exemples.
James Otis, du Massachusetts, est généralement considéré comme le premier Américain à avoir appliqué le principe “pas de taxation sans représentation” dans la perspective de la Déclaration d’indépendance. En 1764 il écrit : “l’acte même de taxer, exercé sur ceux qui ne sont pas représentés, me semble les priver de l’un de leurs droits les plus essentiels en tant qu’hommes libres ; et s’il est maintenu, il semble être en fait une privation totale de tout droit civil”.
Des patriotes épris de liberté comme John Hampden et James Otis sont entrés en guerre parce que leurs gouvernements osaient taxer sans le consentement des parlementaires élus. Autant la taxation sans représentation était mauvaise à l’époque, autant je parie qu’avec les taux actuels avec représentation, ils pourraient à nouveau faire du bruit.
—

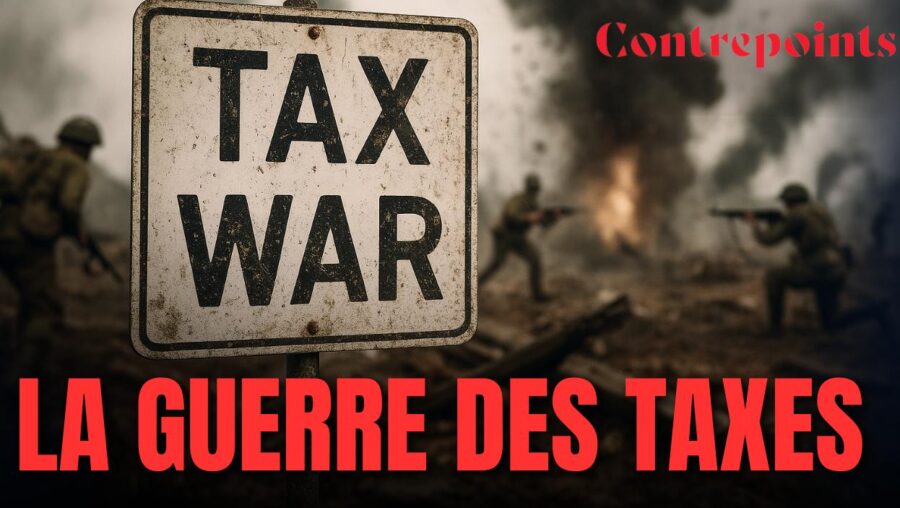


Excellent rappel et comme vous l’écrivez en conclusion la représentation française est médiocre car soumise à l’ »élu » immature et mal entouré d’énarque sans vue(s) prospective(s) mais accroché(s) à ce que l’ENA produit de mieux les réglementations, les dettes et les taxes (prohibitives pour ceux qui les paient)
Bonne journée
J’use pour ma part de la formule “qui paie est maître” et en tire la justification du suffrage censitaire, source d’une régulation (nécessaire) entre la politique et l’économie.
C’est à peu de chose près ce que nous connaissons dans le fonctionnement des sociétés par action, des copropriétés, etc.
Toute société tend à l’auto-régulation. Or le cens augmente le pouvoir de ceux qui en ont déjà beaucoup. Diminue celui de ceux qui en ont peu. Ça ne pouvait pas durer.
Vous êtes né deux siècles trop tard.
Remis au goût du jour par les Femen.
Toute loi décidée contre nous sans nous est illégitime.