Le Parti Communiste Chinois (PCC) mène depuis plusieurs années une répression terrible envers les Ouïghours de la région du Xinjiang, laquelle peut être qualifiée de génocidaire quand on prend en compte les atteintes très sérieuses des droits de fonder une famille pour cette minorité ethnique.
En août 2022, un rapport rigoureusement documenté du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU dénonçait des « violations très sérieuses des droits humains » à l’encontre des Ouïghours et expliquait que l’étendue de leurs arrestations arbitraires dans un contexte « de restrictions et privations plus générales des droits fondamentaux, tant individuels que collectifs, peuvent constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité ».
Le PCC a répété à de multiples reprises que le travail forcé n’existait pas dans la région du Xinjiang. Mais un nouveau rapport publié dans le journal Communist and Post-Communist Studies à comité d’évaluation par les pairs fait la lumière sur cette pratique dans l’industrie du coton de la région du Xinjiang. Elle a continué au moins jusqu’en 2022 et fait partie du Plan quinquennal du PCC. Alors qu’il semble que les programmes de détention massive au sein de camps ont quelque peu diminué les années récentes, les programmes de travail forcé se sont, eux, intensifiés.
Étant donné la très grande difficulté de conduire des enquêtes de terrain dans le Xinjiang, le rapport utilise diverses sources de documentation : documents gouvernementaux de planification (comme les Plans quinquennaux), discours de membres importants du PCC, rapports d’implémentation, documents de budget étatiques, documents d’appel d’offres étatiques, articles de média locaux et de propagande, études académiques chinoises, documents ayant fuité des autorités locales (comme les Xinjiang Police Files) ainsi que des témoignages individuels.
Le travail forcé comme outil de « stabilisation » et de contrôle des Ouïghours
Contrairement au travail forcé dans d’autres régions comme l’Ouzbékistan où cette pratique vise à enrichir une élite corrompue, dans le Xinjiang, l’objectif est éminemment politique : les mesures extrêmement répressives du PCC dans le Xinjiang sont défendues comme un sujet de sécurité nationale de la plus haute importance pour l’État. Les Ouïghours sont représentés comme une « menace biologique ».
Dans un discours secret de 2014 et révélé en 2021, Xi Jinping notait qu’un grand nombre de personnes sans emploi peut « provoquer des problèmes » et que l’emploi est « bénéfique pour les interactions ethniques, les échanges et les mélanges », ce qui pousse les groupes ethniques à « se rapprocher de la culture chinoise » et donc à « résister aux pensées religieuses extrémistes ».
Yu Zhengsheng, alors chef du Central Committee Xinjiang Work Coordination Small Group, a ainsi expliqué que :
« Une série de mesures et exigences de soutien ont été proposées pour le développement des industries du textile et des vêtements, qui consiste à mener au moins un million de personnes vers l’emploi. Ce sujet est d’importance vitale pour la stabilité sociale et la stabilité de long terme du Xinjiang. »
Il en va de même pour Li Ningping, alors secrétaire du PCC dans la préfecture de Kashgar dans le Xinjiang :
« Certaines personnes n’ont rien à faire pendant de longues périodes. Sans travail, elles sont désœuvrées, et créent des problèmes pour un rien. Elles sont facilement incitées et séduites par des mauvaises actions par les « trois forces du mal » […] Si nous faisons du bon travail dans la lutte contre l’extrême pauvreté et si nous guidons les gens de tous les groupes ethniques vers une vie civilisée et moderne, ce sera une protection puissante contre l’extrémisme religieux. […] Donc, travailler dur pour lutter contre l’extrême pauvreté n’est pas seulement une question de gagne-pain, mais aussi de stabilité sociale ; c’est un problème économique autant que politique. »
Le 13ème Plan Quinquennal de Lutte Contre la Pauvreté du Xinjiang de Mai 2017 explique que « le travail, la volonté d’être employé et les aptitudes sont insuffisants » pour les personnes pauvres, et répète cinq fois que la « motivation intérieure » (neisheng dongli en mandarin) des autochtones est insuffisante et doit être « stimulée ».
Intensification des efforts pour forcer les Ouïghours vers les programmes de lutte contre la pauvreté
L’auteur du rapport analyse des nouveaux documents internes des autorités locales qui montrent que les efforts pour intégrer les Ouïghours par la force dans les programmes de lutte contre la pauvreté, y compris des transferts de travail forcés, se sont intensifiés après 2018. Ces documents de 2019 requièrent un renforcement du « statut politique » du travail de lutte contre la pauvreté, avertissant les cadres locaux des répercussions « sévères » si leurs objectifs ne sont pas atteints.
Ces documents énoncent les efforts à faire par les cadres locaux pour « empêcher l’insuffisance de motivation interne parmi les cadres et les masses » et exigent que « les personnes fainéantes, les alcooliques, et tout autre individu insuffisamment motivé » soient soumis à une « éducation de la pensée […] réitérée » jusqu’à l’obtention de « résultats évidents ». L’identité de ceux qui « n’ont pas atteint un emploi stable [et donc] doivent [s’engager] dans du travail saisonnier » doit être listée par le Bureau de l’Emploi de Lutte contre la Pauvreté, et ils doivent par la suite être orientés vers des travaux saisonniers, comme le ramassage de coton.
À la fin de 2019, le comté de Yarkand avait établi une liste de ces « personnes fainéantes », « alcooliques » et « sans motivation intérieure suffisante », y compris une personne de 77 ans cataloguée comme « fainéante ».
Dans un article pour le magazine Foreign Policy, le chercheur Adrian Zenz, auteur du rapport, explique que « en Chine de telles directives qui viennent d’en haut ne sont pas ignorées ». En effet, « tout comme avec la mise en œuvre très suivie des politiques zéro-covid en Chine, les pressions envers les fonctionnaires locaux sont sévères, et conduisent souvent à un excès de zèle et une mise en pratique brutale ».
Un recrutement des Ouïghours par la force
Dans le rapport à propos du travail forcé dans le Xinjiang, l’auteur insiste sur une distinction importante.
En effet, il appelle à bien faire la différence entre d’un côté le travail forcé au sein des « Centres d’Éducation pour les Compétences Professionnels et de Formation », un euphémisme pour désigner les camps de ré-éducation, et de l’autre les transferts forcés vers les travaux saisonniers de ramassage de coton liés au programme de Lutte contre la Pauvreté via des Transferts professionnels du Xinjiang.
Bien que les Ouïghours refusant de se soumettre aux politiques de lutte contre la pauvreté peuvent être menacés d’être envoyés vers les camps, les programmes de lutte contre la pauvreté disposent de leurs propres mesures coercitives. Le travail forcé dans le domaine de la récolte du coton est très largement lié à ce système plutôt qu’à celui des camps.
Les mesures coercitives se situent principalement à l’étape du recrutement. Comme l’explique le rapport, des « équipes de travail assignées à un village (zhucun gongzuodui en madarin) vont de porte en porte pour réunir des informations sur la situation professionnelle de chaque foyer et pour forcer les villageois vers des transferts de travail ».
Ainsi, dans un village de la préfecture de Kashgar où des officiers du PCC trouvèrent que les Ouïghours étaient « réticents à aller travailler », des cadres pénétrèrent dans chaque maison une seconde fois et entreprirent un « travail d’éducation » jusqu’à ce que 60 personnes aient été mobilisées pour aller récolter du coton. En septembre 2018, trois cadres du PCC réussirent à mobiliser 345 villageois autrefois réticents pour aller récolter du coton dans la préfecture voisine du Kashgar.
Un article publié en janvier 2020 décrit le cas du villageois ouïghour Er’eli Hekim qui a été « libéré » de ses idées problématiques « sérieuses » grâce à une équipe de travail assignée à son village.
Comme le note le rapport, les efforts de recrutement sont « caractérisés par des transferts très organisés avec une supervision rapprochée ». Un reportage de 2020 de la préfecture de Aqsu décrit ainsi que les récolteurs de coton sont orientés vers leur destination de travail à l’aide d’un « transfert de point à point ». Des officiers sont présents avec eux sur tout le parcours.
La mécanisation des récoltes de coton dans le Xinjiang
Après la publication des premières preuves de travail forcé systématique dans la région du Xinjiang en décembre 2020, le porte-parole du ministère des Affaires Étrangères de la République Populaire de Chine clama pour sa défense que « le taux de mécanisation de la récolte du coton dans le Xinjiang a atteint 70 % en 2020 ». En janvier 2022, le ministère des Affaires Étrangères est allé jusqu’à prétendre que « plus de 85 % » de la récolte du coton dans le Xinjiang était mécanisée, sans fournir aucune preuve.
Néanmoins, une analyse d’images satellites de la vitesse de récolte au printemps 2022 révélait qu’au moins 36 % des récoltes de coton du Xinjiang étaient réalisées à la main. Dans la région de Kashgar, le taux de récolte à la main était de 96 %.
Par ailleurs, malgré la mécanisation accrue, l’accroissement très rapide de la production de coton dans le Xinjiang nécessite davantage de ressources humaines. Lors des deux dernières décennies, les terrains de culture de coton ont le plus augmenté dans le sud du Xinjiang où la mécanisation est moindre, triplant de 574 200 à 1 605 900 hectares entre 2000 et 2020.
En outre comme l’explique le rapport :
« La mécanisation accrue ne réduit pas forcément le risque de travail forcé. Pour promouvoir la mécanisation, l’État promeut agressivement des mécanismes de transferts de terre où les agriculteurs locaux transfèrent leurs droits à des opérateurs de grande taille en échange de paiements de loyers. Les agriculteurs ouïghours déplacés sont souvent transférés par la force dans du travail en usine nécessitant une main-d’œuvre abondante. »
Le chercheur Adrian Zenz en conclut que « même là où le coton est récolté mécaniquement, sa production résulte souvent en davantage de travail forcé, pas moins ».
Le travail forcé dans le Xinjiang ne semble pas ralentir. Comme le note M. Zenz, dans le Plan quinquennal de 2016 à 2020, les documents exigent qu’au moins une personne par foyer doit travailler, souvent contre sa volonté. Le nouveau Plan quinquennal pour 2021-2025 ajoute une exigence de « plein emploi ». Tous ceux qui en sont capables doivent travailler.
En 2021, 400 000 cadres ont été envoyés dans la région du Xinjiang pour analyser les revenus de 12 millions de foyers ruraux via une campagne « de prévention précoce, d’intervention précoce, et d’assistance précoce » qui identifia 774 000 foyers pour une « surveillance en temps réel ». 2021 a marqué l’année où « le nombre de travailleurs transférés dans le Xinjiang a atteint un record à la hausse ».
L’évaluation du travail forcé
En 2022, la Chine ratifiait les conventions de l’Organisation Internationale du Travail. En 2012, l’OIT avait publié un ensemble de 11 indicateurs pour mesurer le travail forcé, y compris l’abus de faiblesse, les restrictions de mouvement, l’isolement, l’intimidation, les conditions de travail abusives, la violence, la servitude par la dette, et l’absence de salaire. Néanmoins comme l’explique le rapport :
« Ces indicateurs ont été construits pour mesurer le travail forcé dans les entreprises ou les secteurs économiques. La plupart sont mal adaptés pour évaluer les mécanismes clés de travail forcé organisés par des États, en particulier dans le Xinjiang où les objectifs gouvernementaux pour la mobilisation coercitive sont principalement politiques. »
En particulier, les critères de travail forcé de l’OIT sont mal adaptés pour évaluer la coercition étatique dans le Xinjiang, principalement lors des phases de recrutement des travailleurs.
L’auteur du rapport propose une nouvelle série d’indicateurs permettant d’identifier le travail forcé promu et organisé par un État. Ces indicateurs sont regroupés au sein de six phases :
- L’identification des besoins de travailleurs
- Le recrutement, basé sur des « campagnes intrusives de porte à porte » où les victimes subissent « une pression psychologique intense (« éducation de la pensée ») et des menaces latentes ou manifestes, y compris une potentielle détention dans un camp »
- La formation, durant laquelle les victimes subissent un « endoctrinement idéologique »
- Les transferts vers la destination de travail, rigoureusement organisés par l’État et avec la présence constante d’officiers gouvernementaux
- La gestion des travailleurs, supervisés et endoctrinés par des équipes de travail qui évaluent leur « état d’esprit » et les « motivent »
- La rétention des travailleurs avec une surveillance constante et une limitation de la liberté de mouvement
Contrairement à un travail forcé à visée économique, dans le Xinjiang les « conditions de travail des travailleurs transférés peuvent ne pas suffisamment relever de l’exploitation pour déclencher des alertes lors d’une inspection ». Il est donc essentiel d’adapter les critères de travail forcé de l’OIT si on souhaite lutter efficacement contre le programme massif de travail forcé promu par le Parti Communiste Chinois.
Les législateurs à travers le monde doivent lutter de manière déterminée et coordonnée pour dissuader cette pratique moralement répréhensible. Gageons qu’au sein du PCC les responsables de ces atteintes graves contre les droits les plus fondamentaux des Ouïghours seront le plus tôt possible arrêtées et jugées pour leurs crimes.


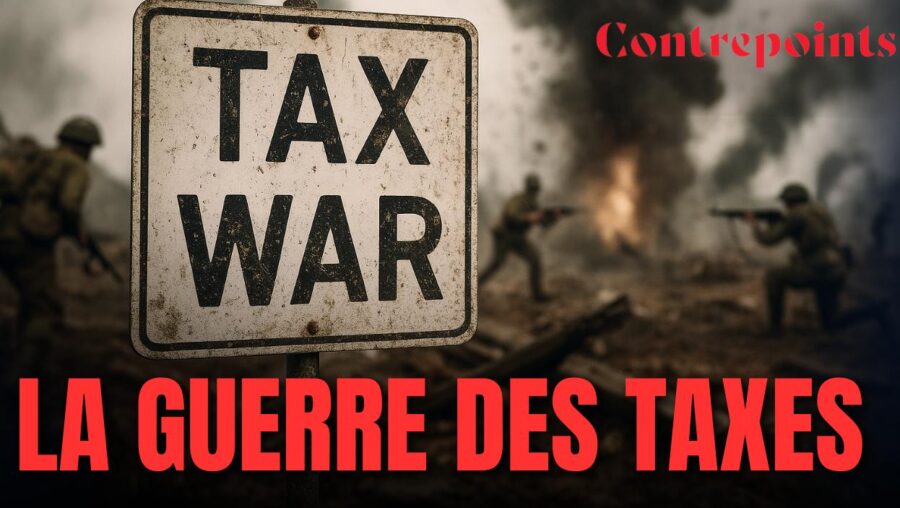


Faisons confiance à notre ami Erdogan qui avait fait de la cause des ouïghours une cause mondiale des musulmans en Chine. Sa grande nouvelle proximité avec la Chine ne peut que prouver qu’il a réussi à améliorer leurs sorts. Comme il n’en parle plus, c’est qu’il à bien travaillé et que les ouïghours sont très heureux en Chine.
C’est étonnant qu’aucun des pays musulmans ne se soucie du sort des ouïghours, eux qui sont toujours à la pointe des combats de l’islam.
Même si ces atteintes sont inacceptables, tous les articles sans exception oublient un petit détail : la majorité des gens de cette ethnie sont musulmans, assez radicalisés pour la plupart, ne cherchent pas à s’intégrer à la culture chinoise et n’hésitent pas à attaquer des postes de police ou militaires…
Mais les foyers n’ayant pas de “travailleurs”, de quoi vivent ils? Car il n’y a pas d’aide sociale. J’imagine qu’il s’agit d’une agriculture vivrière, ce qui les rend indépendants du pouvoir chinois.
Tout cela ressemble à l’industrialisation de Staline de l’URSS. Ces cultures de coton me font penser à la mer d’Aral d’ailleurs, car c’est pas comme si le Xingjang était très arrosé…