Interrogez n’importe qui ayant quelques connaissances en économie sur Adam Smith, et on vous dira probablement que le grand économiste est le symbole du capitalisme débridé et déshumanisé, avec sa fameuse « main invisible », qui semble nous transformer en machines à la merci d’un mécanisme qui nous échappe, et sa promotion de l’égoïsme. C’est l’idée que j’en ai moi-même eu pendant longtemps. Et pourtant, cette vision ne reflète pas ses écrits qui ont au contraire promu le marché comme une institution vivante gouvernée par une éthique. Compte tenu de son importance dans la pensée économique, et à l’heure où le rôle sociétal de l’entreprise et du marché est en question, il est important que le débat ne soit pas basé sur une caricature de sa pensée.
L’intérêt collectif peut-il être servi par la poursuite de l’intérêt personnel ?
A priori cela semble contradictoire. Pourtant, l’idée n’était pas nouvelle au moment où Adam Smith étudie la première Révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Elle avait été avancée par l’économiste hollandais Bernard Mandeville. Avec sa fameuse Fable des abeilles, publiée en 1714, Mandeville développe l’idée choquante que les vices privés conduisent au bonheur public. Selon lui, le vice, qui conduit à la recherche de richesses et de puissance, produit involontairement de la vertu parce qu’en libérant les appétits, il apporte une opulence supposée ruisseler du haut en bas de la société. Ainsi explique-t-il que s’il n’y avait plus de voleurs qui cassent les vitres et brisent les cadenas pour entrer, les vitriers et fabricants de cadenas seraient au chômage. Le vol est donc bon pour la richesse collective.
Le raisonnement de Mandeville est cependant un sophisme, qui sera justement dénoncé par Frédéric Bastiat. Si elle donne effectivement du travail au vitrier, la vitre brisée par le voleur est d’abord une destruction de bien ; le résultat net de l’opération est donc une perte pour la société. Car sinon il suffirait de raser une ville régulièrement pour assurer la richesse économique.
La notice de Wikipedia sur Adam Smith indique que celui-ci a été influencé par Mandeville, mais omet de préciser qu’il critiquera sévèrement le cynisme de la Fable.
Intérêt privé, intérêt collectif
Smith semble pourtant d’accord avec lui lorsque, dans un passage célèbre, il écrit :
Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger qu’il faut espérer notre dîner, mais du souci de leur propre intérêt.
Mais l’accord n’est qu’apparent.
En énonçant que le voleur contribue au bien public, Mandeville voit la recherche de l’intérêt personnel comme un vice et revendique les bienfaits de ce vice. Il a une position à la fois strictement utilitaire – ce qui importe c’est le résultat collectif – et immorale – la fin justifie les moyens. Pour Smith, au contraire, la recherche de son propre intérêt est une vertu à part entière (c’est la prudence, une vertu fondamentale). Comment, dès lors, le concilier avec l’intérêt commun ? C’est que, selon Smith, la recherche de son propre intérêt ne peut être poursuivie en ignorant les autres. Le boucher doit nous vendre quelque chose, nous devons repartir tous les deux satisfaits de l’échange car il escompte que nous reviendrons bientôt dans son échoppe et que nous parlerons de lui en bien à nos amis. Il doit donc comprendre ce que nous ressentons, et doit construire une relation avec nous. La construction de cette relation nécessite ce que Smith nomme une « sympathie mutuelle » au sens ancien de « ce qui est en relation, en affinité avec ».
C’est la construction de cette relation qui est le cœur de l’action marchande (et bourgeoise en général) et que l’on retrouve d’ailleurs dans le principe numéro trois de l’effectuation, la logique des entrepreneurs, qui invite à co-construire l’action créative.
Bien avant Mandeville et Smith, Spinoza avait d’ailleurs déjà souligné que ce qui est bon pour nous ne s’oppose pas à ce qui est bon pour les autres. Il faisait même du premier la condition du second et écrit dans L’éthique :
Rien n’est plus utile au bien commun que l’utile propre, c’est-à-dire ce qui est utile pour soi.
Les 7 vertus du commerce
Pour Smith cependant, le raisonnement du boucher ne peut être réduit à un simple calcul utilitaire, c’est-à-dire sans dimension éthique. Le boucher n’essaie pas de nous satisfaire seulement parce qu’il escompte que nous reviendrons demain. Cela va bien au-delà d’une poursuite d’intérêt comprise au sens d’un jeu à somme nulle, d’un égoïsme calculateur ignorant le lendemain, ou d’une logique de prédation. Certains commerçants raisonneront sans doute ainsi, mais ils réussiront sans doute moins dans leur affaire.
La relation du boucher avec nous se construit sous l’égide de plusieurs vertus, chacune avec un dosage différent selon les protagonistes :
– prudence (calcul, intérêt personnel, faire en sorte que nous revenions demain)
– tempérance (ne pas pousser trop fort sur les prix, ne pas tirer excessivement parti d’un avantage, ne pas nous arnaquer)
– justice (relation mutuellement profitable)
– espoir (gain, retour du client le lendemain, réputation flatteuse dans le quartier)
– amour (de son travail, plaisir de l’interaction dans l’échoppe, plaisir d’y rencontrer des voisins et d’y échanger des nouvelles)
– courage (se lever chaque matin et travailler dur)
– foi, entendue comme quelque chose lié au transcendant, c’est-à-dire non réductible à un calcul de son intérêt (vocation, fierté de son travail, identité professionnelle, respect des pairs, reconnaissance sociale)
C’est l’apport principal de Smith que d’avoir souligné l’importance de cette dimension éthique dans le commerce. Mais plus généralement, il souligne que nous sommes des créatures sociales et que nos idées et nos actions morales sont un produit de notre nature même. Les vertus fondamentales qu’il identifie sont nécessaires à la survie de la société.
Bentham et Samuelson, victoire de la machine à calculer
Malheureusement, cet aspect de son œuvre sera éclipsé pour des raisons historiques et politiques et il ne restera de visible que la poursuite de l’intérêt personnel mal compris comme la maximisation de son utilité propre, une vision calculatrice et amorale promue jusqu’à l’absurde par Jeremy Bentham et plus tard par l’économie contemporaine néo-classique, formatée par Paul Samuelson.
Ces économistes « modernes » sont le produit d’un rationalisme dogmatique. Ils ont transformé l’homme en homo oeconomicus, c’est-à-dire en une machine à calculer égoïste et omnisciente, exclusivement vouée à son plaisir propre et ignorant le monde qui l’entoure. Il est sidérant qu’une discipline tout entière ait été développée sur une telle vision, radicalement éloignée de la réalité.
En tout cas, ce n’était pas la vision de Smith. Il considérait les marchés comme des institutions vivantes, ancrées dans la culture, la pratique, les traditions et la confiance de leur époque, et non comme des abstractions déshumanisées. Non seulement justice doit lui être rendue, mais il faut sans doute le redécouvrir à l’heure où l’échec patent de l’école néo-classique, avec ses conséquences catastrophiques, ne fait plus aucun doute.
Le marché comme une institution vivante
Entre l’idéalisme à la Robespierre (pour construire une société vertueuse, il faut que nous devenions tous vertueux), le cynisme de Mandeville (une société vertueuse résulte du libre cours donné aux vices individuels), et le scientisme néo-classique (pas besoin de vertu, il suffit de calculer), Smith propose une vision finalement humaniste de l’économie, dans laquelle la société vertueuse émerge d’un équilibre difficilement trouvé et toujours réinventé par chacun entre les différentes vertus, en soi-même, et dans ses rapports aux autres. Gageons que vous regarderez votre boucher différemment la prochaine fois…
—


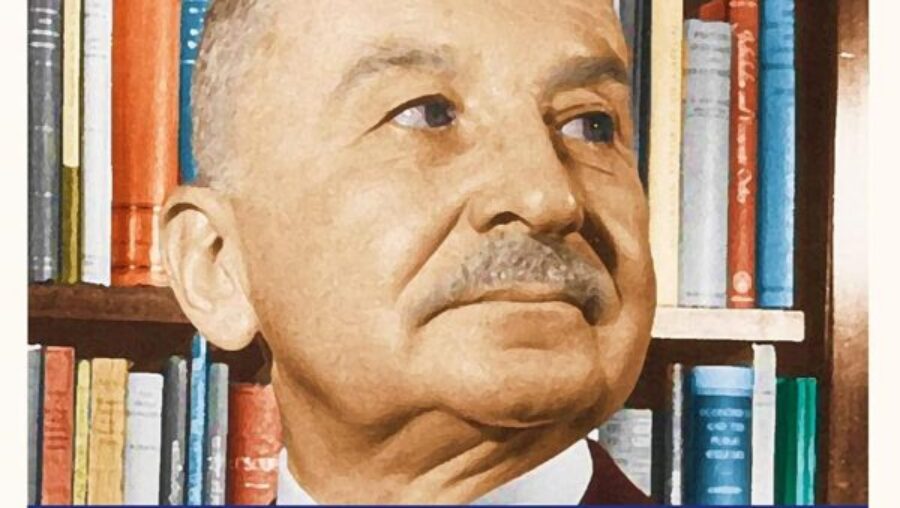

Laisser un commentaire
Créer un compte