L’habitude a été prise d’utiliser les deux expressions “hausse des prix” et “inflation” de manière quasiment interchangeable. C’est une erreur.
Les deux phénomènes se confondent lorsque la cause des hausses de prix observées est une inflation de la monnaie. Mais les hausses de prix que l’on observe peuvent ne rien avoir avec la monnaie, et être liées à d’autres problèmes économiques de nature non monétaire – comme par exemple l’emballement des matières premières en 1950 lors du déclenchement de la guerre de Corée, une réduction surprise de la production pétrolière ou le chaos logistique du Covid.
Hausse de prix temporaire
La grande différence est que lorsqu’il s’agit de hausses dont la cause n’est pas une inflation monétaire, on peut être sûr qu’il s’agit d’une hausse de prix qui ne durera pas, une hausse de prix temporaire (transitoire, dixit Jay Powell) : six mois à un an plus tard, au plus, la bulle prix a disparu. Une autre certitude est qu’ en règle générale ce genre d’événement se termine toujours par l’arrivée d’une récession.
Les opérations de confinement provoquées par l’extension de la pandémie ont semé le chaos dans les chaînes logistiques mondiales. Ces “supply chains disruptions” ne conduisent pas nécessairement à l’inflation, comme on le croit généralement du fait que cela donne naissance à des mouvements de prix spectaculaires. L’effet de ces bottlenecks peut s’exercer dans les deux directions, aussi bien déflation qu’inflation.
Pour qu’il y ait inflation (c’est à dire un mouvement durable de hausse générale de tous les prix – pas seulement de quelques uns), il faut qu’il y ait un accompagnement monétaire. Si des bouchons apparaissent dans certains secteurs du fait de ruptures d’approvisionnements, cela s’y manifeste par une hausse des prix à la production qui fait exploser le PPI (Production Price Index). La plupart des économistes posent alors comme pétition de principe que la hausse du PPI va nécessairement entraîner celle du CPI (Consumer Price Index). C’est par ce mécanisme que l’inflation se déclenche et s’étend. Mais cela n’est pas nécessairement vrai.
L’inflation dépend de l’environnement monétaire
Tout dépend de l’environnement monétaire. Pour qu’il y ait entraînement inflationniste, il faut qu’il y ait inflation monétaire (ce qui est un pléonasme car, par définition, l’inflation est un phénomène monétaire). Si ce n’est pas le cas, si la monnaie n’est pas là, la hausse des prix des approvisionnements rencontre très vite ses limites. Ce sont les marges des entreprises de la supply chain transnationale qui en paient le prix. Toutes choses égales d’ailleurs, elles réduisent leur offre de production, elles embauchent moins, diminuent les salaires offerts aux populations locales, etc… Les rigidités réglementaires qui freinent ces formes d’ajustement dans l’aire territoriale des économies développées ne jouent plus ici. Les secteurs concernés deviennent des vecteurs de déflation à l’échelle mondiale. Telle est la situation présente.
Les grandes banques centrales font tout ce qu’elles peuvent pour nous convaincre que, depuis la grande crise financière de 2008, nous connaissons une période d’extrême laxisme monétaire porté par leurs politiques monétaires dites non-conventionnelles (QEs etc…). En réalité, c’est l’inverse. La baisse continue des taux d’intérêt est un message que nous envoie le système bancaire et financier d’après-crise pour nous alerter sur l’inquiétant état de pénurie monétaire qui, depuis plus d’une décennie, étouffe la croissance mondiale du fait d’une perte d’élasticité de l’offre mondiale de liquidités (dollar shortage). La politique des banques centrales est un échec sanctionné par la décroissance continue du taux de croissance des grandes économies (développées et émergentes).
Après la crise Covid du printemps 2020, nous avons connu un intermède bienvenu de reflation porté par une reprise certes momentanément assez spectaculaire, mais d’une durée relativement brève. Tous les indicateurs monétaires et financiers globaux dont nous disposons aujourd’hui (marchés obligataires, courbe des taux, Eurodollar Futures, Swap spreads, hausse du dollar, etc…) concordent pour indiquer qu’un nouveau retournement s’est amorcé au mois de mars 2021, qui replace l’économie mondiale sur un nouvel épisode de trajectoire déflatio-récessive (le cinquième en treize années).
Les hausses de prix record des mois d’octobre et novembre font que ce n’est pas la perception qu’en retiennent pour le moment les médias. Ils restent mesmérisés par l’attraction magnétique du retour d’un grand épisode d’inflation “à la seventies“. Nul ne se soucie de ce qu’une inversion de la courbe des taux, telle qu’elle se dessine, est radicalement incompatible avec l’hypothèse que l’on pourrait être à la veille d’un déferlement inflationniste. Tout comme la dernière pièce du puzzle qui se met en place depuis quelques semaines : le retournement des marchés pétroliers (avec le retour des prix du Brent européen à une position caractéristique de “contengo”); retournement dont les premiers signes pré-datent (début octobre) la découverte du très inquiétant nouveau variant Covid (Omicron, fin novembre). L’observation des décalages de calendrier a son importance.
Les effets de la crise covid
Revenons au Covid et au chaos logistique déchaîné par les politiques de confinement à rebondissements et leurs effets de désorganisation des transports maritimes, d’engorgement des ports, de paralysie des réseaux aériens, etc. Résultat : des livraisons qui n’arrivent pas, des pénuries de pièces détachées qui se multiplient, un “juste à temps” désorganisé et, au bout du compte, des prix qui explosent.
Mais la chaîne des effets ne s’arrête pas là. La réaction du commerçant victime de ces disruptions est de chercher à augmenter ses chances de voir au moins quelques livraisons lui arriver pour disposer de quelques produits à proposer à ses clients. Il ne va pas hésiter à augmenter ses commandes, à sur commander au-delà de ce dont il aurait véritablement besoin en temps d’activité normale. Pour répondre à cet afflux de nouvelles commandes, l’industriel, pour sa part, va augmenter sa production, sans savoir que cela ne répond à aucune réelle augmentation de la demande. Ces expéditions vont à leur tour contribuer à l’engorgement des circuits logistiques.
Résultat des courses : lorsque les encombrement se résorbent, que le mouvement des livraisons revient peu à peu à la normale, et que tout le monde a le sentiment de retrouver un “business as usual“, en réalité on est loin d’être de retour à une situation normale : commerçants et industriels se retrouvent avec un sur-stockage de produits à vendre qui dépasse les besoins d’un flux normal de ventes, et qui leur pose donc des problèmes de financement (au mois de novembre, l’indice américain des stocks a connu une envolée quasi-verticale).
Si la normalisation se déroule dans un climat de vive reprise économique, le problème ne sera pas trop grave. L’augmentation des ventes permettra de résorber les excédents de stocks, mais au prix tout de même, pour les industriels, d’une réduction (temporaire) du volume de nouvelles commandes en provenance des établissements de détail (qui, cette fois-ci, réduisent leurs commandes pour tenir compte de ce qu’ils ont précédemment trop acheté). Ce coup d’accordéon exerce un effet de freinage sur la dynamique de reprise de l’expansion. Celle-ci est moins rapide que ce qui était normalement attendu avant que ne survienne la pandémie. Un tel choc d’offre (supply shock) n’est jamais gratuit.
Si cette apparente normalisation se déroule au contraire dans un climat de trend pré récessif dont les causes sont antérieures et indépendantes, pour des raisons de mini cycles financiers (pénurie de collatéral) liées aux nouvelles conditions de fonctionnement du système bancaro-monétaire international issues de la crise de 2008, c’est beaucoup plus grave.
D’un côté, une demande qui diminue par rapport à ce qu’elle était avant même que la pandémie ne survienne, de l’autre une accumulation déjà excessive de stocks par rapport à ce qu’était l’état de la demande avant que ne survienne le ralentissement qui était déjà programmé, plus le surstockage surprise qui résulte des embouteillages provoqués par le chaos des confinements, on a tous les ingrédients pour que, sur le ralentissement conjoncturel annoncé, se greffe un processus classique de “récession par les stocks”, comme au temps du bon vieux “business cycle“.
Un risque de récession
Ce qui aurait pu n’être qu’une quasi-récession (comme en 2012 ou en 2016, aux Etats Unis) a toutes chances de se transformer en une récession-pour-de-bon qui risque – pas immédiatement, mais dans un délai d’environ, douze mois – de noircir encore davantage les perspectives de continuation d’une mini croissance déflationniste annoncées pour la décennie à venir à partir d’une simple extrapolation du régime que le monde connaît depuis la crise monétaire de 2008.
Comme il ne faut absolument pas compter sur l’action des banques centrales pour mitiger ce risque (en raison de leur attachement aveugle au culte de modèles économiques détachés des nouvelles réalités de l’économie monétaire mondiale), c’est donc plutôt sur une image de dépression larvée, continuation de la dépression silencieuse que nous connaissons depuis dix ans, qu’il convient de recadrer notre vision de l’avenir des dix prochaines années (tout en tenant compte des énormes incertitudes politiques et sociales, voir géo-politiques, et même sanitaires qui risquent alors de miner un tel chemin).
Maintenant, quid du variant omicron ? En particulier si, comme on le constate, il se révèle terriblement contagieux, et si son expansion extrêmement rapide conduit au retour de nouveaux épisodes de confinement général, ou même simplement localisés.
Le schéma esquissé reste valable. Ce n’est pas l’aggravation des perspectives de la pandémie – notamment l’allongement de ses perspectives de durée (“vivre avec”) – qui risque de précipiter une dérive vers l’hyperinflation qu’imaginent pourtant nombre de commentateurs. Là encore, tout le contraire : la prolongation de la pandémie, la succession de nouvelles vagues ne peuvent que renforcer l'”effet dépression”, sans pour autant nécessairement verser dans la prévision apocalyptique.
Il n’y a pas de sens à envisager la possibilité d’un tel scénario extrême tant que le système actuel des échanges mondiaux ne laisse pas apparaître des signes incontestables et irréversibles de démantèlement. Ce n’est pas à exclure, notamment compte tenu de certaines réactions possibles à l’épidémie, mais ce n’est pas encore nécessairement inévitable. Aux experts de la géopolitique de nous dire quelle est leur évaluation des coefficients de probabilité. Cela ne relève plus de l’analyse économique.
La menace de l’inflation
Répétons-le, l’inflation – et plus encore l’hyperinflation – ne sont une menace réelle que s’il y a fuite en avant dans la création monétaire. Or, en l’état actuel des structures bancaires et monétaires mondiales, telles que conditionnées par un demi-siècle d’innovation financière, prolongé par les conséquences de la rupture de 2008, cette dérive est – pour l’instant – impossible.
Il y a trois sources possibles de création de monnaie : 1) la Banque centrale (qui, au niveau domestique, fabrique la monnaie-dite-de-base, traditionnellement censée déterminer l’offre monétaire des banques); 2) le système bancaire (la monnaie-de-banque qui résulte de la transformation d’actifs illiquides en actifs liquides, et dont le débit est, désormais, principalement le produit, au niveau mondial, de l’intermédiation d’un petit nombre de très grandes banques universelles (Global Banks) dans la fabrication d’Eurodollars); 3) l’Etat, par la voie de son déficit budgétaire (lorsque la Banque centrale est institutionnellement habilitée (ou s’arroge le droit) à acheter une part de la dette publique émise, soit par intervention directe auprès du Trésor, soit en participant au marché primaire des émissions.
La première source n’en est pas une : il s’agit d’une monnaie particulière (les “réserves”) – on devrait plutôt parler de jeton (Token) – qui ne peut être utilisée en dehors des échanges interbancaires et, en conséquence, ne peut irriguer l’économie réelle; donc une monnaie manchot qui n’est pas une monnaie, au sens commun du terme.
La monnaie de banque, elle, est aujourd’hui totalement privatisée. Avant 2008, son débit restait indirectement contrôlé par les autorités monétaires via les mécanismes subtiles du marché monétaire et la manipulation des taux d’intérêt. Depuis 2008, le mécanisme est totalement déconnecté. Le réglage du débit de la production privée de monnaie est désormais un résultat endogène de marché échappant au pouvoir domestique des banques centrales (qui, bien sûr, ne veulent absolument pas le reconnaître).
Dans ce système, ce sont les banques qui, en réalité, créent ex nihilo la monnaie nécessaire pour régler les opérations de rachats de la banque centrale (QEs). Mais, même ex nihilo, cette création de nouveaux dépôts n’est pas gratuite. Les banques ont leurs propres contraintes de bilan (balance sheet capacity) qui plafonnent l’élasticité de leurs capacités indépendantes à créer ainsi de la monnaie. La vieille idée (monétariste) selon laquelle les banques exerceraient une fonction de multiplicateur monétaire n’est ainsi plus qu’une illusion. Elles ne peuvent s’acquitter de leur tâche d’intermédiaires dans les opérations de rachat menées par les banques centrales qu’au prix d’un effet d’éviction au détriment de certaines catégories non prioritaires de crédits (les PME).
La monétisation des déficits publics
Quant à la “monétisation” des déficits publics par la banque centrale, c’est une pratique qui n’est plus autorisée dans les grands pays développés, explicitement dans le cas de la BCE, de facto aux Etats-Unis du fait du pouvoir reconnu au Congrès d’imposer un plafond impératif aux dépenses fédérales (Budget Cliff).
Les montants de plus en plus vertigineux de ces déficits font qu’il est difficile d’imaginer que les Etats puissent s’en payer le luxe sans imaginer la présence de quelque mécanisme occulte de contournement de ce genre d’interdiction. En réalité, même s’il est difficile d’y croire, ils n’en ont pas besoin. La particularité d’un choc externe comme la pandémie est en effet d’équilibrer les aides budgétaires à l’économie rendues nécessaires par les effets de confinement par une colossale économie de dépenses des ménages qui ne vont plus au restaurant, au cinéma, ne voyagent plus à l’étranger, etc… Une manne de liquidité disponible pour répondre aux appels de financement obligataire du Trésor.
Aussi incroyable que cela puisse sembler, il apparaît que ces deux sommes – les besoins du Trésor d’un côté, l’épargne-miracle des consommateurs de l’autre – sont, pour la période 2020/2021, à peu près équivalentes à quelques milliards près. Ce qui est le plus souvent interprété comme la preuve d’une monétisation indirecte de l’endettement public. Mais, dans le cas de la crise Covid, point n’est besoin d’une telle hypothèse.
La liste des indices concourant à laisser prévoir un sérieux refroidissement, indépendamment même des effets spécifiquement liés à la nouvelle vague Covid, s’allonge de semaine en semaine.Tout confirme le retour et l’accentuation progressive d’une nouvelle pénurie mondiale de dollars (offshore) dont la chute des taux, l’inversion des courbes, la hausse du dollar sur les marchés des changes, ainsi que la reprise, au cours des quatre derniers mois, des liquidations massives de portefeuilles de valeurs du Trésor américaines par les agents publics et privés des pays émergents sont les indicateurs les plus visibles. On ne voit vraiment pas ce qui pourrait nourrir l’inflation monétaire que tant de gens attendent pourtant en leg inévitable de la pandémie.
Rappelons-nous le précédent de la guerre de Corée. En Juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Le Président Truman mobilise l’armée américaine pour répondre à l’offensive communiste. L’industrie est elle aussi appelée à se mobiliser. S’en suit une période d’hystérie inflationniste d’environ six mois.
Il y a alors seulement cinq ans que la seconde guerre mondiale a pris fin. Les ménages américains, hantés par le souvenir des privations de la guerre, se précipitent dans les magasins pour prendre de vitesse les pénuries et les hausses de prix attendues. L’économie s’emballe. Dans le monde entier, les prix des matières premières flambent. Pour la première fois depuis longtemps, la Fed lance l’alarme et se rebelle contre la tutelle que lui impose le Trésor US depuis la guerre, la privant ainsi de la possibilité d’utiliser l’arme de la politique monétaire pour lutter contre l’inflation. La Banque centrale américaine obtient son indépendance par les accords Fed/Trésor du printemps 1951. Mais, entre-temps, la fièvre inflationniste était déjà retombée, et le rythme de la hausse des prix revenu dans les clous de l’après-guerre dès l’été. La monnaie n’était tout simplement pas au rendez-vous, et la Fed (déjà) n’en savait rien.
Moralité : il peut y avoir des épisodes de hausses de prix même spectaculaires (price spikes) sans pour autant que cela dégénère nécessairement en inflation. Parler d’inflation transitoire n’a en réalité aucun sens, car par définition il n’y a inflation que là où il y a déclenchement d’un mouvement long de hausse générale des prix. Actuellement, les conditions monétaires globales d’un tel mouvement ne sont pas réunies. Ce n’est pas la violence de la présente vague pandémique qui y change quoi que ce soit. Il n’y a aucun lien entre les deux choses.
Il est à noter que, comme aujourd’hui (les taux longs continuent leur mouvement à la baisse), pendant cet épisode coréen, les marchés obligataires sont les seuls à avoir gardé
la tête froide. Leurs taux n’ont pratiquement pas bougé, comme pour dire qu’ils ne partageaient pas l’alarme des économistes. Les événements leur ont donné raison. Comme il est vraisemblable qu’ils leur donneront encore raison. Quoi qu’il en soit des récentes décisions de la Fed concernant la réduction de ses opérations sur le marché (doublement du Tapering), le retour de la hausse des taux ( le Bond Rout ! régulièrement annoncé par la Fed) n’est pas encore pour demain. L’hyperinflation non plus.


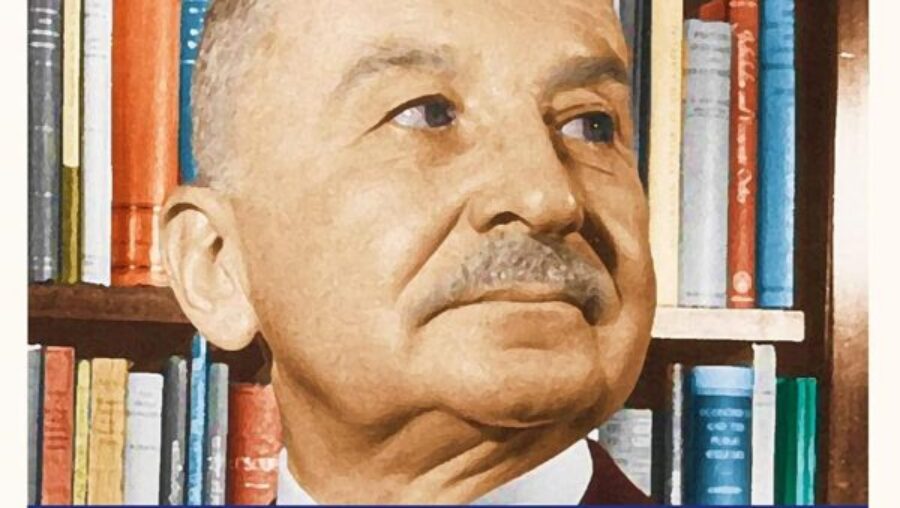

Long article assez confus dont la conclusion étrange va plaire à madame Lagarde : on va vers de la déflation. (plaire à cette dame car cela lui donne un merveilleux prétexte pour racheter outrancièrement de la dette publique). Pour justifier ce scénario, l’auteur nous raconte qu’il n’y a pas de monétisation des déficits publics. Ah bon ? Quelque chose a du m’échapper. On lit plus loin : ” La particularité d’un choc externe comme la pandémie est en effet d’équilibrer les aides budgétaires à l’économie rendues nécessaires par les effets de confinement par une colossale économie de dépenses des ménages … ” Les bras m’en tombent. L’équilibre est atteint car les gens dépenses moins. Et l’auteur précise : ” Une manne de liquidité disponible pour répondre aux appels de financement obligataire du Trésor ” Ah, et ça ce n’est pas du financement public par de la dette ? En fait l’auteur veut dire que la création monétaire ne sert qu’à faire gonfler les bas de laine des ménages. Donc, tant que les ménages ne dépensent pas, il ne se passe rien. Sauf que le prix des actifs, eux, sont corrélés aux bas de laine. Raisonnement curieux quand on sait que l’inflation historique est surtout analysée et quantifiée par le prix des actifs (terres, fermages, charges, dots … ). bien davantage que ceux des biens de consommation. Enfin, comment peut-on imaginer qu’une telle distorsion entre revenus et patrimoines puisse s’accentuer indéfiniment sans qu’un clash ne se produise un jour ou l’autre ? Non, Mme Lagarde va avoir des problèmes.
Entièrement d’accord avec vous pirouette. Le plus stupéfiant pour moi est l’affirmation que “l’inquiétant état de pénurie monétaire qui, depuis plus d’une décennie, étouffe la croissance mondiale”!