Par Farid Gueham.
Un article de Trop Libre
« Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils interagissent avec leurs utilisateurs, et certains sont même capables de parler. Ces caractéristiques sont au cœur de l’intérêt qu’ils suscitent en santé mentale, notamment pour les troubles du spectre autistique et les pathologies liées au vieillissement. Mais en communiquant avec nous, les robots peuvent aussi créer l’illusion qu’ils se soucient de nous, alors qu’ils demeurent des machines à simuler, sans émotion ni douleur, connectées en permanence à leur fabricant à qui ils transmettent les données de nos vies personnelles ».
Serge Tisseron, psychiatre et Frédéric Tordo, psychologue, fondateurs de l’Institut pour l’étude des relations homme-robot (IERHR), s’interrogent sur le potentiel thérapeutique des robots, à la lumière des recherches scientifiques concernant les robots au service des patients, mais aussi leurs implications éthiques. Quelles sont nos attentes vis-à-vis des robots de demain ?
Le robot social et la santé psychique : intelligence artificielle et santé mentale
« L’intelligence artificielle peut, bien sûr, être une aide pour la santé et la médecine en général : aide à la chirurgie, au diagnostic, utilisation de la robotique pour réapprendre la marche aux patients… Elle facilite également les techniques de fouille de données, de recherche d’informations et de résumé d’articles, qui sont fondamentales pour la veille scientifique ou la gestion des dossiers médicaux compte tenu de la quantité grandissante des informations produites par des instruments de plus en plus complexes, en imagerie médicale notamment ».
L’utilisation de l’IA dans la télésurveillance, pour le suivi des patients à domicile des personnes âgées, ou dans l’assistance aux actes chirurgicaux, par le biais de la réalité virtuelle et augmentée, n’est pas une nouveauté, comme le rappelle Gérard Sabah, chercheur en IA. Celle-ci a tenté d’aider la médecine pratiquement depuis ses débuts. Mais qu’en est-il de la santé mentale ?
L’institut national de la santé mentale des États-Unis indique qu’environ 20 % des jeunes vivraient avec une maladie mentale. Mais les professionnels de la santé mentale disposent aujourd’hui d’outils de diagnostic efficients et précis, parfois plus que les experts humains.
Google a créé en 1999 le test « PHQ-9 », développé par les docteurs Spitzer, Williams et Kroenke. De nombreuses études affirment régulièrement sa validité. Ce premier outil de diagnostic esquisse le potentiel de l’IA dans le champ de la santé psychique.
Un robot en institution soignante : un outil thérapeutique prometteur
« Au sein de l’hôpital de jour Samothrace, au CHU de Nantes, le pédopsychiatre Thierry Chaltiel a supervisé sur le plan médical la mise en place, de 2014 à 2017, d’un atelier utilisant des robots Nao avec un groupe d’adolescents souffrant de troubles du spectre autistique (TSA). L’objectif : observer si ces jeunes interagissaient et communiquaient davantage entre eux et avec les adultes grâce à l’utilisation du robot. Les résultats sont très encourageants ».
Un groupe expérimental constitué de cinq jeunes entre 12 et 16 ans, souffrant de troubles autistiques s’est approprié le fonctionnement du robot Nao. Le groupe met en scène le robot, ses expressions, rejouant également leurs propres vies, relatant leurs vacances à la plage, des parties de football.
La mise en scène du robot a des effets sensoriels surprenants chez les enfants, « ils le prenaient dans leurs bras, le manipulaient, lui parlaient, le couchaient doucement… Cet usage, que l’on pourrait qualifier de « corporel », était particulièrement investi par certains. Nous avons remarqué que l’un d’entre eux, qui s’automutilait souvent, grattait peu à peu moins ses croûtes au fil des séances robotiques et que dans ses dessins il a réussi avec le temps à représenter une surface corporelle délimitant un intérieur et un extérieur », affirme Thierry Chaltiel. Le robot permettrait une meilleure représentation du schéma corporel, une meilleure conscience de soi, diminuant le stress et les mutilations corporelles.
Les robots sociaux : quel impact et quels enjeux dans la maladie d’Alzheimer ?
Le laboratoire LUSAGE est une structure spécialisée dans le développement de solutions technologiques destinées à répondre aux besoins des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et à ceux de leur entourage. La structure examine l’impact de la robotique destinée à l’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, de stades modérés à des stades plus sévères.
L’inactivité et le manque de stimulation, mais aussi des activités peu adaptées, infantilisantes ou dépourvues de sens, renforcent l’ennui, l’isolement social et la dépression. « Les recherches actuelles montrent qu’il est possible de concevoir des activités de stimulation adaptées et efficaces pour lutter contre les troubles psycho-comportementaux », rappellent Anne-Sophie Rigaud, professeure de médecine gériatrique à l’université Paris-Descartes et Manon Demange, neuropsychologue.
Le défi des robots est donc d’aider ces personnes à entretenir et cultiver leurs capacités de communication avec leur entourage. Et l’efficacité de la robotique sociale sur les troubles cognitifs à déjà été prouvée avec Paro, robot à l’apparence d’un bébé phoque, réagissant aux caresses et aux appels de son nom.
Paro a joué le rôle de médiateur de communication : sa présence favorise le contact verbal tactile, mais aussi l’expression et le transfert de sentiments et dans certains cas, la réminiscence.
Parallèlement à ces recherches, le laboratoire développe le projet « ROSIE », robots sociaux et expérimentations en gériatrie ». La finalité du projet est de dresser un état des lieux national des expérimentations avec des robots sociaux en gériatrie, afin de mieux comprendre et d’analyser leurs effets dans le champ clinique, organisationnel, économique, éthique ou social.
Face à l’IA et à la robotisation, il faut rester vigilants
En construisant des robots et en développant les technologies de l’intelligence artificielle, l’homme pense, au-delà du champ de la santé mentale, au sens du « programme » qui l’anime. Pour Serge Tisseron et Frédéric Tordo, la recherche robotique dans le domaine des maladies psychiques soulève plusieurs questions. La première s’intéresse à la valeur « travail » dans un monde robotisé.
Serons-nous un jour capables de nous modifier en profondeur, de nous formater ? Dans un contexte de développement de la cybercriminalité, ne voit-on pas se profiler une guerre des IA ? Si les auteurs appellent à la vigilance, cette dernière doit aboutir à des recommandations qui devront être appliquées. « C’est la responsabilité du pouvoir politique. Mais comment l’exercer dans un domaine où les décisions ne peuvent être efficaces qu’au niveau mondial ? ».
Pour aller plus loin :
– « Outil de dépistage : Dépression (chez les adultes) (9-articles PHQ-9) »,esantementale.com
– « Un robot en institution soignante : un outil thérapeutique prometteur »,cairn.info
– « NAO : premier robot humanoïde créé par SoftBank Robotics », softbankrobotics.com
—

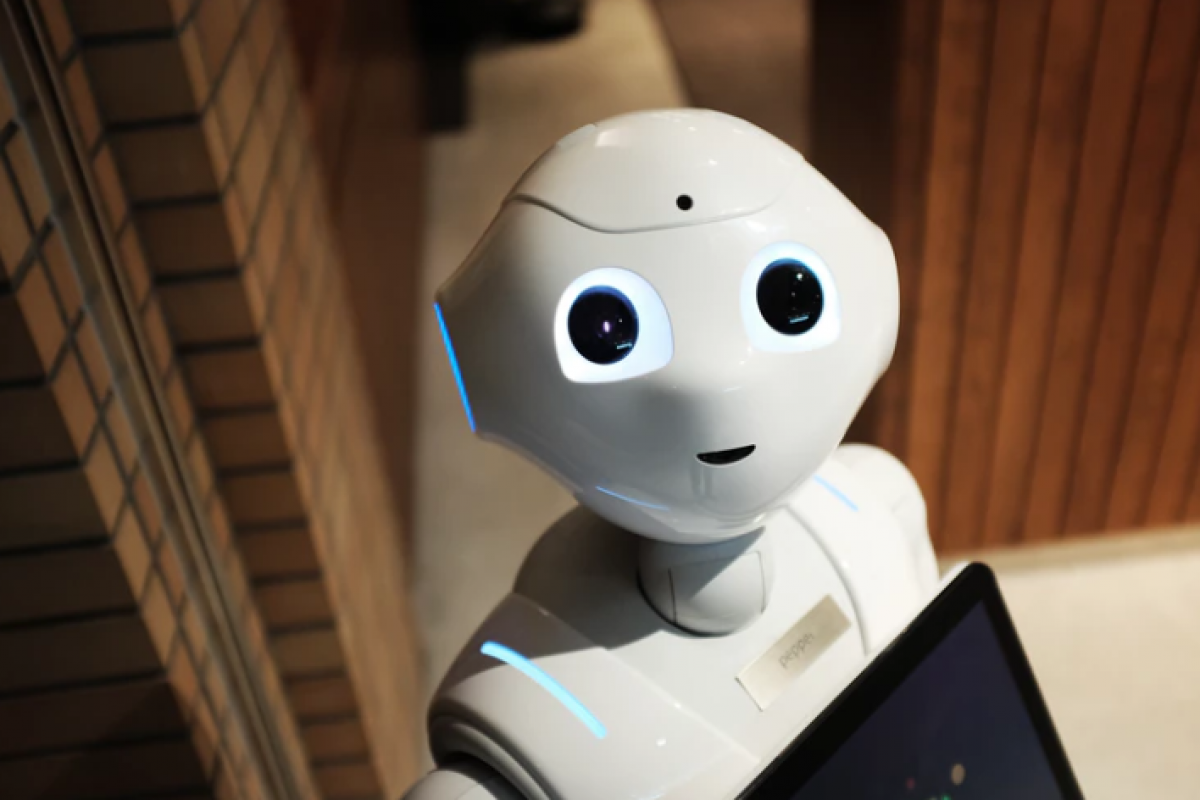
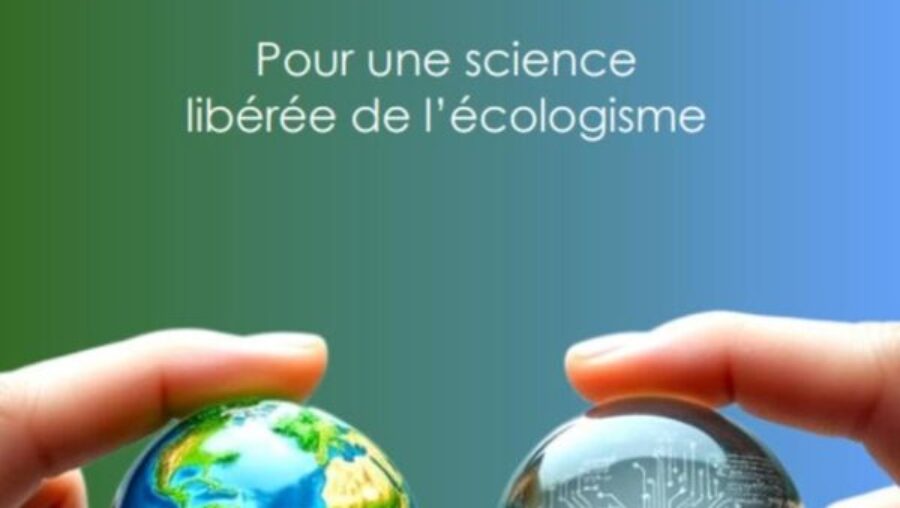
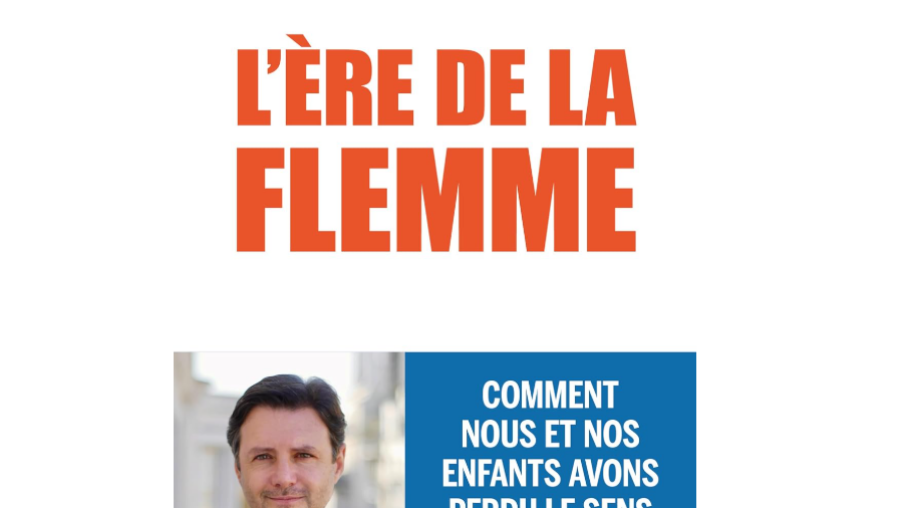

Peut-être est-ce pertinent pour les autismes et démences et dans le but d’améliorer les capacités de communication. Mais dans toutes les autres activités psychiatriques, rien ne remplacera jamais la relation duelle.