Par Gabrielle Dubois.
George Sand, comme elle nous l’a dit dans le précédent épisode de Liberté et auteurs du 19ème siècle, a acquis, à force de travail et de persévérance, une liberté financière, que la société va lui jalouser : devra-t-elle redistribuer ses gains ?
Dès que George Sand eut quelque renommée, elle ne sut pas garder sa liberté : celle de sa propre demeure. Elle dut défendre sa porte aux curieux, aux désœuvrés, aux mendiants de toute espèce, car elle vit que ni son temps ni son argent ne suffiraient à cette misère humaine, vraie ou feinte.
Sand, femme charitable, âme généreuse, aurait voulu pouvoir soulager toutes les misères qui frappaient à sa porte. Mais sa réflexion sur le sujet va l’amener à des conclusions intéressantes sur la misère sociale et sur la liberté dont on dispose réellement concernant ses propres biens.
Voici les propres réflexions de George Sand sur la liberté sociale.
La liberté de ne pas travailler
« Il y a, à Paris, autour des artistes, une mendicité organisée. Quand on a eu la simplicité de se laisser prendre à la première histoire, à la première figure, la bande vous signale comme une proie à exploiter, vous entoure, vous surveille, connaît vos heures de sortie et jusqu’à vos jours de recette.
Je ne suis pas tellement simple que je sois la dupe de toutes ces misères ; mais il en est tant de réelles et d’imméritées que, parmi celles qui demandent, c’est un travail à perdre la tête que de reconnaître les vraies des fausses. En général, quatre-vingt-dix fois sur cent, ceux qui mendient sont de faux pauvres ou des pauvres infâmes. Ceux qui souffrent réellement, en dépit du courage et de la moralité, aiment mieux mourir que de mendier. Il faut chercher ceux-ci, les découvrir, les tromper souvent pour leur faire accepter l’assistance. Les autres vous assiègent, vous obsèdent, vous menacent.
N’ayant pas le temps de courir aux informations pour saisir la vérité, puisque j’étais rivée au travail, je cédai longtemps à cette considération toute simple en apparence qu’il valait mieux donner cent sous à un gredin que de risquer de les refuser à un honnête homme. Mais le système d’exploitation grossit avec une telle rapidité et dans de telles proportions autour de moi, que je dus regretter d’avoir donné aux uns pour en arriver à être forcée de refuser aux autres.
Je vis des enfants desséchés de faim, rongés de plaies, et quand j’eus porté là des secours, je découvris, un beau matin, que ces mansardes et ces enfants étaient loués.
J’envoyai une fois chez un poète malheureux qui prétendait mourir de faim, on le trouva mangeant des saucisses. »
La liberté de ne pas donner
« Ainsi, à peine arrivée au résultat que j’avais poursuivi, une double déception m’apparut. L’indépendance sous ces deux formes : l’emploi du temps et l’emploi des ressources, voilà ce que je croyais tenir, voilà ce qui se transforma un esclavage. En voyant combien mon travail était loin de suffire aux exigences de la misère environnante, je doublai, je triplai, je quadruplai la dose du travail. Il y eut des moments où elle fut excessive, et où je me reprochai les heures de repos et de distraction nécessaires comme une mollesse de l’âme, comme une satisfaction de l’égoïsme.
Naturellement absolue dans mes convictions, je fus longtemps gouvernée par la loi de ce travail forcé et de cette aumône sans bornes. Cet abîme de la misère est sans fond et il faut qu’une société entière y précipite ses offrandes pour le combler un instant. Dans l’état des choses, il semble même que les dévouements partiels le creusent et l’agrandissent, puisque l’aumône avilit, en condamnant celui qui compte sur elle à l’abandon de soi-même.
Il y a bien une loi religieuse qui vous prescrit de donner, non pas votre superflu, mais jusqu’au nécessaire. Il y a bien une opinion qui vous conseille la charité. Mais il n’est pas de pouvoir constitué qui vous contraigne et qui contrôle l’étendue et la réalité de vos dons. En signalant ce fait, je n’entends pas dire que l’aumône forcée soit une solution sociale. »
La redistribution des richesses peut-elle libérer de la pauvreté ?
« On a retiré au clergé (1789), aux communautés religieuses, les immenses biens qu’ils possédaient. On a tenté, dans une grande révolution sociale, de créer une caste de petits propriétaires actifs et laborieux à la place d’une caste de mendiants inertes et nuisibles (mais elle existe toujours). Donc l’aumône ne sauvait pas la société, même exercée en grand par un corps constitué et considérable ; donc les richesses consacrées à l’aumône étaient loin de suffire, puisque ces richesses redistribuées ont laissé l’abîme béant et la misère pullulante. Et l’on voit qu’en me servant de cet exemple, je suppose que tout a été pour le mieux, que la redistribution n’a enrichi que des pauvres, ce qui n’est pas absolument vrai.
Oui, hélas ! la charité est impuissante, l’aumône inutile. Il est arrivé, il arrivera encore, que des crises violentes forceront les dictatures, qu’elles soient populaires ou monarchiques, à tailler dans le vif et à exiger de la part des classes riches des sacrifices considérables. Ce sera le droit du moment, mais jamais un droit absolu, selon les hommes, si un principe nouveau ne vient le consacrer d’une manière éternelle dans la libre croyance de tous les hommes. »
Libres d’imposer le baptême de la misère
« Quand même des constitutions particulières de propriété ne s’y opposeraient pas, la loi morale de l’hérédité des biens, qui entraîne celle de l’hérédité d’éducation, de dignité et d’indépendance, nous interdit absolument, sous peine d’infraction aux devoirs de la famille, de vendre nos biens et de les donner aux pauvres. Nous ne sommes pas libres d’imposer le baptême de la misère aux enfants nés de nous. La misère est dégradante. Personne ne pourrait donc légitimement jeter ses enfants dans l’abîme pour en retirer ceux des autres. Si tous les enfants appartiennent à Dieu au même titre, nous nous devons plus spécialement à ceux qu’il nous a donnés. Or, tout ce qui enchaîne la liberté future d’un enfant est un acte de tyrannie, quand même c’est un acte d’enthousiasme et de vertu. »
Le sacrifice de l’héritage
« Si quelque jour, dans l’avenir, la société nous demande le sacrifice de l’héritage, sans doute elle pourvoira à l’existence de nos enfants ; elle les fera honnêtes et libres au sein d’un monde où le travail constituera le droit de vivre. La société ne peut prendre légitimement à chacun que pour rendre à tous. En attendant le règne de cette idée, qui est encore à l’état d’utopie, forcés de nous débattre dans les liens de la famille qui seront toujours sacrés, et les effroyables difficultés de l’existence par le travail ; contraints de nous conformer aux lois constituées, c’est-à-dire de respecter la propriété d’autrui et de faire respecter la nôtre, sous peine de finir au bagne ou à l’hôpital, quel est donc le devoir, pour ceux qui voient, de bonne foi, l’abîme de la souffrance et de la misère ?
Pour ma part, je me suis fait un cas de conscience de transmettre intact à mes enfants le mince héritage que j’avais reçu pour eux, et j’ai cru concilier, autant que possible, la religion de la famille et la religion de l’humanité en ne disposant pour les pauvres que des revenus de mon travail. Je ne sais pas si je suis dans le faux. J’ai cru être dans le vrai. »
Le partage des biens
« Tout donner, ne rien posséder et vivre à la manière des chrétiens primitifs, c’est consacrer le principe de la mendicité que nous repoussons à l’état de théorie sociale.
Le partage des biens constituerait un état de lutte effroyable et sans issue, si ce n’est l’établissement d’une nouvelle caste de gros propriétaires dévorant les petits, ou une stagnation d’égoïsmes complétement barbares.
Que mes ressources s’étendissent à des sommes beaucoup plus considérables, le nombre des infortunés à ma charge n’eût fait que s’accroître, et des millions de louis dans mes mains eussent amené des millions de pauvres autour de moi. Où serait la limite ? MM. de Rothschild donnant leur fortune aux indigents détruiraient-ils la misère ? On sait bien que non. Donc la charité individuelle n’est pas le remède, ce n’est même pas un palliatif. Ce n’est pas autre chose qu’un besoin moral qu’on subit, une émotion qui se manifeste et qui n’est jamais satisfaite.
J’ai donc des raisons d’expérience, des raisons puisées dans mes propres entrailles, pour ne pas accepter le fait social comme une vérité bonne et durable, et pour protester contre ce fait jusqu’à ma dernière heure. »
Muselées par la censure
Dans le prochain épisode de Liberté et auteurs du 19ème siècle, George Sand nous présentera son amie qui, en tant que romancière, a été plus d’une fois muselée par la censure. Cette femme écrivain, poète, chroniqueuse, dont le brillant esprit, les reparties saillantes, le salon accueillant et aussi les jolies boucles blondes, ont charmé ses amis : Hugo, Gautier, Balzac… avant de faire connaissance avec son non moins célèbre mari, patron de presse, député qui avait un point de vue sur la liberté très en avance sur son temps.



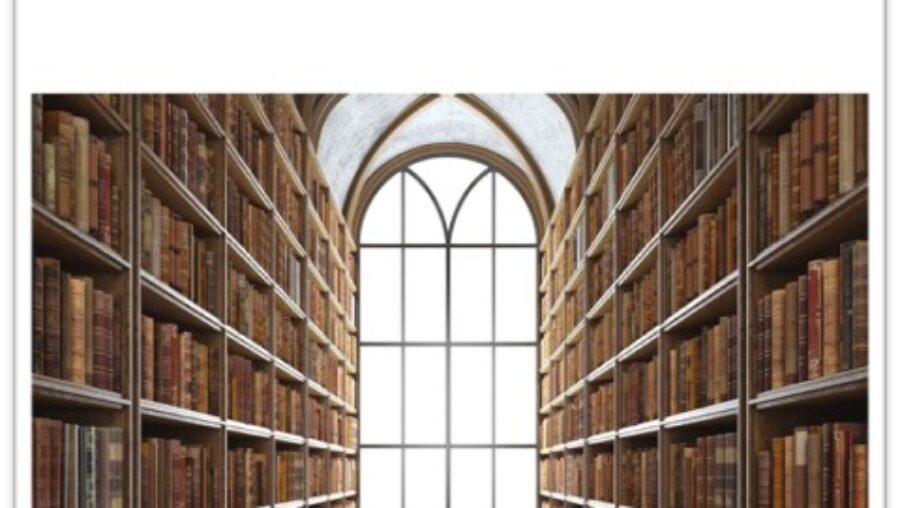

Madame DUBOIS, je vous remercie pour votre travail d’exhumation de ces écrits fort intéressants. Pouvez-vous aussi nous en rappeler les références svp ? Où ces écrits apparaissent-ils ?
Cordialement,
Bonjour Yves81,
Je vous remercie pour votre intérêt.
Les extraits choisis pour cet article sont tirés de l’Histoire de ma vie, par George Sand, en 10 volumes. Éditeur : M. Lévy frères (Paris). Date d’édition : 1856.
Vous pouvez consulter ces livres à la BNF ou sur son site web Gallica.
Gabrielle
Je vous remercie.
Dans l’attente intéressée de votre prochain article.
Bien cordialement,
Yves
très intéressante facette de cet auteur.
merci !
C’est un tel plaisir de lire George Sand !
Je suis sous le charme. Quelle humilité et en même temps quelle profondeur. George Sand donne à penser. Quel français admirable aussi, ce qui n’est pas pour rien dans l’effet produit sur le lecteur.
Je suis sous le charme aussi. George Sand était une femme extraordinaire à tant de points de vue.