Par Richard Guédon.
Mathématicien, philosophe, logicien, Jean Cavaillès, né en 1903, était l’un des intellectuels les plus brillants de sa génération. Il a été l’un des grands chefs de la résistance, un héros engagé à corps perdu dans la lutte armée contre l’occupant. Fusillé par les Allemands, il est presque oublié par les Français. Pourquoi ?
Jean Cavaillès : un parcours exceptionnel
Quand la guerre est déclarée en 1939, Jean Cavaillès a 36 ans, il est maître de conférences en logique et philosophie générale à l’Université de Strasbourg. Il a déjà derrière lui un parcours exceptionnel : ancien élève de l’École Normale Supérieure, qui forme alors les élites de la République, licencié en mathématiques, agrégé de philosophie, docteur ès lettres, c’est un universitaire plein d’avenir, déjà remarqué pour ses idées novatrices en philosophie des mathématiques.
Au début des hostilités il est mobilisé comme officier, et cité, déjà, pour son courage pendant la drôle de guerre. Fait prisonnier dans la débâcle de mai – juin 40, il s’évade, rejoint son université puis est nommé Professeur à la Sorbonne en 1941, à seulement 38 ans. Mais il ne se contente pas de donner ses cours, il s’engage, l’un des tout premiers, dans la résistance avant même la fin de l’année 1940. Fondateur, avec Emmanuel d’Astier de La Vigerie, du mouvement « Libération », il devient rapidement l’un des chefs de la lutte contre l’occupant, est arrêté plusieurs fois, s’évade à nouveau, et fait même le voyage de Londres où il rencontre le Général de Gaulle, et où il est logé par son ami Raymond Aron qu’il a connu rue d’Ulm.
Mais Cavaillès ne se contente pas de fonctions dirigeantes ou de tâches d’organisation, déjà très risquées par elles mêmes, il s’engage dans l’action directe, le sabotage, le renseignement militaire avec son réseau « Cohors ». Très rapidement il est obligé de plonger dans la clandestinité et, sous différents noms, Carpentier, Marty, Carrière, Chennevières, Hervé, Crillon etc. il organise et pratique lui-même les actions armées. Il fait même des projets pour assassiner Hitler au cas où celui-ci passerait par Paris.
Jean Cavaillès finira par être arrêté par les Allemands ; torturé, il restera muet, il sera jugé sommairement, fusillé dans les fossés du fort d’Arras puis enterré anonymement dans une tombe marquée « Inconnu N°5 ». Il ne sera exhumé et reconnu par sa sœur Gabrielle Ferrières qu’après la guerre et ses restes seront transportés dans la chapelle de la Sorbonne.
Comment comprendre l’engagement extrême que cet intellectuel a choisi de façon libre et indépendante, en toute connaissance de cause et parfaitement conscient des risques encourus ?
L’engagement extrême d’un intellectuel
Georges Canguilhem, lui-même professeur de philosophie, médecin et résistant, qui fut le condisciple, le collègue et l’ami de Cavaillès nous donne quelques clefs dans son livre Vie et mort de Jean Cavaillès.
En premier lieu, Cavaillès était protestant, milieu dans lequel l’insurrection pour défendre la liberté de conscience est une tradition enracinée ; il était fils d’officier et professait un patriotisme rigoureux à une époque où les horreurs de la guerre de 14–18 et l’influence du philosophe Alain avaient conduit beaucoup d’intellectuels vers le pacifisme.
Ensuite, Cavaillès connaissait bien l’Allemagne : il avait séjourné à de nombreuses reprises dans ce haut lieu de la philosophie de l’époque avec Husserl et Heidegger. Il aimait la culture et la musique allemandes, parlait allemand et avait observé avec lucidité les événements politiques des années 30. Il était sans doute l’un des seuls Français à avoir entendu Hitler vociférer dans une brasserie munichoise avant la prise du pouvoir et avait lu Mein Kampf, le livre programme du Führer. Il était donc convaincu de la dangerosité foncière du nazisme, « inacceptable parce qu’il était la négation sauvage de l’universalité et parce qu’il annonçait et recherchait la fin de la philosophie rationnelle ». C’est donc « par logique », presque par déduction mathématique que Cavaillès est devenu résistant, qu’il a combattu et qu’il est mort. Comme le dit encore Canguilhem : “Si ce n’est pas là un héros, alors qu’est-ce qu’un héros ?”
Jean Cavaillès tombé dans l’oubli
Au terme de ce portrait, brossé à grand traits, comment expliquer l’oubli dans lequel est tombé ce résistant parmi les plus grands, compagnon de la libération, véritable héros de roman ? Car enfin, en dehors de quelques amphithéâtres de facultés, d’un ou 2 collèges, de 2 ou 3 rues, Cavaillès est resté un inconnu, si on le compare à la postérité des Jean Moulin ou Pierre Brossolette auxquels il peut être comparé, ou encore d’un Georges Politzer, Guy Môquet, Jean-Pierre Timbaud et bien d’autres. C’est incroyable, mais aucun lycée ne porte le nom de ce grand professeur de philosophie, aucune rue non plus à Paris, la ville où il enseignait quand il est mort.
Comment expliquer cet oubli, alors que la période de l’occupation continue à structurer fortement les mentalités d’aujourd’hui et que, comme le dit encore Canguilhem, les jeunes « à l’avenir, pourront trouver dans la vie et la mort de Jean Cavaillès un exemple propre à les soutenir dans ces sortes de circonstances où la décision est sur un tranchant » ?
La seule explication que l’on peut entrevoir est que la mémoire de Cavaillès n’a été « parrainée » par aucun des 2 grands courants de pensée qui se sont partagés, voire disputés l’héritage politique et moral de la résistance après la seconde guerre mondiale : le mouvement gaulliste et le parti communiste. Jean Moulin ou Pierre Brossolette, malgré leurs différences politiques, étaient des collaborateurs directs du Général de Gaulle et leur mémoire a été fondatrice de la geste gaullienne. Georges Politzer était un philosophe marxiste, Guy Môquet et Jean-Pierre Timbaud de jeunes militants communistes et ils ont servi la mémoire du « parti des 75000 fusillés ».
La célébration de la mémoire de ces militants, par ailleurs admirables, était d’autant plus nécessaire après-guerre que, comme chacun sait, le pacte germano-soviétique de 1939 avait conduit le Parti communiste à des positions quasi collaborationnistes au début de l’occupation.
Dans cette dualité mémorielle, Cavaillès n’avait pas sa place. Marqué par le christianisme, même s’il avait eu quelques sympathies de gauche dans sa jeunesse, il n’a jamais adhéré à une idéologie constituée, encore moins à un parti. Il n’était pas non plus récupérable par la mémoire gaulliste car pas assez politique, trop militaire, trop indépendant. Son livre Sur la logique et la théorie de la science, écrit en captivité et publié après sa mort montre aussi qu’il était devenu critique vis-à-vis de la phénoménologie, promise pourtant à un bel avenir en France par Sartre interposé.
Inclassable donc, trop singulier, trop rigoureux, trop rationnel, trop exigeant, trop libre. Un bel exemple pour tous ceux qui aiment la liberté.
Pour en savoir plus :
- Georges Canguilhem : Vie et mort de Jean Cavaillès (Editions Allia, Paris)
- Gabrielle Ferrières : Jean Cavaillès. Un philosophe dans la guerre, 1903-1944. Postface de Gaston Bachelard. (Editions du félin)
- Jean Cavaillès résistant ou la Pensée en actes, sous la direction de Jean-Pierre Azéma et Alya Galan (Flammarion, 2002).
- Jean Cavaillès : Sur la logique et la théorie de la science. (Librairie philosophique J. Vrin)


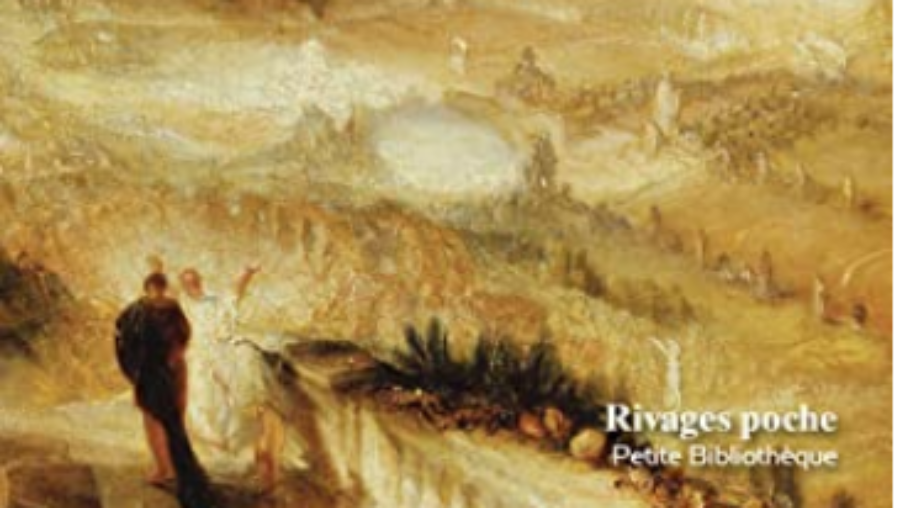
Merci pour cet article. Il serait bien, 72 ans après l’ armistice de ne plus titré ” fusillé par les allemands” mais fusillé par les nazis.
Fusillé par DES Allemands dont certains n’étaient peut-être même pas nazis, mais soldats à contre-coeur ne voulant ni aller à l’Est en punition, ni causer du tort à leurs parents en refusant d’être soldat ou en désertant, ou en refusant de faire partie d’un peloton d’exécution
Quoiqu’il en soit merci aussi de m’avoir fait découvrir ce héros peu connu.
Tout de même, si sur Google earth vous tapez uniquement Jean Cavaillès, vous avez déjà des résultats et si vous tapez rue Jean Cavaillès vous en avez d’autres.
Pas assez sans doute, mais l’auteur de l’article explique bien pourquoi
C’est également ce que je pense. Ainsi va le sort des héros?
Jean-Pierre Melville lui a rendu hommage dans L’armée des ombres à travers le personnage de Luc Jardie, interprété par Paul Meurisse, et les livres qu’il a écrits.