Par Fabio Rafael Fiallo.
Entamons, le temps d’un article, un retour au passé. Aux années 70 et 80 du siècle dernier, pour être précis. Une fois sur place, que voyons-nous ? Eh bien, rien de moins qu’une cascade d’événements laissant présager la fin de l’ordre capitaliste mondial promu et protégé par les États-Unis.
Dans les pays industrialisés, un phénomène inédit avait fait son apparition : la stagflation (stagnation économique accompagnée d’une inflation galopante). Car les recettes keynésiennes – expansion de la dépense publique et de la masse monétaire –, censées avoir fait leur preuve par le passé, s’avéraient impuissantes à relancer l’économie et ne faisaient qu’attiser l’augmentation des prix.
On annonçait d’autre part que les États-Unis étaient sur le point de perdre la première place dans l’économie mondiale au profit d’un Japon qui avait développé, par le biais de l’activisme d’État et notamment du soutien public aux entreprises nationales, une formidable capacité exportatrice.
Les conséquences du Vietnam
Le fiasco de la guerre du Vietnam avait jeté une douche froide sur la détermination des États-Unis à s’engager militairement dans d’autres théâtres d’opérations. En même temps, l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée Rouge, ainsi que la répression contre les mouvements de protestation dans les pays d’Europe orientale sous l’orbite de Moscou, montraient une Union Soviétique déterminée et capable d’étendre son influence partout dans le monde – profitant pour cela de la retenue du président américain Jimmy Carter dans les affaires internationales.
De là à annoncer que la guerre froide allait se solder par le triomphe du bloc soviétique, il n’y avait qu’un pas que les pythies du « Grand Soir de la Révolution » franchissaient allègrement.
Mais voilà que ces expectatives s’écroulèrent comme un château de cartes.
Les élections aux États-Unis et en Angleterre menèrent au pouvoir de nouveaux leaders prêts à jeter par-dessus bord les vieilles recettes keynésiennes. Margaret Thatcher et Ronald Reagan mirent en place des politiques dites de l’offre (allègement des charges et des contraintes pesant sur les entreprises), lesquelles, ajoutées à l’enchérissement de l’argent décidé par le chef de la Réserve Fédérale d’alors, Paul Volcker, réussirent à venir à bout de la stagflation dans leurs pays respectifs. Les succès de ces nouvelles politiques induisirent tout naturellement d’autres pays à faire de même – à des degrés certes différents.
Expansion des échanges commerciaux
Prises au niveau global, les réformes eurent pour conséquence une formidable expansion des échanges commerciaux et des flux d’investissements, engendrant le phénomène connu sous le nom de mondialisation, lequel aura entraîné un recul sans précédent de la pauvreté dans le monde.
Entre-temps, l’activisme d’État en économie montrait ses limites au Japon, menant ce pays, comme le soulignera Michael J. Boskin (ancien président du Comité de conseillers économiques du Président George H.W. Bush), à « un crash financier, une décennie perdue, trois récessions et la plus forte dette publique (par rapport au PIB) d’une économie avancée ».
L’inefficacité inhérente à la gestion socialiste et le coût des expéditions militaires du Kremlin finirent par essouffler l’économie soviétique. Pour l’URSS, l’Afghanistan devint un bourbier insurmontable. Puis, devant l’intention (réelle ou feinte) du président Reagan de préparer un vaste programme militaire connu sous le nom de « guerre des étoiles », les hiérarques de l’URSS arrivèrent à la conclusion que leur pays n’avait pas les moyens économiques et technologiques de poursuivre la course aux armements.
Similitudes entre hier et aujourd’hui
Dernier mais non le moindre, les peuples d’Europe orientale continuèrent leur lutte pour se libérer du joug soviétique, et ce, jusqu’à l’écroulement du Mur de Berlin.
Aujourd’hui, le monde se trouve dans une situation semblable, à bien des égards, à celle des années 70 et 80.
Ce n’est plus la stagflation mais la « Grande Récession » – c’est-à-dire la contraction de l’activité économique mondiale consécutive à la crise des « subprimes » de 2008 – qui a été présentée comme ayant ébranlé les ciments de l’ordre capitaliste.
Au lieu du Japon, c’est la Chine qui se pose en challenger des États-Unis, ravivant chez les pourfendeurs du libéralisme la flamme de l’espoir en un développement axé sur l’interventionnisme d’État en économie.
Afghanistan, Irak et Poutine
D’autre part, l’échec des États-Unis dans la reconstruction institutionnelle (nation building) de l’Afghanistan et de l’Irak aura mené à la politique de désengagement de Barack Obama et ensuite à l’isolationnisme prôné par Donald Trump – des postures qui rappellent la retenue de Jimmy Carter face aux conflits internationaux de son temps.
Et ce n’est plus l’Union soviétique, mais la Russie de Vladimir Poutine, qui essaie d’étendre son influence par voie militaire sur les différentes régions du globe, aux dépens des grandes démocraties.
Il n’y a rien d’étonnant à ce que d’aucuns voient dans tous ces phénomènes la crise terminale du capitalisme et la fin de « l’hyperpuissance américaine ».
Or, ce que les nouvelles Cassandre semblent ne pas réaliser, c’est que la même réactivité du capitalisme et du leadership américain qui permit de surmonter les crises des années 70 et 80, cette même réactivité, donc, se trouve une fois de plus à l’œuvre pour venir à bout des crises actuelles susmentionnées.
Rôle de la politique de relance
Les politiques de relance de l’économie américaine (stimulus package) et l’assouplissement monétaire (quantitative easing), adoptées par la Réserve Fédérale et ensuite par la Banque centrale européenne et le Japon, ont rendu possible une reprise économique qui, pour lente qu’elle puisse paraître, n’en est pas moins importante. Il convient de rappeler que l’économie américaine est parvenue à créer des emplois d’une manière ininterrompue pendant les derniers 77 mois, amenant le chômage à des niveaux historiquement bas dans ce pays.
D’autre part, à l’instar de l’expérience japonaise voici trois décennies, l’activisme d’État en Chine ne parvient plus à soutenir une croissance accélérée. Qui plus est, le montant de la dette des entreprises publiques chinoises risque de mener à l’éclosion d’une bulle financière qui n’aurait rien à envier à celle qui aura handicapé le Japon durablement.
Et de même que l’Union soviétique s’empêtra fatalement en Afghanistan, ainsi la Russie de Poutine ne voit pas la fin de son engagement en Syrie, et ce, malgré les succès militaires remportés.
Le capitalisme de copinage plombe la Russie
En fait, ce n’est plus le socialisme, mais le capitalisme de copinage (avec les inefficacités qui vont avec) qui est en train de plomber l’économie et le développement technologique de la Russie, ce qui pose des limites aux ambitions du nouveau maître du Kremlin de jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale.
Deux éléments nouveaux, liés à l’ascension de Donald Trump à la présidence des États-Unis, pourraient toutefois entraver une issue favorable à l’ordre capitaliste libéral. Le protectionnisme affiché par Trump dans le domaine commercial pourrait casser l’actuelle reprise de l’économie mondiale. Puis, son empathie pour Poutine, montrée tout au long de la campagne électorale américaine, est de nature à encourager ce dernier à continuer ses aventures militaires et ses pieds de nez aux grandes démocraties.
Rôle salutaire des contrepouvoirs aux USA
C’est là, cependant, où le mécanisme des contrepouvoirs – pilier de la démocratie américaine, et en fait de toute démocratie réelle – est destiné à jouer son rôle salutaire.
En effet, les difficultés que Trump rencontre pour faire passer certaines mesures emblématiques de ses promesses électorales (le décret anti-immigration bloqué par des juges et la réforme de l’assurance-santé mise en place par le Président Obama qu’il ne parvient pas à faire adopter par le Congrès) lui auront prouvé qu’il ne peut pas faire comme bon lui semble. Car, aux États-Unis, le mécanisme des contrepouvoirs n’est pas un vain mot mais une réalité incontournable.
En fait, les élus de son propre parti, le Parti Républicain, ne semblent pas prêts à soutenir ses velléités protectionnistes. C’est pourquoi on remarque, au sein de l’équipe de Donald Trump, une marginalisation des chantres du protectionnisme, incarnés par Peter Navarro, conseiller en matière commerciale, et ce, au profit du directeur du Conseil économique, le libéral Gary Cohn.
Trump-Poutine, lune de miel écourtée ?
En ce qui concerne l’empathie de Trump pour Vladimir Poutine, elle pourrait s’avérer de courte durée. Comme le souligne l’analyste politique Michael Totten, la suspicion qui règne au sein du Parti Républicain, à propos des liens possibles entre l’actuel président des États-Unis et l’homme fort du Kremlin, est de nature à obliger Trump, dans le but d’échapper à une éventuelle enquête du Congrès à ce sujet, à faire preuve de fermeté à l’égard de la Russie.
L’augmentation astronomique du budget militaire des États-Unis (54 milliards de dollars de plus), annoncée récemment par le président Trump, va justement dans le sens de la fermeté et pourrait induire Poutine à revoir à la baisse ses ambitions géopolitiques – comme l’URSS dut le faire à l’époque de la « guerre des étoiles ».
Car on voit mal une Russie minée par les inefficacités du capitalisme de copinage en place (crony capitalism) et par la baisse structurelle des prix du pétrole (son principal article d’exportation), pouvoir s’engager dans une nouvelle course aux armements.
La Russie d’aujourd’hui toujours autoritaire
Non moins important : peut-on concevoir, dans la Russie d’aujourd’hui (ou d’ailleurs en Chine), que le Parlement (la Douma), ou encore moins un juge quelconque, puisse (comme en Amérique) défier les politiques adoptées ou envisagées par le chef de l’État ?
Celui qui oserait agir de la sorte risquerait de se voir jeté d’un 4eétage, empoisonné dans un hôtel de Londres, tué près de la Place Rouge ou dans les rues de Kiev, ou simplement envoyé en prison pour corruption.
Et c’est justement parce que, dans ces contrées-là, il faut se soumettre aux décisions et aux caprices du chef et de son parti, et parce que l’absence d’alternance au pouvoir empêche le renouvellement des équipes gouvernantes, que ces régimes n’arrivent pas à réformer convenablement leurs pays et finissent par perdre les bras-de-fer qui les opposent aux grandes démocraties, et en premier lieu à « l’hyperpuissance » honnie. Aujourd’hui comme au temps de la guerre froide.


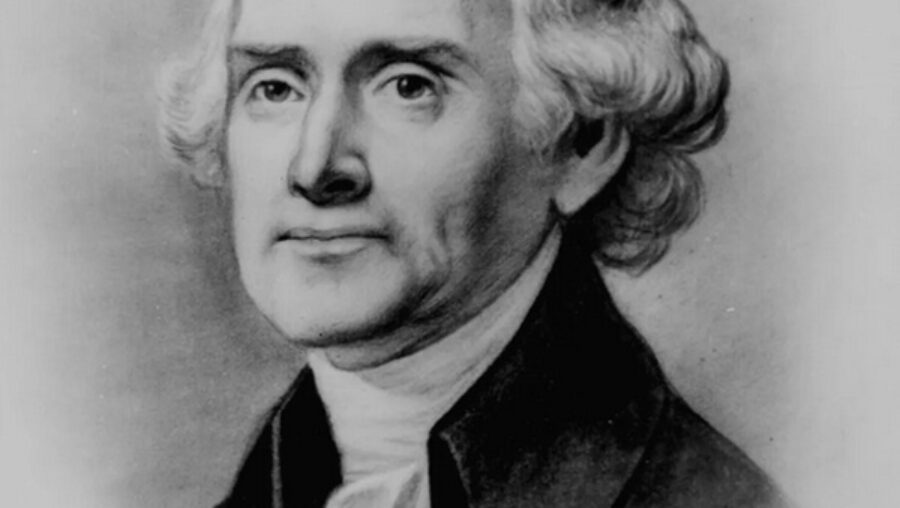
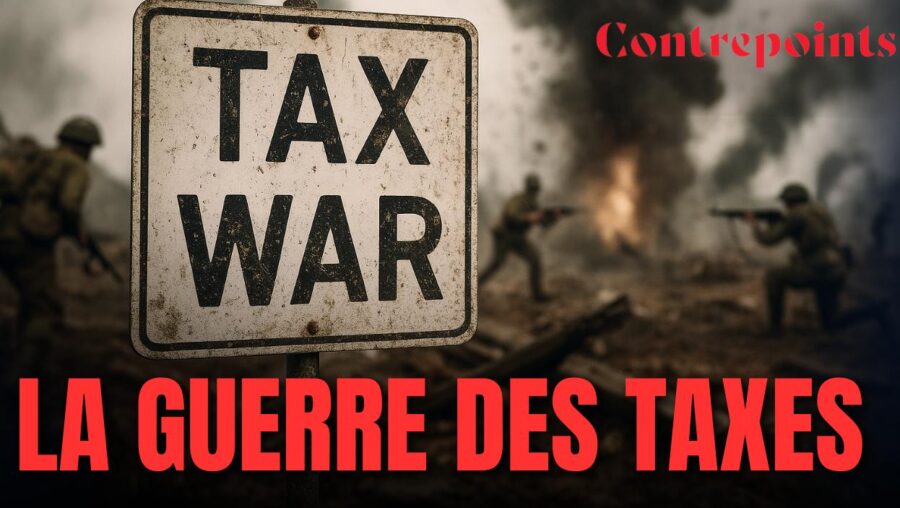

L’histoire ne se répète jamais, dit le proverbe. Mais il me semble qu’elle bégaie un peu.
Oui mais les faits priment toujours et ils sont toujours les mêmes! Poutine ne cesse de répéter que l’Otan est l’ennemie, alors qu’il devrait plutôt s’inquiéter des visées de la Chine sur la Sibérie et ses richesses, qu’il n’a pas les moyens d’exploiter, et qu’il laisse à cette dernière! Les entreprises chinoises y sont de plus en plus nombreuses. Vu l’expansionnisme chinois en Mer de Chine, il en sera de même en Sibérie.
Le “capitalisme”, la mise en commun des ressources, a quasiment toujours existé et existera partout ou la liberté existe. Il ne peut disparaître que quand il est interdit par les états et ceux-ci font alors faillite autant par manque de liberté que de capitalisme.
Par contre sur la “réactivité” des USA, Obama a doublé la dette et le QE ne rattrape que très faiblement les effets de la crise de 2008 directement engendrée par d’autres QE et des régulations qui ont perverti “l’écologie”, l’environnement économique du crédit aboutissant au résultat qu’on connaît.
Si les USA se redressent, c’est grâce à la société civile qui dispose d’une certaine liberté d’entreprise et d’innovation et malgré les actions des gouvernements régulateurs et manipulateurs qui tendent à freiner les échanges et les avancées.